Tous les livres
5,49 € – 18,00 €
Souvenirs (tome 3) –
Louise Élisabeth Vigée-Lebrun
138 x 204 mm – 186 pages – Texte et reproductions – Noir et blanc – Broché
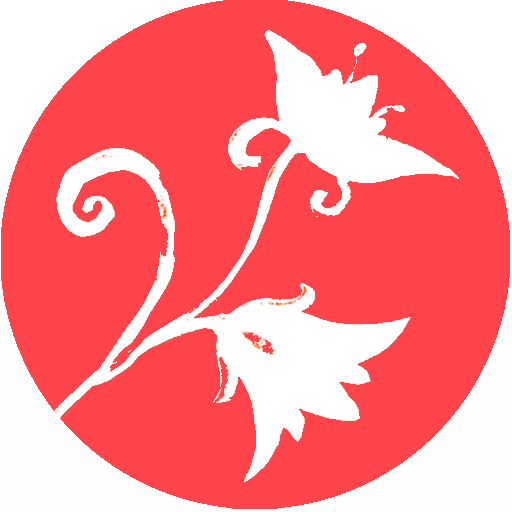
5,49 € – 18,00 €
Souvenirs (tome 3) –
Louise Élisabeth Vigée-Lebrun
138 x 204 mm – 186 pages – Texte et reproductions – Noir et blanc – Broché
CHAPITRE PREMIER
Paul Ier – Son caractère – Incendie à Pergola – Frogères – Monsieur d’Autichamp – Koutaisoff – Madame Chevalier.
Paul était né le 1er octobre 1754, et monta sur le trône le 12 octobre 1796. Ce que j’ai déjà raconté des funérailles de Catherine prouve assez que le nouvel empereur ne partageait point les regrets de la nation et, de plus, on sait qu’il décora du cordon de Saint-André Nicolas Zoubov qui lui apporta la nouvelle de la mort de sa mère.
Paul avait beaucoup d’esprit, d’instruction et d’activité; mais la bizarrerie de son caractère allait jusqu’à la folie. Chez ce malheureux prince des mouvements de bonté d’âme succédaient souvent à des mouvements de férocité, et sa bienveillance ou sa colère, sa faveur ou son ressentiment n’étaient jamais que l’effet d’un caprice. Son premier soin, dès qu’il fut monté sur le trône, fut d’exiler Platon Zoubov en Sibérie, en lui confisquant la plus grande partie de sa fortune. Fort peu de temps après, il le rappela, lui rendit tous ses biens, et toute la cour le vit un jour présenter cet ex-favori aux ambassadeurs de Géorgie avec la plus grande bienveillance et le combler de bontés.
Un soir, je me trouvai à un bal qui se donnait à la cour. Tout le monde, à l’exception de l’empereur, était masqué et les hommes et les femmes en dominos noirs. Il se fit un encombrement à une porte qui donnait d’un salon dans un autre; un jeune homme pressé de passer, coudoya fortement une femme qui se mit à pousser des cris. Paul se retournant aussitôt vers un de ses aides-de-camp : “Allez, dit-il, conduire ce monsieur à la forteresse, et vous reviendrez m’assurer qu’il y est bien enfermé.” L’aide-de-camp ne tarda pas à revenir dire qu’il avait exécuté cet ordre. “Mais, ajouta-t-il, Votre Majesté saura que ce jeune homme a la vue excessivement basse : en voici la preuve.” Et il montra les lunettes du prisonnier, qu’il avait apportées. Paul, après avoir essayé les lunettes, pour se convaincre de la vérité du fait, dit vivement : “Courez vite le chercher et menez-le chez ses parents; je ne me coucherai pas que vous ne soyez venu me dire qu’il est retourné chez lui.”
La plus légère infraction aux ordres de Paul était punie de l’exil en Sibérie, ou, pour le moins, de la prison; en sorte que, ne pouvant prévoir où vous conduirait la folie jointe à l’arbitraire, on vivait dans des transes perpétuelles. On en vint bientôt à ne plus oser recevoir du monde chez soi; si l’on recevait quelques amis, on avait grand soin de fermer les volets, et, pour les jours de bal, il était convenu que l’on renverrait les voitures. Tout le monde était surveillé pour ses paroles et pour ses actions, au point que j’entendais dire qu’il n’existait pas une société qui n’eût son espion. On s’abstenait le plus souvent de parler de l’empereur, mais je me souviens qu’un jour, étant arrivée dans un très petit comité, une dame qui ne me connaissait pas et qui venait de s’enhardir sur ce sujet, s’arrêta tout court en me voyant entrer. La comtesse Golovine fut obligée de lui dire, pour qu’elle continuât sa conversation : “Vous pouvez parler sans crainte, c’est madame Lebrun.” Tout cela paraissait bien dur, après avoir vécu sous Catherine, qui laissait jouir chacun de la plus entière liberté, sans jamais, il est vrai, en prononcer le mot.
Il serait trop long de raconter sur combien de choses futiles Paul exerçait sa tyrannie. Il avait ordonné, par exemple, que tout le monde saluât son château, même lorsqu’il en était absent. Il avait défendu de porter des chapeaux ronds, qu’il regardait comme un signe de jacobinisme. Des hommes de police avec leur canne faisaient sauter à terre tous ceux qu’ils rencontraient, au grand dépit des personnes que leur ignorance exposait à se faire décoiffer ainsi. En revanche, tout le monde était contraint de porter de la poudre. Dans le temps que parut cette ordonnance, je faisais le portrait du jeune prince Bariatinsky, et comme je l’avais prié de ne pas me venir poudré, il y avait consenti. Je le vis arriver un jour, pâle comme la mort. “Qu’avez-vous donc,
lui dis-je. – Je viens de rencontrer l’empereur en venant chez vous, me répondit-il encore tout tremblant; je n’ai eu que le temps de me jeter sous une porte cochère, mais j’ai une peur affreuse qu’il ne m’ait aperçu.” Cette terreur du prince Bariatinsky n’avait rien de surprenant; elle atteignait les personnes de toutes les classes car aucun habitant de Pétersbourg n’était sûr le matin de coucher le soir dans son lit.
Pour mon compte, je puis dire avoir éprouvé, sous le règne de Paul, la plus effroyable peur que j’aie ressentie de mes jours. J’étais allée à Pergola1, où je voulais passer la journée, et j’avais avec moi M. de Rivière, mon cocher, et Pierre, mon bon domestique russe. Tandis que M. de Rivière se promenait, avec son fusil, pour tuer des oiseaux ou des lapins (auxquels par parenthèse il ne faisait jamais grand mal), je restais sur les bords du lac, quand, tout à coup, je vis le feu que l’on avait allumé pour faire cuire notre dîner, se communiquer aux sapins et se propager avec une grande rapidité. Les sapins se touchaient, Pergola n’est pas loin de Pétersbourg!… Je me mis à pousser des cris horribles, en rappelant M. de Rivière, et, la frayeur aidant, tous quatre réunis, nous parvînmes à étouffer l’incendie, non sans nous brûler cruellement les mains; mais nous pensions à l’empereur, à la Sibérie, et l’on peut juger que cela nous donnait du courage!
Je ne saurais m’expliquer la terreur que m’inspirait Paul qu’en me rappelant combien cette terreur était générale; car je dois avouer qu’il ne s’est jamais montré pour moi que bienveillant et poli. Lorsque je le vis pour la première fois à Pétersbourg, il se souvint de la manière la plus aimable que je lui avais été présentée à Paris, lorsqu’il y vint sous le nom de comte du Nord. J’étais bien jeune alors, et tant d’années s’étaient passées depuis, que je l’avais oublié; mais les princes en général sont doués de la mémoire des personnes et des noms; c’est pour eux une grâce d’état.
Parmi tant d’ordonnances bizarres qui ont signalé son règne, une, à laquelle il était fort pénible de se soumettre, obligeait les femmes comme les hommes à descendre de voiture sur le passage de l’empereur. Or, il faut ajouter qu’il était très fréquent que l’on rencontrât Paul dans les rues de Pétersbourg, attendu qu’il les parcourait sans cesse, quelquefois à cheval, avec fort peu de suite, et souvent en traîneau sans être escorté et sans aucun signe qui pût le faire reconnaître. Il ne fallait pas moins se soumettre à l’ordre, sous peine de courir les plus grands risques, et l’on conviendra qu’il était cruel par le froid le plus rigoureux de se mettre tout à coup les pieds dans la neige. Un jour que je me trouvai sur sa route, mon cocher ne l’ayant pas vu venir de loin, je n’eus que le temps de crier : “Arrêtez! c’est l’empereur!” mais comme, on m’ouvrait la portière et que j’allais descendre, lui-même sortit de son traîneau et se précipita pour m’en empêcher, disant de l’air le plus gracieux que son ordre ne regardait pas les étrangères et surtout madame Lebrun.
Ce qui peut expliquer comment les meilleurs caprices de Paul ne rassuraient point pour l’avenir, c’est qu’aucun homme n’était plus inconstant dans ses goûts et dans ses affections. Au commencement de son règne, par exemple, il avait Bonaparte en horreur; plus tard, il l’avait pris en si grande tendresse, que le portrait du héros français était dans son sanctuaire et qu’il le montrait à tout le monde. Sa disgrâce ou sa faveur n’offrait rien de durable; le comte Strogonoff est, je crois, la seule personne qu’il n’ait point cessé d’aimer et d’estimer. On ne lui connaissait point de favoris parmi les seigneurs de la cour; mais il se plaisait beaucoup avec un acteur français nommé Frogères, qui n’était point sans talents, et qui avait de l’esprit. Frogères entrait à toute heure, dans le cabinet de l’empereur, sans être annoncé; on les voyait souvent se promener tous deux, dans les jardins, bras dessus bras dessous, causant de littérature française, que Paul aimait beaucoup, principalement notre théâtre.
Cet acteur était souvent admis aux petites réunions de la cour, et comme il portait à un haut degré le talent de mystificateur, il se permettait avec les plus grands seigneurs des mystifications qui amusaient beaucoup l’empereur, mais qui, vraisemblablement, amusaient fort peu ceux qui s’en trouvaient l’objet. Les grands-ducs eux-mêmes n’étaient pas à l’abri des mauvaises plaisanteries de Frogères; aussi, après la mort de Paul, n’avait-il plus osé reparaître au palais. L’empereur Alexandre, se promenant seul un jour dans les rues de Moscou, le rencontre et l’appelle. “Pourquoi donc n’êtes-vous pas venu me voir, Frogères ? lui dit-il, d’un air affable. – Sire, répondit Frogères délivré de ses craintes, je ne savais pas l’adresse de Votre Majesté.” L’empereur rit beaucoup de cette bouffonnerie, et fit payer avec munificence à l’acteur français un reste d’appointements que le pauvre homme jusqu’alors n’avait pas osé demander.
Après avoir vécu longtemps près de Paul, il était naturel en effet que Frogères redoutât le ressentiment d’un souverain; car Paul était vindicatif au point que l’on attribuait la plus grande partie de ses torts à sa haine pour la noblesse russe, dont il avait eu à se plaindre du vivant de Catherine. Il confondait dans cette haine les innocents avec les coupables, détestait tous les grands seigneurs, et se plaisait à humilier ceux qu’il n’exilait pas. Il montrait au contraire une grande bienveillance pour les étrangers, et surtout pour les Français, et je dois dire ici qu’on l’a toujours vu accueillir et traiter avec bonté tous les voyageurs et les émigrés qui venaient de France. Beaucoup de ces derniers ont reçu de lui de généreux secours. Je citerai entre autres le comte d’Autichamp qui, se trouvant à Pétersbourg sans aucunes ressources, avait imaginé de faire des sabots élastiques tout-à-fait jolis. J’en achetai une paire que je fis voir le soir même chez la princesse Dolgorouky à plusieurs femmes de la cour. Ils furent trouvés charmants, et cela, joint à l’intérêt qu’inspirait l’émigré, en fit commander aussitôt un grand nombre de paires. Les petits sabots ne tardèrent pas à arriver sous les yeux de l’empereur, qui, dès qu’il apprit le nom de l’ouvrier, le fit venir et lui donna une très belle place. Par malheur, c’était une place de confiance; les Russes s’en trouvèrent tellement offensés, que Paul ne put y laisser longtemps le comte d’Autichamp; mais il l’en dédommagea de manière à le mettre à l’abri du besoin.
Plusieurs faits de ce genre, que j’apprenais fréquemment, me rendaient, je l’avoue, plus indulgente pour l’empereur que ne pouvaient l’être les Russes, dont le repos était sans cesse troublé par les bizarres caprices d’un fou tout-puissant. Il serait difficile surtout de donner une idée des craintes, du mécontentement et des murmures secrets de cette cour, que j’avais vue naguère si calme et si joyeuse. On peut dire avec vérité que tant qu’a régné Paul, la terreur était à l’ordre du jour.
Comme on ne saurait tourmenter ses semblables sans être tourmenté soi-même, Paul était bien loin de vivre heureux. Il avait pour idée fixe qu’il mourrait assassiné, soit par le fer, soit par le poison, et ce fait, qui est certain, prouve encore combien il régnait d’incohérence dans toute la conduite de ce malheureux prince. Tandis qu’on le voyait parcourir seul les rues de Pétersbourg, à toute heure de jour et de nuit, il prenait la précaution de faire mettre un pot-au-feu dans sa chambre, et le reste de sa cuisine se faisait dans le plus secret intérieur de son appartement. Le tout était surveillé par son fidèle Koutaisoff, un valet de chambre de confiance qui l’avait suivi à Paris et ne quittait point sa personne. Ce Koutaisoff avait pour l’empereur un dévouement sans borne, que rien ne put jamais altérer, pas même la jalousie; car Paul lui joua le mauvais tour de lui enlever sa maîtresse, la plus jolie actrice du théâtre de Pétersbourg. Cette femme se nommait madame Chevalier. Elle jouait avec beaucoup de succès dans les opéras comiques. Sa figure et sa voix étaient charmantes, et elle chantait avec infiniment de grâce et d’expression. Koutaisoff l’aimait passionnément, lorsque l’empereur en devint amoureux; ce qui mit le pauvre homme dans un tel désespoir, qu’il en perdit presque la raison, et son service en souffrit, ainsi qu’on le verra plus tard, dans une terrible circonstance.
Paul était excessivement laid. Un nez camard et une fort grande bouche, garnie de dents très longues, le faisaient ressembler à une tête de mort. Ses yeux étaient plus qu’animés, quoique souvent son regard eût de la douceur. Il n’était ni gras ni maigre, ni grand ni petit; et bien que toute sa personne ne manquât point d’une sorte d’élégance, il faut avouer que son visage prêtait infiniment à la caricature. Aussi, quelque fût le danger qu’offrait un pareil passe-temps, il s’en fit un assez grand nombre. Une entre autres le représentait tenant un papier dans chacune de ses mains. Sur l’un on lisait : “ordre”; sur l’autre : “contre-ordre”, et sur son front : “désordre”. Rien qu’en parlant de cette caricature, j’éprouve encore un petit frémissement; car on sent bien qu’il y allait de la vie, non seulement pour celui qui l’avait faite, mais aussi pour tous ceux qui se l’étaient procurée.
Tout ce qu’on vient de lire n’empêchait point que Pétersbourg ne fût alors pour un artiste un séjour aussi utile qu’agréable. L’empereur Paul aimait et protégeait les arts. Grand amateur de la littérature française, il attirait et retenait par ses générosités les acteurs auxquels il devait le plaisir de voir représenter nos chefs-d’œuvre, et l’on ne pouvait posséder un talent en musique ou en peinture sans être assuré de sa bienveillance. Doyen, l’ami de mon père, et le peintre d’histoire dont j’ai déjà parlé plusieurs fois, se vit distingué par Paul comme il l’avait été par Catherine. Quoique fort âgé alors, Doyen avait conservé une manière de vivre si simple et si frugale, qu’il n’avait accepté qu’une partie des offres généreuses de l’impératrice; l’empereur lui continua les mêmes bontés et lui commanda un plafond pour le nouveau palais de Saint-Michel qui n’était pas encore meublé. Le salon, dans lequel Doyen travaillait, était fort près de l’Ermitage; Paul et toute la cour le traversait pour aller à la messe, et il était fort rare qu’en revenant l’empereur ne s’arrêtât pas à causer plus ou moins de temps avec le peintre, d’une manière tout-à-fait aimable. Ceci me rappelle qu’un jour un des seigneurs qui le suivait s’approcha de Doyen et lui dit : “Me permettez-vous, Monsieur, de vous faire une légère observation : vous peignez les Heures qui dansent autour du char du Soleil; j’en vois une là, plus éloignée, qui est plus petite que les autres; cependant les heures sont toutes égales. -Monsieur, lui répondit Doyen avec un grand sang-froid, vous avez parfaitement raison, mais celle dont vous me parlez n’est qu’une demi-heure.” L’observateur fit un signe d’approbation, et s’éloigna très content de lui-même.
Je ne dois pas oublier de dire que l’empereur ayant voulu payer le prix du plafond avant qu’il fût terminé, remit à Doyen un billet de banque d’une somme considérable que je ne me rappelle plus; mais ce billet était enveloppé d’un papier sur lequel Paul avait écrit de sa main : “Voici pour acheter des couleurs; quant à l’huile, il en reste encore beaucoup dans la lampe”.
Si l’ancien ami de mon père était satisfait de son sort à Pétersbourg, je n’étais pas moins contente du mien. Je travaillais sans relâche depuis le matin jusqu’au soir. Le dimanche seulement, je perdais deux heures qu’il me fallait accorder aux personnes qui désiraient visiter mon atelier, au nombre desquelles se trouvèrent plusieurs fois les grands-ducs et les grandes-duchesses. Outre les tableaux dont j’ai déjà parlé, et les portraits qui se succédaient sans cesse, j’avais fait venir de Paris mon grand portrait de la reine Marie-Antoinette (celui dans lequel je l’ai peinte en robe de velours bleu), et l’intérêt général qu’il excitait, me procurait une douce jouissance. Le prince de Condé, alors à Pétersbourg, étant venu le voir, ne prononça pas une parole, il fondit en larmes.
Sous le rapport des agréments de la société, Pétersbourg ne laissait rien à désirer. On aurait pu d’ailleurs se croire à Paris, tant il se trouvait de Français dans les réunions. C’est là que je revis le duc de Richelieu et le comte de Langeron; à la vérité ils ne séjournaient pas, le premier étant gouverneur d’Odessa, et le second toujours sur les chemins pour des inspections militaires; mais il n’en était pas de même d’une foule d’autres compatriotes. Par exemple, je liai connaissance avec l’aimable et bien bonne comtesse Ducrest de Villeneuve. Outre que cette jeune femme était très jolie et très bien faite, on remarquait en elle un charme qui tenait à son extrême bonté. Je la voyais fort souvent à Pétersbourg aussi bien qu’à Moscou, ce qui me rappelle qu’un jour, allant dîner chez elle, il m’arriva un accident, qui n’est pas rare en Russie, mais qui m’effraya extrêmement. M. Ducrest était venu me chercher en traîneau; il faisait tellement froid, que j’eus le front tout-à-fait gelé. Je m’écriais dans ma terreur : “Je ne pourrai plus penser! Je ne pourrai plus peindre!” M. Ducrest se hâta de me faire entrer dans une boutique où l’on me frotta le front avec de la neige, et ce remède, que tous les Russes emploient en pareil cas, fit cesser aussitôt la cause de mon désespoir.
Mes amis français ne me faisaient pas négliger les habitants du pays qui me recevaient si bien : chaque jour augmentait le cercle de mes relations avec les familles russes. Outre tant de personnes dont j’ai déjà parlé, je voyais souvent M. Demidoff, le plus riche particulier de la Russie. Son père lui avait laissé en héritage des mines de fer et de mercure si productives, que les immenses fournitures qu’il faisait au gouvernement accroissaient sans cesse sa fortune. Son énorme richesse fut cause qu’on lui donna en mariage une demoiselle Strogonoff, issue d’une des plus nobles et des plus anciennes familles de la Russie. Leur union fut fort douce. Quoique sa femme eût du charme et de la grâce dans toute sa personne, il n’en fut, je crois, jamais amoureux, mais elle n’en vécut pas moins très heureuse avec lui. Ils n’ont laissé que deux fils, dont l’un vit le plus souvent à Paris, et, comme son père, est grand amateur de peinture.
| Poids | 230 g |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 138 × 204 mm |
| Disponible | Oui |
| Genre | Souvenirs |
| Édition numérique | Non, Oui |
| Édition papier | Non, Oui |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.