clelie
5,99 € – 18,00 €
Clélie, histoire romaine – Tome 7/10 – Hortense
Madeleine de Scudéry
138 x 204 mm – 154 pages – Texte – Noir et blanc – Broché
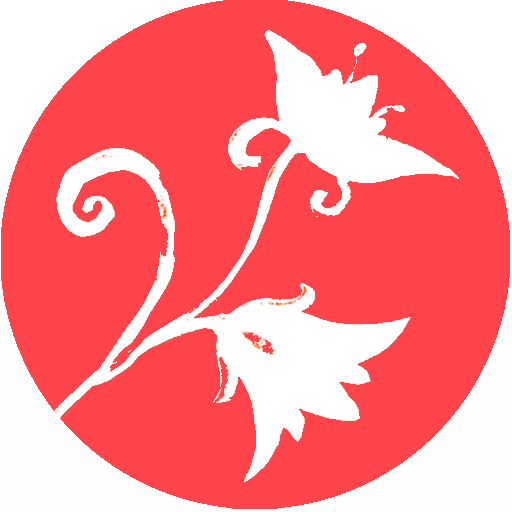
5,99 € – 18,00 €
Clélie, histoire romaine – Tome 7/10 – Hortense
Madeleine de Scudéry
138 x 204 mm – 154 pages – Texte – Noir et blanc – Broché
L’ensemble des 10 tomes de Clélie, histoire romaine, a été publié entre 1654 et 1660, signé par le frère de Madeleine de Scudéry.
Cette présente édition de 2022 rassemble le texte intégral de ce roman précieux publié en plein âge baroque. Seuls certains termes ont été actualisés et certains aspects de la structure du texte modernisés, restant au plus près du texte original tout en favorisant sa lecture.
![]()
Durant que Clélie augmentait tous ses malheurs par la crainte d’être encore plus malheureuse, Valerius qui était alors seul consul, avait auprès de lui Herminius, Amilcar, et Zenocrate qui venait d’arriver de Clusium pour lui apprendre plusieurs nouvelles importantes et fâcheuses. Mais, comme il ne les disait d’abord qu’en tumulte, Valerius le pria de les vouloir dire un peu plus particulièrement. « Dites-moi donc auparavant, reprit Zenocrate, si vous voulez que je vous parle de Tarquin, de Porsenna et de la Princesse des Leontins, devant que de vous dire ce que je sais d’Aronce, dont le destin a sans doute été fort extraordinaire.
— Aronce est un si grand prince, reprit Valerius, il a si bien servi Rome à la bataille que nous venons de gagner, et il nous importe si fort que le Roi son père, ne soit pas dans les intérêts de nos ennemis, que je serai bien aise de savoir ce qu’il est devenu.
— En mon particulier, ajouta Herminius, l’amitié que j’ai pour ce prince me fait désirer ardemment d’apprendre son aventure !
— Et pour moi, dit Amilcar, comme je le connais de plus longtemps que vous, je l’aime sans doute encore davantage et j’ai plus de curiosité pour ce qui le touche que vous n’en pouvez avoir.
— Cela étant ainsi, répliqua Zenocrate, il faut donc que vous sachiez qu’à la fin de la bataille pendant ce combat de nuit, où les amis et les ennemis ne s’entre-connaissaient point et où il y eut une si grande confusion que tous les deux partis pensaient qu’ils étaient vaincus, Aronce ayant poursuivi, malgré l’obscurité, quelques-uns des ennemis, passa de l’aile droite de votre armée à l’aile gauche parce que ceux qui fuyaient ne sachant où ils allaient, prirent ce chemin-là pensant aller rejoindre les leurs. Mais comme ils s’aperçurent qu’ils se trompaient, ils changèrent le dessein de leur retraite. En cet instant Aronce qui ne savait pas que Sextus n’était plus à la bataille, crut avoir connu à la voix d’un de ceux qu’il poursuivait, qu’il était parmi eux ; si bien que la haine redoublant le désir opiniâtre qu’il avait de vaincre, il les poursuivit encore plus ardemment. Mais voulant joindre quelqu’un à lui pour exécuter mieux son dessein, il se mit à crier : « À moi ! Romains ! À moi ! C’est un fils de Tarquin qui veut se dérober à la faveur de la nuit ! » Ces paroles qu’Aronce prononça fort haut, furent entendues par Horace qui ne savait pas que son rival fût échappé de sa prison parce qu’il n’avait bougé de l’aile gauche, et que c’était à la droite que ce vaillant prince avait combattu tant que le jour avait duré. De sorte qu’Horace sans connaître la voix de son rival parce que l’agitation et la colère la lui changeaient, et qu’Aronce n’avait dit que trois ou quatre paroles, fut seulement où le désir de vaincre un fils de Tarquin l’appelait. Se joignant donc à Aronce sans savoir qui il était, et secondant sa valeur, ils se mirent à poursuivre ceux qui se retiraient et qui, de temps en temps, tournant tête, témoignaient qu’ils avaient du cœur. Mais malheureusement pour Aronce et pour Horace, ils trouvèrent un gros de cavalerie de Veientins, où ceux qu’ils poursuivaient s’étant joints non seulement les arrêtèrent, mais les enveloppèrent aussi. Ce fut là qu’Aronce et Horace se trouvèrent en un épouvantable péril. Si bien que voulant s’exhorter l’un l’autre à vendre, du moins, leur vie bien chère à leurs ennemis, ils se parlèrent, se reconnurent à la fin, et virent qu’ils étaient encore plus ennemis entre eux qu’ils ne l’étaient de ceux qu’ils avaient poursuivis. Néanmoins, un désir de gloire et un sentiment de vertu les unissant, ils firent des choses qui surpassent toute croyance et plus d’une fois ils pensèrent percer ce gros qui les enveloppait, mais le cheval d’Aronce ayant été tué et son épée s’étant rompue en tombant, il fut pris prisonnier, si bien qu’Horace étant alors seul entre tant d’ennemis fut contraint de céder à la force, quoiqu’il sût bien que s’il tombait entre les mains de Tarquin, il était mort. Ainsi, ces deux rivaux se virent prisonniers de guerre ensemble. Ils furent mis l’un auprès de l’autre et donnés en garde aux mêmes soldats qui les ayant vus combattre comme étant d’un même parti, les laissèrent dire ce qu’ils voulurent sans les en empêcher. Je ne vous dirai pourtant pas cette conversation en détail, car j’ai plusieurs choses plus importantes à vous apprendre. Il suffira seulement que vous sachiez qu’Horace qui est généreux, se souvint toujours en parlant à Aronce qu’il lui devait la vie et qu’Aronce ne se démentit pas de sa générosité accoutumée en parlant à Horace. Mais l’un et l’autre ayant remarqué à l’accent de ceux dont ils étaient prisonniers, qu’ils étaient Veientins, ils jugèrent qu’ils n’en seraient point connus, car ni l’un ni l’autre n’avaient jamais été à Veies, et n’avaient pas fait un assez long séjour en Italie, quoiqu’ils en fussent, pour croire que ces Veientins pussent les avoir vus ailleurs. De sorte qu’ils s’entre-promirent de ne se découvrir point, et de travailler conjointement à leur liberté sans se promettre pourtant de cesser de se haïr, car ils ont un différend qui apparemment ne peut finir qu’avec leur vie. En effet, ceux à qui on les avait donnés en garde voulant savoir qui ils étaient, demandèrent à Aronce qui était Horace, et à Horace qui était Aronce, pensant mieux tirer la vérité de cette sorte qu’autrement. Horace leur répondit qu’Aronce était un Sicilien qui était venu à Rome depuis la guerre, et Aronce leur dit qu’Horace était dans les troupes d’Ardée qui étaient venues servir Rome depuis que Tarquin avait été contraint de lever le siège. De sorte que ne doutant pas de leur parole, on les garda sans y apporter un soin extraordinaire et on les fit marcher l’un auprès de l’autre. Comme ces Veientins virent qu’il n’y avait plus des leurs qui se vinssent joindre à eux, ils songèrent à faire leur retraite devant que le jour parût. Ils prirent donc le chemin de Veies, vers où toute cette armée en déroute se retirait, et ils ne furent pas plutôt au pied de la montagne sur laquelle cette fameuse ville est bâtie, qu’ils surent que le peuple voyant revenir cette armée en désordre, et croyant encore la défaite plus grande qu’elle n’était, avait fermé les portes en tumulte et disait qu’il ne fallait point recevoir les troupes de Tarquin, mais seulement celles qu’on lui avait données, ajoutant hardiment qu’il s’était entendu avec les Romains pour les faire tailler en pièces. Il est vrai que les principaux de Veies qui raisonnaient plus juste que cette multitude effrayée, voulurent s’opposer à cette sédition, mais il n’y eut pas moyen de l’arrêter d’abord ; ainsi il fallut que Tarquin campât au pied de la montagne, pendant qu’il envoya négocier avec ceux qui pouvaient calmer ce peuple irrité. Durant cela on mit Aronce et Horace dans une même tente, où ils espérèrent n’être point connus, parce que comme je l’ai déjà dit, ceux qui les gardaient étaient Veientins. Car encore que ceux de la ville voulussent bien recevoir leurs troupes, ceux qui gouvernaient ne jugèrent pas à propos de les séparer de celles de Tarquin, ainsi l’armée entière était campée hors de la ville, et elle y fut un jour et une nuit devant que ce tumulte fût apaisé. Mais à la fin, l’adresse de ceux qui agissaient pour Tarquin ayant fait venir les habitants de Veies à quelque accommodement, ils voulurent pour leur sûreté et pour satisfaire la haine qu’ils avaient depuis tant d’années contre les Romains, que Tarquin remît en leur puissance, ce qui se trouverait de prisonniers faits à la bataille. On leur fit alors comprendre que la défaite n’était pas si grande qu’on l’avait cru. Ils voulurent aussi que Tarquin s’engageât à faire déclarer d’autres États pour lui, et à le faire dans un mois, à faute de quoi ils l’abandonneraient et s’accommoderaient avec Rome s’ils le jugeaient à propos. Ces choses étant donc résolues ainsi, Tarquin fit conduire devant lui tout ce qui se trouva de prisonniers dans les divers quartiers de son armée, afin de les mener lui-même à Veies, et ceux qui eurent cet ordre furent à la tente où l’on gardait Aronce et Horace qui s’entretenaient de la plus triste manière du monde. Car se haïssant, et leur propre intérêt et leur propre générosité ne voulant pas qu’ils se querellassent en l’état où ils étaient, ils ne se parlaient civilement qu’en se faisant une contrainte étrange. « De grâce, dit Aronce à son rival dès qu’il trouva lieu de lui parler sans être entendu que de lui, dites-moi en quel état était Clélie quand vous êtes parti de Rome, je n’en serai pas plus aimé pour cela, et j’en serai seulement un peu moins misérable.
— Clélie, reprit Horace, est toujours belle, toujours charmante et pour vous dire quelque chose de plus doux pour vous, ajouta-t-il en soupirant, toujours inexorable au plus fidèle et au plus passionné de ses amants.
— Mon absence a donc changé son cœur pour moi, reprit Aronce, car elle n’a sans doute point d’amant de qui la passion puisse être comparée à la mienne.
— Si elle avait choisi le plus amoureux et qu’elle n’eût pas cherché le plus honnête homme, répliqua Horace, j’occuperais dans son cœur la place que vous y avez, et je n’aurais pas le malheur que j’ai d’être haï de ma maîtresse, d’être obligé à mon rival, de l’estimer et d’avoir de l’admiration pour sa vertu, malgré la haine que l’excès de mon amour me donne. La cruauté de mon destin, ajouta-t-il, veut même que je vous aie une nouvelle obligation à tous les moments que je respire, car enfin vous n’avez qu’à dire que je suis Horace, pour vous défaire d’un rival. En effet, la haine que Tarquin a pour moi est sue si généralement par toute l’Italie, que je serais à l’instant même mis entre les mains du plus cruel ennemi qui ait jamais été, si vous m’aviez fait connaître ; ainsi on peut dire que je vous dois la vie à tous les moments.
— Mais comme je puis dire qui vous êtes, reprit généreusement Aronce, vous pouvez aussi dire qui je suis, ainsi ma générosité n’a nul avantage sur la vôtre en cette rencontre, et je ne vous mets pas cette obligation en compte.
— Non, non, répliqua Horace avec un air assez chagrin, la chose n’est pas égale entre nous, car je perdrais la vie si vous me découvriez, et quand je vous aurais découvert, l’intérêt de Tarquin l’empêcherait de vous maltraiter.
— Ha ! Horace, s’écria Aronce, j’aimerais mieux en l’état où sont les choses, perdre la vie que de me revoir sous le pouvoir de Tarquin, et je serais plus à plaindre d’être une seconde fois son prisonnier, que d’être mort, ainsi je souhaite passionnément de demeurer captif des Veientins. »
Comme ils en étaient là, on les vint prendre pour les conduire où l’on conduisait les autres prisonniers. Ils demandèrent alors où on les menait, et comme on leur dit en général que c’était à Veies, ils s’en réjouirent au lieu de s’en affliger. Mais lorsqu’ils arrivèrent devant la tente de Tarquin où il y avait déjà environ cent prisonniers, ils furent étrangement surpris, principalement lorsqu’ils virent ce fier tyran sortir de cette tente pour les voir passer, et pour les aller ensuite conduire à Veies. Il y avait déjà assez longtemps qu’il n’avait vu Horace qui était fort changé et par ses voyages, et par ses chagrins, ainsi il ne le discerna pas dans la foule des prisonniers. Mais comme il y avait peu de jours qu’il avait vu Aronce, il n’eut pas plutôt jeté les yeux sur lui qu’il le reconnut, car il avait su le matin qu’il était sauvé de sa prison. Faisant donc alors un grand cri, « Que vois-je, dit-il en s’approchant avec précipitation de ce malheureux prince, serait-il bien vrai que tout vaincu que je suis, je pusse avoir la satisfaction de revoir le fils de Porsenna en ma puissance ? »
Aronce voyant bien alors qu’il lui était impossible de se cacher, s’avança vers Tarquin, et par une générosité sans égale, il cacha son rival en s’avançant, son grand cœur ne pouvant souffrir qu’il exposât la vie d’un si vaillant homme à la cruauté du tyran. Mais en s’avançant, il tourna la tête pour un moment et regardant Horace en abaissant la voix : « Souvenez-vous, lui dit-il, de ce que je fais pour vous aujourd’hui si la fortune vous ramène auprès de Clélie. »
Après quoi, allant au-devant de Tarquin qui venait vers lui, sans prendre garde à pas un des autres prisonniers, « Il n’est que trop vrai, lui dit-il, que je me retrouve dans vos fers, mais à n’en mentir pas j’y suis avec quelque consolation puisque mon vainqueur a été vaincu et que je puis croire sans vanité avoir contribué quelque chose à sa défaite. »
Tarquin voyant avec quelle fermeté Aronce lui parlait, pensa le traiter en rival et en ennemi mais cette politique qui avait toute sa vie donné des lois à toutes ses passions, retint sa fureur et modéra sa réponse. « Comme vous êtes fils d’un roi pour qui je veux avoir beaucoup de considération, reprit-il, j’écoute ce que vous me dites de trop dur comme une chose que la douleur de porter des fers vous fait dire ; mais pour vous témoigner que Porsenna m’empêche de prendre garde aux paroles d’Aronce, je vous déclare que je ne vous traiterai pas comme un homme que j’ai vu dans le parti de mes sujets rebelles, l’épée à la main contre moi, mais comme le fils d’un grand roi à qui je prétends avoir de l’obligation, et qui m’aidera à punir l’insolence de ceux pour qui vous avez combattu. »
Et en effet, Tarquin sans attendre de réponse commanda qu’on séparât ce prince des autres prisonniers, et qu’on le menât dans sa propre tente jusqu’à nouvel ordre. Ensuite de quoi, il marcha à la tête de tous ces captifs et fut droit à Veies suivi d’une partie des troupes, c’est-à-dire moitié Veientines et moitié Tarquiniennes, car la chose avait été résolue ainsi.
Comme le peuple se laisse aisément toucher par ce qu’il voit, la vue de ces prisonniers que Tarquin conduisait dans Veies comme s’il eût vaincu, changea l’assiette de l’esprit des habitants de cette ville. Joint que Tarquin faisant adroitement publier à l’heure même que le fils du roi d’Étrurie était en sa puissance et que Porsenna serait infailliblement dans ses intérêts, cela servit à apaiser le peuple. Il fit même encore davantage, car comme il est accoutumé à ne craindre pas d’irriter les dieux, il fit dire à Veies par plusieurs des siens que cette prétendue voix qu’on disait avoir entendue après la bataille, était une supposition, ajoutant même plusieurs railleries sur ce que cette voix avait dit qu’il en était mort un de moins du côté des Romains que du sien. De sorte que ce même peuple qui avait fermé les portes à Tarquin, le reçut avec applaudissement et les choses allèrent si bien pour ce prince que le lendemain, toutes ses troupes furent reçues dans Veies. Pour gagner davantage le cœur des Veientins, il déclara qu’il ne voulait point que lui ni les siens eussent nulle part aux prisonniers, si bien qu’ils furent alors partagés entre les chefs Veientins. Ainsi Horace est présentement esclave de quelque particulier de Veies qui ne le connaît pas pour être ce qu’il est. Mais pour Aronce, il fut conduit le lendemain dans la ville et mis en une tour où il fut gardé soigneusement quoiqu’on l’y servît pourtant avec beaucoup de respect. Cependant, Tarquin ayant été en personne au conseil, proposa d’envoyer deux Veientins et deux des siens vers Porsenna, pour lui demander assistance après lui avoir offert de lui remettre Aronce entre les mains, même sans condition. Et en effet, la chose fut résolue et exécutée de cette sorte. Mais avant que de passer outre, il faut que je vous rende compte de mon voyage avec Artemidore.
Vous saurez donc que nous arrivâmes à l’entrée de la nuit à Clusium et que sans perdre temps sachant que la Princesse des Leontins était logée dans le palais du roi, nous envoyâmes un esclave assez adroit pour lui porter un billet du Prince son frère, dont elle reconnut bientôt l’écriture. Mais comme il l’a priait de faire un grand secret de son arrivée à Clusium parce que si elle était sue du Prince des Leontins il en serait encore plus irrité contre lui, elle n’en dit rien, et chercha seulement les voies de pouvoir donner audience à ce prince sans donner aucun soupçon de ce qu’il était. Pour cet effet, elle lui écrivit qu’il allât le lendemain se promener dans un jardin du roi qui est hors la ville, du côté que Porsenna fait bâtir son tombeau, qui sera une des merveilles du monde quand il sera achevé. Vous pouvez penser que nous ne manquâmes pas à cette assignation. L’heure en étant donc venue, nous vîmes arriver la Princesse des Leontins, suivie de ses filles seulement, mais afin que la chose se fît avec plus de secret, elle n’en appela qu’une pour la suivre. Laissant les autres dans un grand parterre, elle vint nous trouver dans une allée où elle avait prié Artemidore de l’attendre, car encore que nous n’eussions jamais été dans ce jardin, elle nous avait marqué si précisément les choses qu’elle voulait que nous fissions, que nous n’y pouvions manquer. Je ne m’arrêterai point à vous dire combien l’entrevue de cette princesse et d’Artemidore fut touchante, ni de quelle manière cette admirable personne eut la bonté de me recevoir, car les intérêts d’Artemidore, ceux de cette princesse et les miens n’ayant rien de commun avec ceux de Rome, je ne dois pas vous en entretenir. Mais ce que je puis vous dire de plus vrai, est que quand nous serions Romains, nous n’eussions pu lui parler plus fortement pour les intérêts de Rome que nous lui parlâmes. Nous la conjurâmes donc de vouloir nous instruire de l’état des choses, de vouloir nous aider à empêcher que Porsenna ne protégeât Tarquin, et de faire au contraire qu’il assistât Rome. « Vous n’ignorez pas, nous dit-elle, que je suis obligée à Porsenna qui me donne asile dans sa Cour, et que j’ai des obligations infinies à la Reine de Clusium. C’est pourquoi je vous déclare que je ne puis jamais être capable de faire rien contre eux, quoique je connaisse par ce que vous dites que vous avez inclination à servir Rome. Je vous avoue même que j’ai de l’aversion pour Tarquin, et que l’aventure de Lucrèce a mis tous les Tarquin en horreur auprès de toutes les femmes qui ont de la vertu. Mais après tout, je suis et je dois être dans les intérêts de Porsenna.
— Ce que nous vous demandons, répondit Artemidore, n’est point opposé aux intérêts du Roi de Clusium, puisque nous souhaitons qu’il prenne le parti le plus juste.
— Je souhaite que cela soit ainsi, reprit cette sage princesse, et je vous promets de n’oublier rien pour vous contenter. Le roi me fait sans doute l’honneur de me considérer, ajouta-t-elle, mais comme il ne me consulte pas sur la conduite de son État, ce n’est pas directement auprès de lui que je prétends vous servir. Galerite, poursuivit cette princesse, a sans doute assez de bonté pour moi pour souffrir que je lui parle de toutes sortes de choses et il y a peu d’hommes de considération dans cette Cour, auprès de qui je n’aie quelque crédit. Mais ce que je vous puis dire en général, c’est qu’encore que Porsenna n’ait pas répondu précisément aux premières propositions qu’on lui a faites et pour Tarquin et pour Rome, et qu’il ait laissé les choses en suspens jusqu’à ce qu’il ait vu le succès du commencement de la guerre, je ne laisse pas de croire qu’il se déclarera plutôt pour le plus faible, que pour le plus fort et plutôt pour un roi chassé tout injuste qu’il est, que pour une république naissante, quoique ceux qui la gouvernent soient des gens de grande vertu. Je ne vous dis pas cela, poursuivit cette princesse, sans l’avoir ouï-dire à des personnes qui le savent bien. »
Ensuite nous dîmes encore à cette généreuse personne tout ce que nous crûmes lui devoir dire pour la confirmer dans le dessein qu’elle avait de nous servir. Nous y joignîmes même pour lui attendrir le cœur, l’intérêt d’Aronce et de son amour, et nous la laissâmes aller, après qu’elle nous eût promis de nous donner occasion de la voir tous les jours en quelque lieu, afin de savoir par elle ce que nous désirions d’apprendre. Mais sans perdre temps à vous dire des choses inutiles, vous saurez qu’Artemidore et moi vîmes enfin arriver ces envoyés de Tarquin et ces Veientins que Porsenna reçut avec toute la joie imaginable lorsqu’il sut d’eux qu’Aronce serait en sa puissance dès qu’il le voudrait. Galerite en eut aussi une satisfaction extrême, et toute la Cour s’en réjouit. De sorte que comme la joie est une disposition favorable pour obtenir ce que l’on désire, lorsque ces Veientins et ces envoyés de Tarquin demandèrent à Porsenna qu’il renouvelât l’alliance qu’il avait autrefois avec le roi de Rome et les Veientins, et qu’il fît ligue offensive et défensive avec eux, il ne rejeta pas leur proposition, et il demanda seulement deux jours pour délibérer sur cette importante affaire. Comme la Princesse des Leontins est adroite, qu’elle voudrait pouvoir servir Aronce selon son intention, et qu’elle eût bien voulu pouvoir faire ce qu’Artemidore et moi lui conseillions, elle n’oublia rien de tout ce qu’elle crut pouvoir servir à son dessein. D’abord elle se réjouit avec Galerite du prochain retour d’Aronce mais après lui avoir témoigné obligeamment la part qu’elle prenait à tout ce qui la touchait, elle vint insensiblement à parler de cette alliance qu’on prétendait renouveler. « Pour moi, lui dit alors Galerite, je vous avoue que si Aronce n’était point entre les mains de Tarquin, je serais au désespoir que le roi entra dans les intérêts d’un tyran qu’il semble que les dieux aient abandonné. Mais quand je songe que le Prince mon fils, est en sa puissance et qu’il offre de le rendre sans condition, je ne vois pas qu’il fût honnête, ni même qu’il fût possible de refuser ce que Tarquin désire de Porsenna.
— Mais, Madame, reprit la Princesse des Leontins, il me semble qu’il est assez dangereux de se ranger du parti le plus faible et le plus injuste, et que si le roi agissait sans préoccupation, il retirerait le Prince son fils des mains de Tarquin sans s’engager en une guerre dont il n’a que faire et dont le succès peut être douteux. Il lui serait même plus glorieux d’être en état d’être le médiateur des intérêts de ses voisins, que de prendre parti contre Rome que les dieux favorisent présentement. Pour les particuliers, ajouta-t-elle, il leur est souvent honteux de suivre la fortune et de se ranger toujours du parti des plus forts, mais dès qu’il s’agit du bien public on peut sans honte se ranger du côté des plus heureux, quand on le peut sans violer le droit des gens. De sorte que Porsenna n’étant engagé ni avec les uns ni avec les autres, il me semble, comme je l’ai déjà dit, qu’il pourrait ne s’engager point en une guerre où il n’a point d’intérêt. »
La Princesse des Leontins dit encore beaucoup d’autres choses que je ne vous redirai point, car c’est assez que vous sachiez que quoique Galerite lui résistât au commencement, elle l’amena pourtant dans son sens. Elle fit même davantage, puisqu’elle fit savoir à quelques-uns des principaux de cette Cour-là, que ce serait servir importamment Aronce, que d’empêcher Porsenna de prendre le parti de Tarquin. Si bien que regardant ce prince comme devant un jour être leur roi, ils se résolurent à s’opposer à cette alliance, autant que le respect qu’ils devaient à Porsenna le leur permettrait. Enfin, Galerite étant dans les sentiments que la Princesse des Leontins lui avait inspirés, obligea un homme de la première qualité qui est sa créature, et qui s’appelle Tiburse, à tâcher de s’opposer au dessein de Porsenna. Pour cet effet, il dit au roi toutes les raisons apparentes qui pouvaient servir à son intention. Je ne vous dirai pas exactement quelles elles étaient, parce que c’était à peu près celles que j’ai déjà dites. Il en ajouta pourtant encore d’autres avec beaucoup d’ardeur, insistant principalement sur le malheur de Tarquin, et sur ses crimes. « Croyez-moi, Seigneur, lui disait cet officieux ami, il est assez dangereux d’entreprendre de protéger un misérable qui mérite son infortune, principalement contre des gens accoutumés à le vaincre, et de qui la vertu semble mériter la victoire qu’ils ont remportée sur lui. Vous avez sans doute eu autrefois alliance avec Tarquin, mais c’était comme roi de Rome ; ainsi on peut dire que c’était plus avec Rome qu’avec lui que vous l’aviez contractée.
— Ah ! Tiburse, s’écria Porsenna, vos conseils sont également opposés à la générosité et à la politique.
— Mais Seigneur, reprit Tiburse, la politique ne veut-elle pas qu’on opprime ceux qui sont les plus aisés à opprimer ?
— Au contraire, reprit Porsenna, elle veut qu’on pense à opprimer ceux dont on pourrait être opprimé. Aussi est-ce pour cela qu’il importe à la grandeur de l’Étrurie, que Rome ne devienne pas si puissante qu’elle fasse trembler ses voisins et il se faut bien garder d’aller nous-même aider à forger des fers pour ceux qui nous suivront.
— Mais quand vous aurez vaincu en cette guerre, reprit Tiburse, vous n’aurez pas vaincu pour vous et vous ne vaincrez que pour Tarquin que vous remettrez sur le trône, car connaissant la grandeur de votre âme, si vous êtes le plus fort, vous lui remettrez le sceptre à la main et vous aurez toujours un puissant voisin.
— Il est vrai, répliqua Porsenna, mais ce sera un voisin attaché à mes intérêts par les siens propres, joint que comme la guerre aura épuisé Rome et en soldats et en richesses, il ne me sera pas aussi redoutable que Rome me le serait si j’abandonnais Tarquin. Car enfin, il est certain que comme il y a des aversions naturelles entre certaines personnes, il y a aussi une espèce de haine cachée entre les républiques et les monarchies.
— Au contraire, reprit Tiburse, il me semble que les peuples pour l’ordinaire souhaitent ce qu’ils n’ont pas, et que chaque particulier désire ordinairement la domination qu’il n’a pas éprouvée, s’imaginant qu’elle est plus douce que celle sous laquelle il est né.
— Quand je parle comme je fais, reprit Porsenna, je n’entends pas parler de la multitude, j’entends parler de ceux qui gouvernent. Et puis à n’en mentir pas, un roi malheureux doit exciter de la pitié dans le cœur de tous les rois, et dès qu’il s’agit de la souveraine puissance, je suis persuadé que tout souverain doit s’intéresser pour celui à qui l’on veut ôter la royauté. En effet, un frère n’est pas si obligé d’assister son frère qu’un roi d’assister un autre roi qui fait la guerre à des sujets qui l’ont chassé.
— Mais Tarquin est un tyran ! reprit Tiburse,
— Tarquin est un homme violent, répondit Porsenna, mais la fortune l’ayant fait régner longtemps paisiblement et avec beaucoup de gloire, ce n’est pas à moi à juger de son droit au trône de Romulus, mais c’est à moi à l’y remettre. En effet, ne voyez-vous pas que Tarquin tout couvert de crimes, ne laisse pas de voir périr le plus vertueux de tous les hommes, seulement parce qu’il l’a renversé du trône ? Car enfin, Brutus n’est sans doute mort que pour cela, Colatin a sans doute aussi été chassé de Rome pour la même raison, et si Tarquin n’a pas eu l’avantage jusqu’ici c’est assurément que les dieux veulent qu’un roi ait la gloire de lui remettre le sceptre entre les mains. Ne considérez-vous pas, ajouta-t-il, que si je laisse changer le gouvernement de Rome, mon état se trouvera enchâssé entre plusieurs républiques, qui s’accorderont pour me détruire à la première occasion que la fortune leur en donnera ? Il vaut donc bien mieux faire une action généreuse et pleine d’éclat puisque j’y trouve tout à la fois de la gloire et de l’utilité. Joint que toutes les fois que je pense que mon fils aime une simple Romaine et qu’il a la faiblesse de la vouloir épouser malgré moi, j’y trouve un nouveau sujet de haïr Rome. Et puis, de quel front pourrais-je demander mon fils, et refuser assistance à ceux qui me le rendent ? Non, non, Tiburse, ajouta-t-il, je ne puis pas changer d’avis et dans les sentiments où je suis, je trouve plus glorieux de rendre un royaume que d’en conquérir un pour le garder. Ne vous opposez donc pas davantage à un dessein inébranlable, et préparez-vous seulement à m’aider à vaincre.
— Mais, Seigneur, reprit Tiburse, que dira-t-on de voir un roi si plein de vertu protéger des princes si vicieux ?
— La misère, répliqua Porsenna, efface tous les vices des rois et dès qu’ils sont malheureux, il faut respecter leur condition sans considérer leurs défauts, car autrement la chose aurait de trop dangereuses conséquences pour les souverains qui, à n’en pas mentir, sont quelquefois moins vertueux que beaucoup de leurs sujets. Enfin Tiburse, la politique et la gloire veulent que je fasse ce que je suis résolu de faire. Ne m’en parlez plus je vous en conjure. »
Après cela, Tiburse fut contraint de se taire et de rapporter à Galerite que Porsenna était résolu de protéger Tarquin et de se joindre à lui et aux Veientins, pour faire la guerre à Rome. Et en effet, ayant rendu une réponse favorable à ceux que Tarquin et les Veientins avaient envoyés vers lui, deux d’entre eux partirent pour aller porter cette grande nouvelle au tyran, et pour aller quérir Aronce. Si bien que Tarquin voulant presser la chose, donna ses ordres pour faire conduire Aronce sûrement de Veies à Clusium, et commanda cinq cents chevaux de la cavalerie Veientine pour l’escorter.
Cependant, comme la Princesse des Leontins nous avertit de l’état des choses, après avoir cherché inutilement les voies de trouver quelque obstacle au dessein de Porsenna, il fut résolu qu’Artemidore demeurerait à Clusium afin de tâcher de servir Aronce quand il y serait arrivé, et que je viendrais vous avertir de ce qui se passe dans cette Cour. Mais ce qu’il y a d’étrange, c’est que Porsenna au lieu de faire préparer un appartement dans son palais pour le Prince son fils, a fait redoubler la garnison du château de l’île des Saules, qui est au milieu du lac de Thrasimène, où Galerite a autrefois été si longtemps prisonnière, afin d’y mettre ce prince quand il sera arrivé. De sorte qu’on peut dire qu’il ne fera que changer de prison, et qu’il aura la douleur d’être captif au même lieu où il est né. Il est vrai que sa vie sera en sûreté, car on sait bien qu’on ne le gardera que parce que s’étant sauvé de Clusium une fois, Porsenna craint que l’amour ne l’oblige une seconde à faire la même chose. Mais enfin, pour abréger mon discours, vous saurez que le jour de mon départ étant résolu, je partis de Clusium pour venir ici. À peine eus-je fait six mille, que traversant un bois, je trouvai cette cavalerie des Veientins qui faisait escorte à Aronce et je trouvai Aronce lui-même qui pendant que l’on raccommodait quelque chose à la bride de son cheval, était descendu et se promenait en rêvant. Mais comme quelques-uns d’entre eux m’arrêtèrent, je quittai mon accent romain que j’ai assez pur quand je le veux, et je leur dis que j’étais un étranger qui n’étant de nul parti, voyageais par toute l’Italie. Je dis cela si haut, qu’Aronce m’entendant me reconnut, quoique je déguisasse un peu ma voix, mais comme il jugea bien par ce que je disais qu’il ne fallait pas qu’il fît semblant de me connaître sur le prétexte de vouloir voir s’il savait bien encore parler la langue du pays dont il disait qu’il voyait bien que j’étais, il se mit à me parler en ma langue naturelle, qu’il sait fort bien. De sorte qu’étant assuré par lui que les Veientins qui l’environnaient n’étaient pas des gens qui fussent de langue étrangère, il me dit ce qui lui était arrivé. Il me demanda des nouvelles de Clélie, de tous ses amis, et de Celere qu’il avait laissé en prison à Tarquinies et je lui dis ensuite les sentiments du Roi son père, dont il fut bien affligé. Il me chargea de vous assurer et tous ses amis aussi, de la continuation de son amitié et d’assurer Clélie de sa constance. Après quoi, ayant été obligé de remonter à cheval, je le vis partir avec douleur, je vis dans ses yeux un déplaisir infiniment grand, et je repris le chemin de Rome où je suis arrivé heureusement, avec l’intention de retourner vers la Princesse des Leontins pour vous y rendre tout le service que je pourrai, si vous le jugez à propos. « J’avais bien toujours cru, reprit Valerius, que Porsenna assisterait Tarquin,
— Et j’avais toujours bien pensé, ajouta Herminius, qu’il serait plus difficile de détruire ce prince qu’on ne se l’imaginait.
— Pour moi, poursuivit Amilcar, je ne m’amuse jamais à prévoir les évènements fort éloignés, car pour l’ordinaire la fortune se moque de la prévoyance humaine, elle fait arriver ce qu’on n’a point prévu et ce qu’on a appréhendé n’arrive quelquefois jamais. Il vaut donc mieux songer bien prudemment aux choses présentes, et sans espérer ni craindre, attendre l’avenir avec une fermeté incapable de s’ébranler par nulle sorte d’accidents. Car encore que je trouve qu’il soit bon de n’en prévoir aucun avec inquiétude, je trouve pourtant qu’il est fort avantageux d’avoir l’esprit préparé à tout afin de n’être surpris de rien. Aussi est-ce pour cela que je veux qu’on ait une prévoyance générale, mais non pas une prévoyance particulière qui traîne toujours la crainte et l’incertitude avec elle.
— Pour commencer de mettre en pratique l’avis d’Amilcar, reprit Valerius, il se faut bien garder de témoigner au peuple qu’on craint Porsenna quand il saura qu’il prend le parti de Tarquin. C’est pourquoi il faut avec adresse cacher même une partie de l’extrême douleur que la mort de Brutus nous cause, et tâcher de remettre dans l’esprit du peuple une certaine confiance qui lui soit un présage de la victoire. »
Et en effet, Valerius qui avait déjà commencé de faire bâtir une belle maison au mont Velie, augmenta le nombre des ouvriers qui y travaillaient, afin de faire juger par-là qu’il n’appréhendait pas le succès de la guerre puisqu’il s’occupait à une chose qui demande la paix et l’abondance. Il songea même pour cette raison à instituer les jeux qu’on appelle les jeux séculaires, parce qu’on ne les célébrait qu’une fois en un siècle, s’imaginant que ces diverses choses feraient un bon effet et parmi les Romains, et parmi les ennemis.
Cependant, Zenocrate au sortir de chez Valerius, fut avec Amilcar et Herminius chez Sulpicie qui était alors auprès d’Octave, où Clélie était aussi. Un peu après qu’il y fut il s’approcha d’elle, car on ne parlait point à Octave qui était trop malade, et lui dit de la part d’Aronce toutes les choses obligeantes dont ce prince l’avait chargé. Il lui apprit qu’Horace était à Veies, et Aronce à Clusium. Que l’un était esclave d’un Veientin et l’autre prisonnier à l’île des Saules, de sorte que comme Clélie avait infiniment de l’esprit, elle connut bien les suites fâcheuses où cette aventure l’exposerait. Elle eut pourtant quelque consolation de ce qu’Horace était éloigné d’elle, mais comme elle avait une générosité délicate, quelque tendresse qu’elle eût pour Aronce, il lui semblait qu’elle faisait quelque chose contre la bienséance d’écouter ce que Zenocrate lui disait de ce prince dans le doute où elle était, s’il était vrai que ce fût lui qui eût blessé Octave. De sorte qu’elle changeait de couleur, et n’osait presque rien demander à Zenocrate, quelque envie qu’elle en eût. Mais comme Octave entendait une partie de ce que Zenocrate disait à Clélie, quoiqu’il parlât assez bas et que malgré son mal il remarqua les sentiments de cette vertueuse fille, « Non, non, ma sœur, lui dit-il généreusement d’une voix faible, ne craignez point de vous informer d’Aronce, si la blessure que j’ai reçue m’a été donnée de sa main il n’en est pas coupable envers Octave, et c’est le Prince de Numidie qu’il a blessé, c’est son rival et non pas votre frère, et si Clelius était dans mes sentiments il n’en haïrait pas Aronce, quand même j’en devrais mourir.
— Ce que vous dites est si généreux et si beau ! s’écria Herminius qui l’avait entendu, que je suis assuré que les dieux conserveront la vie à un homme qui conserve l’équité en une occasion où il est assez difficile d’être équitable. »
Clélie fut bien aise qu’Herminius eût répondu, parce qu’étant aussi sage qu’elle était, elle eût eu quelque peine à répondre d’une manière dont elle eût été tout à fait contente. Il eût pourtant, à la fin, fallu qu’elle eût dit quelque chose, si Clelius ne fût pas entré, mais sa présence faisant changer de discours, ce père affligé après avoir demandé à son fils comment il se portait, fut vers Zenocrate pour lui demander quelles nouvelles il avait apportées. Zenocrate qui venait d’apprendre qu’on croyait qu’Aronce avait blessé Octave, et que Clelius l’en haïssait sans considérer que s’il l’avait fait ç’avait été innocemment, se trouva fort embarrassé. Il lui dit pourtant ce que ce prince lui avait dit d’obligeant pour lui, et pour Clélie, afin de lui témoigner par-là qu’Aronce ne croyait pas avoir rien fait contre lui. « Ha ! Zenocrate, s’écria Clelius, je ne veux rien écouter de la part d’un homme qui a teint l’épée que je lui avais donnée dans le sang de mon fils, et quand même il l’aura blessé comme son rival, je ne le verrai de ma vie. C’est pourquoi, je suis bien aise qu’il ne soit pas en pouvoir de revenir à Rome, car je lui aurais défendu ma maison s’il y fût revenu. »
Clélie écoutait ce que Clelius disait avec une douleur extrême. Sulpicie connaissant l’humeur de Clelius, n’osait même s’y opposer, et Octave s’étant tourné de l’autre côté, après avoir parlé si généreusement, n’écoutait plus ce qu’on disait dans sa chambre. Mais ce qui acheva de donner bien de la douleur et à Sulpicie et à Clélie, fut que Clelius n’eut pas plutôt su qu’Horace était prisonnier à Veies, qu’il dit qu’il fallait qu’il essayât de le délivrer par le moyen d’un illustre Veientin qui était de ses plus anciens amis. Comme Horace était très brave et qu’il pouvait être fort utile pour maintenir la liberté de Rome, ni Herminius, ni Amilcar, ni Zenocrate, ne s’opposèrent pas à son dessein, et ne s’y pouvaient pas opposer avec honneur, quoiqu’ils fussent amis d’Aronce. De sorte qu’il n’y avait que Sulpicie et Clélie qui par leur silence, témoignaient assez que la liberté d’Horace n’était pas l’objet de leurs souhaits. Mais enfin la visite de Zenocrate étant finie, lui et ses deux amis furent passer le reste du jour chez Valerie, où Collatine, Cefonie et Plotine se trouvèrent, car pour Hermilie elle était toujours si affligée, qu’elle ne voulait voir personne. Zenocrate s’étant trouvé auprès de Plotine, lui demanda s’il n’y avait rien de nouveau depuis son départ. « Je vous assure, lui dit-elle, que je ne sais rien qui mérite d’être su de vous, si ce n’est que Spurius qui est le plus vindicatif de tous les hommes, recommence présentement d’avoir de l’amour pour Valerie, seulement parce qu’il hait ses rivaux et qu’il veut leur nuire autant qu’il pourra. Du moins l’ai-je ouï-dire aujourd’hui à un de ses amis.
— Mais n’est-ce pas lui, reprit Zenocrate, qui a autrefois conseillé à Mutius de devenir amoureux de Valerie ?
— Oui, répliqua agréablement Plotine, mais comme il voit que Mutius ne se fait pas aimer et qu’il ne chasse point Herminius du cœur de Valerie et qu’Émile y est même mieux que lui, il a résolu de tenter encore une fois lui-même cette glorieuse aventure. Si bien que présentement Valerie a quatre amants à la fois.
— Tout de bon, reprit Valerie, qui entendit ce que Plotine disait à Zenocrate quoiqu’elle ne parlât pas fort haut, j’aimerais presque mieux avoir quatre ennemis,
— Vous avez bien fait de vous servir du mot de “presque” en cette occasion, reprit agréablement Plotine, car je suis assurée qu’il y en a pour le moins un des quatre que vous ne voudriez pas qui vous haït.
— Je l’avoue, répondit-elle, mais à parler sincèrement, je ne trouve rien de plus importun que d’être opiniâtrement aimée de gens qu’on ne veut jamais aimer.
— Je connais plusieurs coquettes, dit alors Amilcar qui s’entretenait avec Herminius et Collatine, qui ne sont pas de votre humeur et qui trouvent quelque chose de fort divertissant à se faire suivre par une foule d’importuns pour qui elles n’ont aucune affection particulière. »
Comme Herminius allait se mêler dans cette conversation, Themiste et Meleagene arrivèrent, qui paraissant plus tristes qu’à l’ordinaire, donnèrent lieu à Valerie de leur demander ce qu’ils avaient. « Je regrette la mort d’un si honnête homme, répliqua Themiste, que je ne puis m’empêcher de vous demander quelques plaintes pour lui, principalement à Amilcar qui l’a connu à Syracuse. Je m’assure même, ajouta-t-il, que quoique vous n’en ayez vu que le portrait qu’on vous en fit lorsque vous eûtes la curiosité de savoir mes aventures, vous ne laisserez pas de le regretter.
— Eh bons dieux, dit alors Amilcar, gardez-vous bien de me dire que Meriandre est mort, car je le regretterais étrangement,
— Je suis bien marri de vous donner cette douleur, reprit Themiste, mais il n’est que trop vrai que l’illustre Meriandre n’est plus et qu’il est mort en trois jours.
— Quoi ? reprit Valerie, cet homme qui avait toutes les bonnes qualités, qui n’en avait point de mauvaises, qui était galant et sage tout ensemble, qui se connaissait à toutes les belles choses, qui aimait tous les beaux-arts, qui faisait sa passion de la musique, qui aimait le monde, qui était si propre, qui était si sincère, si fidèle ami, si égal, et si généreux, n’est plus ?
— Il n’est plus sans doute, répliqua Themiste, et le solitaire Merigene qui arriva hier au soir m’a appris que Meriandre a été si universellement regretté, que jamais nul autre homme ne l’a tant été à la Cour de Syracuse. Enfin il n’y a pas une belle qui ne l’ait pleuré, il n’y a pas un honnête homme que sa mort n’ait fait soupirer, tous ceux qui excellent en quelques-uns des beaux-arts les abandonnent presque puisqu’il ne sera plus leur protecteur, et tout le monde enfin, le regrette comme un homme qui pouvait seul mettre la politesse, la vertu et la galanterie dans la Cour et servir de modèle à ceux qui ne sont pas dans le chemin des honnêtes gens.
— Je vous assure, reprit Herminius, qu’on ne saurait assez regretter ceux qui ont toutes les bonnes qualités qu’avait Meriandre, et si Amilcar faisait bien, il lui ferait une épitaphe digne de son esprit, et du mérite de cet illustre mort.
— Je vous proteste, reprit Amilcar avec précipitation, que je voudrais l’avoir faite, mais je vous déclare en même temps que je ne veux pas la faire, car enfin, cette espèce d’ouvrage est l’écueil des beaux esprits, et je ne sache rien de plus difficile à bien faire. Je crois pourtant que ce qui fait qu’il y a si peu d’épitaphes qui plaisent à ceux qui les lisent c’est que généralement parlant, les louanges et la tristesse déplaisent presque à tout le monde. De sorte que toutes les épitaphes que l’on fait étant tristes et ordinairement pleines de louanges, on est plus difficile à contenter. Joint qu’à parler sérieusement, comme il faut qu’une épitaphe soit courte, qu’elle soit claire, qu’elle convienne juste à la personne pour qui elle est faite, qu’elle tienne le milieu entre la simple inscription et l’éloge, qu’il y ait quelque petit trait de morale en passant, et qu’elle inspire la tendresse et la pitié, il ne faut pas trop s’étonner si on en trouve si peu qui soient tout à fait bien. Aussi, vous puis-je assurer, qu’excepté quelques épitaphes burlesques, je n’en ai guère vu d’excellentes car elles sont pour l’ordinaire ou trop simples ou trop éloquentes. Celles qui disent trop peu de choses arrêtent les passants pour rien ; celles qui sont trop longues et qui ont plus de paroles que de choses, leur font perdre trop de temps ; celles qui louent avec excès font dire des injures au mort et à celui qui le loue ; et celles qui ne louent point du tout quand elles sont faites pour des gens qui méritent d’être loués, donnent de la colère à ceux qui ont de la générosité. Ainsi je conclus qu’il ne faut pas se hasarder légèrement à faire des épitaphes, et je ne puis me résoudre à en faire une pour l’illustre Meriandre, bien que sa mémoire me soit fort chère. »
Ensuite, Valerie demanda à Themiste si Merigene lui était envoyé par la Princesse Lindamire : « Je ne suis pas assez heureux pour cela, reprit-il, mais comme Merigene est fort de mes amis, il a cru qu’il devait me venir avertir qu’il a su que le jeune Prince de Messene passait en Italie. Il est vrai que j’ai reçu par lui des nouvelles de Lindamire qui me donnent bien de la satisfaction, et si Merigene ne m’avait pas appris la mort du généreux Meriandre, l’avis qu’on me donne du voyage du Prince de Messene ne m’aurait pas donné grand chagrin.
— Mais à ce que je vois, dit Plotine, vous et Merigene vous êtes rendus soupirs pour soupirs, car s’il vous a appris la mort de Meriandre, vous lui avez appris celle de Lisydas et d’Alcimede.
— Il est vrai, reprit Themiste, qu’il les a fort regrettés.
— En vérité, dit alors Amilcar, c’est une chose bien inutile que les regrets, du moins, pour ceux qu’on regrette, car pour ceux qui les font, ils leur font honneur, cela les fait passer pour avoir de la tendresse et de la constance ; on les loue de porter leur amitié au-delà du tombeau et cela fait dire de belles choses. Mais à parler sincèrement, il n’y a rien de plus rare que de véritables regrets.
— En effet, ajouta Plotine, je trouve qu’Amilcar a raison, et je crois aussi bien que lui qu’il y a des larmes feintes, des larmes d’habitude et des larmes de bienséance.
— Pour moi, reprit Amilcar, je me souviens d’avoir vu mourir un fort honnête homme à Carthage qui ne fut pas regretté par la moitié des gens qui le pleurèrent.
— Mais peut-on pleurer sans douleur ? dit Valerie,
— En mon particulier, dit Collatine, je ne le pourrais pas faire,
— Je l’ai déjà vu faire plus d’une fois, répliqua Amilcar, et si vous voulez bien observer l’ordre général du monde, vous en tomberez d’accord. En effet, quand on voir la mort de quelqu’un qu’on croit être obligé de regretter, on le plaint, on le loue, on fait dessein d’aller consoler ses parents, mais en attendant qu’on y aille, s’il vient quelqu’un dans la compagnie qui compte quelque nouvelle agréable, on l’écoute, on en parle, on en rit. Ensuite de quoi on se promène, on fait des visites, et l’on est tout comme à l’ordinaire, jusqu’à ce que voyant les amis particuliers ou les parents du mort, on rappelle ses larmes, ses soupirs, et sa mélancolie. Et puis quand cela est passé, on n’en parle plus, et on ne sent plus rien, du moins, ne crois-je pas que ceux qui font des choses qui ont si peu de rapport avec la douleur, puissent en avoir une véritable. Car pour en revenir à cet homme de grand mérite que je vis mourir à Carthage et qui fut tant regretté, je vous assure que je vis des femmes qui tant qu’il avait vécu, n’avaient presque pas été de ses amies, qui par vanité et pour faire croire qu’il était fort leur ami se coiffèrent négligemment durant deux ou trois jours, et qui allèrent de maison en maison demandant si on ne le regrettait pas, parlant de lui avec une certaine familiarité pleine de tendresse, capable de tromper ceux qui n’auraient pas eu un certain esprit de discernement qui est si nécessaire pour bien vivre dans le monde. Et ce qu’il y avait de rare, était que ces belles mélancoliques, le jour même qu’elles parlaient si pitoyablement, allaient le soir entendre quelque musique, et faire des collations et des promenades. Elles disaient même qu’elles n’y allaient que pour détourner leur esprit de leur douleur. “Car enfin, disaient-elles avec une voix languissante, si on ne voyait personne et si on ne se contraignait pas, on mourrait de chagrin.” Après cela ne tomberez-vous pas d’accord avec moi, que les regrets sont quelquefois fort suspects et fort peu véritables et qu’à dire les choses comme elles sont, il y a aussi peu de vraie douleur, qu’il y a peu de vraie amitié ?
— La mesure de l’une est sans doute la mesure de l’autre, reprit Herminius, car l’on ne regrette beaucoup que ceux que l’on a beaucoup aimés, mais après tout, il n’y a rien de plus beau que de conserver la mémoire de ses amis. Je n’entends pas véritablement parler de ces douleurs qui ne font que faire verser des torrents de larmes, et qui sont plutôt un effet de la faiblesse de la raison de ceux qui les répandent, que de l’excès de leur déplaisir. Mais j’entends de ceux qui ont une longue et sage douleur, qui font toute leur vie pour leurs amis morts, tout ce qu’ils peuvent faire pour eux en l’état qu’ils sont, c’est-à-dire, conserver leur mémoire, en parler toujours avec estime, défendre leurs actions passées avec ardeur, servir ceux qu’ils eussent servis s’ils eussent vécu, aimer ceux qu’ils ont aimés, et ne les oublier jamais.
— Ce que vous dites est sans doute fort beau, reprit Plotine, mais s’il y a peu de gens qui sachent regretter leurs amis de cette manière, il y a aussi peu d’amis qui méritent d’être regrettés de cette sorte. »
Toute la compagnie étant demeurée d’accord de ce que disait Plotine, elle se sépara, parce qu’il était déjà assez tard. Le jour suivant, Valerius pour exécuter le dessein qu’il avait de faire voir au peuple qu’il n’appréhendait pas le succès de la guerre au sortir du sénat, fut voir travailler ceux qu’il employait à achever sa maison sur le mont Velie où il demeurait déjà, car il y en avait plus de la moitié où il n’y avait plus rien à faire, et pour exécuter son dessein il augmenta de la moitié le nombre de ceux qui avaient accoutumé d’y travailler. On ne voyait donc alors autre chose le long du chemin qui y conduisait, que des esclaves chargés qui allaient et venaient continuellement pour porter les choses nécessaires à ceux qui bâtissaient. Valerius crut même qu’en la conjoncture des affaires, il était bon de ne parler pas si tôt d’être un nouveau consul à la place de l’illustre Brutus, de peur que donnant une matière de contestation au sénat, il n’y eût quelque remuement qui pourrait avoir des suites dangereuses, lorsqu’on viendrait à savoir que Porsenna protégeait Tarquin. Il consulta même les plus sages de ceux qui avaient connaissance des affaires publiques, et ne fit que ce qu’ils lui conseillèrent de faire. Mais comme les règles de la prudence ne peuvent jamais être infaillibles lorsqu’on raisonne sur ce que le peuple fera ou ne fera pas, la sagesse et la vertu de Valerius ne furent pas assez fortes pour empêcher que ce qu’il faisait avec la meilleure et la plus innocente intention du monde, ne fût expliqué à son désavantage. En effet, cinq ou six jours après l’arrivée de Zenocrate, la nouvelle du retour d’Aronce à Clusium et de l’alliance de Tarquin avec le roi d’Étrurie y fut sue de tout le peuple qui au lieu de s’assurer sur la tranquillité qui paraissait en l’esprit de Valerius et sur les divers ordres qu’il avait donnés afin que les troupes fussent en bon état, commença de murmurer hautement. Il est vrai que quelques créatures de Tarquin servaient secrètement à irriter l’esprit de la multitude. Les uns disaient qu’il était aisé de connaître que Valerius pensait plus à lui qu’au bien public puisqu’il faisait une maison si magnifique, en un temps où la République naissante avait besoin que tous les Romains contribuassent une partie de leur bien pour soutenir les frais de la guerre. Les autres, qu’il paraissait bien qu’il avait plus haï le roi que la royauté, puisqu’il semblait avoir dessein de régner souverainement, qu’il ne parlait point de faire élire un autre consul, et qu’il faisait travailler avec plus de diligence qu’à l’ordinaire à une maison qui pourrait devenir une citadelle imprenable pour peu qu’il la voulût fortifier, à cause de sa situation avantageuse. « Enfin, disaient ces mutins, que sert-il de louer Brutus puisqu’on imite Tarquin, et de parler de liberté lorsqu’on aspire à la tyrannie ? »
| Poids | 230 g |
|---|---|
| Dimensions | 13 × 138 × 204 mm |
| Disponible | Oui |
| Genre | Récit historique, Roman |
| Version papier ou numérique ? | Version numérique (Epub ou PDF), Version papier |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.