clelie
5,99 € – 23,00 €
Clélie, histoire romaine – Tome 8/10 – Clymene
138 x 204 mm – 210 pages – Texte – Noir et blanc – Broché
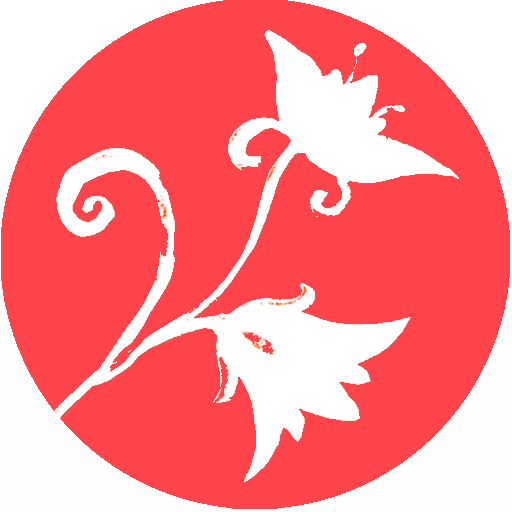
5,99 € – 23,00 €
Clélie, histoire romaine – Tome 8/10 – Clymene
138 x 204 mm – 210 pages – Texte – Noir et blanc – Broché
L’ensemble des 10 tomes de Clélie, histoire romaine, a été publié entre 1654 et 1660, signé par le frère de Madeleine de Scudéry.
Cette présente édition de 2022 rassemble le texte intégral de ce roman précieux publié en plein âge baroque. Seuls certains termes ont été actualisés et certains aspects de la structure du texte modernisés, restant au plus près du texte original tout en favorisant sa lecture.
![]()
Herminius qui était le plus exact de tous les hommes, ne manqua pas d’aller rendre compte à Valerius de ce qu’il avait appris d’Hortense. Il le trouva alors occupé à écouter un espion qu’on avait envoyé à Veies, qui rapportait que les Veientins naturellement scrupuleux et fort persuadés de la science de leurs devins, avaient de grandes espérances que leur ville serait un jour maîtresse de Rome, s’ils pouvaient conserver une figure de terre admirablement belle que Tarquin avait autrefois commandée à un fameux sculpteur de Veies, et qu’il avait eu dessein de mettre au haut du temple de Jupiter, quand il serait achevé. Ce qui avait donné lieu à cette superstitieuse opinion du peuple de Veies, était que l’artisan qui avait fait cette belle figure, disait que sans qu’il en pût comprendre la raison, cette figure était devenue plus grande qu’il ne l’avait formée depuis qu’elle était hors du moule où il l’avait jetée. Il assurait même qu’elle était devenue aussi dure que du marbre sans le secours du feu, si bien que les devins raisonnant à leur mode sur cet événement, avaient assuré que ceux qui auraient cette figure en leur puissance, seraient maîtres de leurs voisins. Valerius sachant donc cela, se résolut puisqu’il avait fait achever le temple de Jupiter depuis le départ de Tarquin, d’envoyer un héraut à Veies, sur le prétexte de demander cette figure, en offrant d’en payer le prix dont Tarquin était convenu avec le sculpteur qui la faisait. Ce n’est pas que Valerius crût que le bonheur de Rome dépendît d’une figure de terre, mais il fut bien aise d’avoir lieu d’envoyer à Veies, pour tâcher de délivrer Horace, qui était capable de bien servir Rome. Joint que Clelius le lui ayant recommandé, il ne voulait rien négliger pour cela, car encore qu’il fût ami d’Aronce, il savait bien qu’il ne le désobligerait pas en délivrant son rival, puisqu’il avait lui-même été assez généreux pour ne le découvrir point à Tarquin. Il consulta pourtant son dessein avec l’autre consul, qui l’approuva. On envoya donc à Veies, et on instruisit le héraut qui y fut, mais quoi qu’il pût offrir pour retirer la figure qu’il demandait, on ne la lui accorda point. Au contraire, la ville la paya à l’artisan qui l’avait faite, et les Veientins déclarèrent que cette figure ayant été commandée par Tarquin, ils ne la rendraient qu’à ce prince lorsqu’il aurait reconquis son État. Cependant, le héraut suivant ses ordres ayant fait savoir que celui qu’ils avaient envoyé à Rome et qui devait ensuite aller en Elide, était prisonnier, il les surprit fort et ils eurent tant d’envie de le délivrer, qu’ils offrirent de rendre plusieurs prisonniers pour celui-là. Si bien que ce héraut profitant de l’occasion et se servant de l’amitié que Mamilius avait pour le père de Clélie, il agit avec tant d’adresse qu’il fit en sorte qu’on rendit et l’esclave de Mamilius et trois autres pour ce Veientin qui avait été arrêté à Rome. Et en effet, la chose se fit ainsi, et elle se fit si promptement, qu’en trois jours cet échange fut fait. Ainsi, Horace retourna à Rome avec plus de joie qu’il n’en avait osé espérer car en y entrant, il sut que Clelius croyait qu’Aronce eût blessé Octave, que ce généreux rival était prisonnier à l’île des Saules, que l’amitié de Clelius pour lui reprenait de nouvelles forces, et que le second consul était son parent. Il est vrai que sa joie diminua dès qu’il vit Clélie, car il la trouva si froide, qu’il lui fut aisé de connaître que son retour l’affligeait. En effet, après qu’Horace eut été rendre grâces aux consuls des soins qu’ils avaient eus de le délivrer, il fut chez Clelius, qui après l’avoir embrassé le mena à la chambre de Sulpicie, où il le laissa, ne jugeant pas à propos de le mener à celle d’Octave qu’il savait bien qui ne l’aimait pas, de peur d’augmenter son mal qui était alors un peu diminué. Comme Sulpicie n’aimait point Horace, elle ne lui témoigna pas avoir une joie excessive de sa liberté, néanmoins, parce qu’elle respectait Clelius, elle le reçut fort civilement. Mais pour Clélie, la douleur parut dans ses yeux dès qu’elle vit Horace. Un moment après étant arrivé des dames qui occupèrent Sulpicie, il s’approcha de cette belle fille et lui parlant bas : « Je vois bien, Madame, lui dit-il, que ma liberté ne vous est guère agréable, et que si vos vœux avaient été exaucés, Aronce serait ici et je serais encore à Veies ! Mais après tout, quand vous saurez que je dois une seconde fois la vie à mon rival, vous serez peut-être assez généreuse pour ne désirer pas ma mort.
— Pour m’apprendre la générosité, reprit froidement Clélie, il faudrait que vous fussiez vous-même généreux et qu’ayant tant d’obligations à Aronce vous vous résolussiez courageusement à ne vouloir plus prétendre à mon affection, puisque je la lui ai donnée pour toute ma vie.
— Si l’on pouvait aimer sans désirer d’être aimé, Madame, répliqua Horace, je vous proteste qu’il n’est rien que je ne fisse pour faire ce que vous dites. Mais comme c’est une nécessité indispensable de désirer l’affection d’une personne qu’on aime, il ne m’est pas possible de renoncer à la vôtre et d’avoir cette espèce de reconnaissance pour un rival qui ne peut jamais être heureux. Et tout ce que je puis est de demeurer dans les bornes que je me suis prescrites, de n’entreprendre plus de le surpasser qu’en vertu. Pour vous témoigner que je n’agis plus comme un fier ennemi mais comme un amant généreux obligé à son rival, je vous déclare qu’il est digne de la gloire qu’il possède, qu’il vous aime autant qu’il peut aimer, quoiqu’il vous aime moins que moi, et que si la fortune était favorable à son amour, vous devriez le préférer à tout le reste du monde. Mais enfin, en l’état où sont les choses, il vous est aisé de juger que quand vous auriez absolument résolu de me laisser mourir misérable, il ne pourra jamais vivre heureux.
— Je ne sais sans doute pas, répliqua Clélie, quel sera le destin d’Aronce, mais je sais bien que si je ne puis être à lui, je ne serai jamais à personne.
— Ha ! Madame, lui dit-il avec une douleur extrême, laissez l’avenir dans le secret des dieux, contentez-vous de me dire que vous ne m’aimez pas, et d’ajouter même cruellement que vous aimez Aronce, mais ne prononcez pas un arrêt si cruel contre moi en faveur d’un rival qui comme je l’ai déjà dit, ne peut jamais être heureux, quand même je serais toujours misérable. Car enfin Madame, vous avez trop d’esprit pour ne connaître pas que Clelius ne donnera jamais sa fille au fils d’un protecteur de Tarquin, quand même Porsenna consentirait à l’amour d’Aronce, ce qui n’a aucune apparence. Pourquoi donc voulez-vous ôter l’espérance à un malheureux qui vous adore, qui se repent de ses premières violences, et qui demeure dans la résolution qu’il a prise de ne nuire jamais à son rival qu’en essayant d’être, encore s’il se peut, plus vertueux que lui ?
— Si vous êtes véritablement dans le dessein de me prouver votre amour par la grandeur de votre vertu, reprit Clélie, promettez-moi que vous ne tirerez point avantage de l’amitié que mon père a pour vous, et que s’il est jamais capable de vouloir me forcer à vous épouser, vous n’y consentirez point.
— Ha ! Madame, s’écria Horace, vous portez la cruauté trop loin et quoique je ne crois pas que je pusse jamais être capable de souffrir qu’on vous contraignît à me rendre heureux, je ne puis obtenir de moi de vous promettre de résister à Clelius s’il voulait que je le fusse.
— Ne me parlez donc jamais, reprit Clélie, si ce n’est en la présence de Clelius, et préparez-vous à être aussi haï de moi que vous l’étiez autrefois sur le lac de Trasimene.
— Et bien Madame, lui dit-il, je vous promettrai de ne vouloir jamais être heureux malgré vous. Mais promettez-moi aussi que vous endurerez que j’essaie de vous persuader qu’il y a une horrible injustice à vouloir que je ne puisse jouir d’un bien qui ne peut jamais être possédé par celui qui en est le plus digne.
— Je vous ai déjà dit une autre fois, reprit Clélie, qu’il est absolument impossible qu’il arrive jamais rien qui puisse vous rendre heureux, tant que mon affection sera nécessaire à votre félicité. Mais je veux encore vous le redire avec toute la sincérité d’une personne généreuse. Croyez donc bien fortement, que quand Aronce serait mort ou infidèle, ou que l’ambition me chasserait de son cœur, je ne pourrais jamais être capable d’une seconde affection. Je pourrais peut-être le haïr s’il m’avait trahie, ou du moins, avoir quelques sentiments de haine car ce sont deux choses différentes, mais pour aimer nul autre que lui, c’est ce qui ne peut jamais arriver. En effet, je crois que sans choquer l’innocence, on peut aimer une fois en sa vie de la manière que j’aime Aronce, mais pour les secondes affections, je vous le confesse Horace, je regarde avec mépris toutes celles qui en sont capables. Préparez-vous donc courageusement à n’être jamais aimé de moi, si ce n’est que vous vous contentiez de mon estime et de mon amitié, qui sont des choses que je puis partager entre toutes les personnes qui en sont dignes.
— Ha ! Madame, lui dit-il, pourquoi faut-il que vous me donniez tant d’admiration dans le temps que vous me donnez tant de douleur ? Mais enfin, ajouta-t-il, c’est en vain que vous voulez que je vous promette quelque chose, puisque je ne suis pas maître de mes propres sentiments et que je ne puis me tenir à moi-même les promesses que je me fais. Je change de résolution cent fois en une heure, je veux aimer, je veux haïr, je veux oublier, et après toutes ces agitations, je trouve toujours que tout ce que je sens n’est que de l’amour qui se déguise pour me tourmenter davantage. Laissons donc le soin de l’avenir à ceux qui en sont les maîtres, car enfin, Madame, vous savez ce que vous avez voulu et ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pourtant répondre de ce que vous voudrez un jour. Il arrive quelquefois des révolutions qui nous entraînent malgré nous où nous ne pensions jamais aller, et à parler raisonnablement, on ne peut prévoir nulle passion avec certitude. La haine, l’amour, la jalousie, la colère et l’ambition, naissent quand on ne les attend pas. Elles surprennent toujours tous ceux dont elles se rendent les maîtresses absolues et c’est principalement pour cette raison qu’il est si difficile de s’en défendre. Ne vous assurez donc pas tant Madame, de vos propres sentiments, et permettez-moi, du moins, de croire qu’il n’est pas absolument impossible que je puisse un jour être heureux car si je ne le croyais pas, la vertu m’abandonnerait peut-être si l’espérance m’avait abandonné. »
Clélie allait répondre lorsqu’on entendit un grand bruit dans la rue qui donnait au bout du pont Sublicien1, qu’on voyait de la maison de Clelius. Si bien que comme en temps de guerre toute sorte de bruit donne de la curiosité, les dames qui étaient chez Sulpicie voulant voir ce que c’était, interrompirent Horace et le forcèrent de regarder comme les autres, afin de savoir ce qui pouvait causer un si grand bruit parmi le peuple. À peine les fenêtres furent-elles ouvertes, qu’on vit sur le pont Sublicien un magnifique chariot dans lequel était un homme de fort bonne mine, habillé magnifiquement avec une couronne de myrte sur la tête, qui malgré toute la résistance de celui qui le conduisait, allait avec une telle violence, qu’il renversait tout ce qui lui voulait faire obstacle. Et en effet, passant avec impétuosité devant les gardes qui étaient au bout du pont, il fut rapidement jusque devant la porte de Clelius, où il versa. Par bonheur, celui qui en était le maître ne se blessa point et se dégagea de ce chariot, dont l’essieu se rompit en ce lieu-là. À peine Horace l’eut-il vu, qu’il le reconnut pour être un neveu de Mamilius chez qui il avait été captif à Veies, et qui était ami particulier de Clelius. Si bien que ne pouvant deviner quelle était cette aventure, ni souffrir de voir le parent d’un homme dont il avait été bien traité sans lui offrir de lui rendre office, il apprit à Sulpicie qui il était, et fut l’embrasser fort obligeamment, car durant le peu de fois qu’il avait été à Veies, il en avait été fort connu. En effet, Horace fut se faire connaître à ce jeune Veientin qui se nommait Telane, et l’amena à Sulpicie qui le reçut fort civilement. Comme il avait de l’esprit, il demanda pardon à ces dames de paraître devant elles avec une couronne sur la tête, et pour satisfaire la curiosité de la compagnie, il lui apprit, après qu’elle l’en eut prié, que ceux de Veies pour mieux témoigner qu’ils ne voulaient pas rendre aux Romains cette belle figure Tarquin avait fait faire pour mettre sur le haut du temple de Jupiter, l’avaient mise pour le principal prix, à une magnifique course de chariots qu’ils avaient faite hors de leur ville. Ensuite de quoi, la course s’étant faite et ayant remporté ce prix qu’on avait exposé au bout de la carrière pour exciter ceux qui avaient couru, comme il avait voulu aller faire prendre le prix de sa victoire après avoir été couronné, ses chevaux s’étaient effrayés d’une telle sorte, sans qu’il parût nulle cause de cet effroi, qu’ils l’avaient amené malgré lui jusqu’au lieu où son chariot s’était renversé, sans qu’il pût dire par quel miracle il ne s’était pas rompu devant que d’arriver à Rome. « Mais enfin, ajouta Telane à la fin de son récit, je ne me plains plus de mon aventure, puisque je suis arrivé en un lieu où je trouve tant de belles personnes et tant de civilité. »
Comme il parlait ainsi, Clelius entra, qui sachant que celui qu’il voyait était neveu de Mamilius, le reçu admirablement bien. En effet, il voulut qu’il logeât chez lui et donna ordre à ses gens d’avoir soin de son chariot. Cependant, comme il importait que les consuls sussent ce qui venait d’arriver, Horace s’en chargea, mais le lendemain au matin il vint un héraut de la part des Veientins, offrir aux Romains de rendre cette figure qu’ils avaient demandée car comme leurs devins étaient consultés sur toutes les choses qui leur arrivaient, l’aventure qui était arrivée à Telane qui n’avait pu jouir du prix de sa victoire, leur avait fait penser que les dieux s’irriteraient si on ne la rendait pas. Ayant été résolu qu’on ne rendrait Telane que lorsque cette figure serait apportée à Rome, il augmenta pour quelque temps la bonne compagnie qui était tous les jours chez Valerie, où Horace le mena. Comme il était jeune et galant, l’humeur de Plotine lui plut infiniment dès la première heure qu’il l’eut vue, et comme s’il y eût eu de la fatalité à vouloir que cette aimable fille vît tout ce qu’elle avait d’amants à la fois, Persandre qui était allé à Ardée quelques jours auparavant, en revint, et amena deux de ses amis qui étaient fort amoureux d’elle. Il arriva aussi à Rome un homme de Metapont, appelé Damon, qui l’aimait fort et qui en était devenu amoureux durant un séjour de six mois qu’il avait fait à Ardée. Mais pour celui-là, quoiqu’il eût de l’esprit, de la probité et de l’honneur, c’était un de ces gens de bon sens qui ne divertissent guère. Il était même de ceux qui en matière de religion aiment toutes les choses nouvelles ou extraordinaires, qui croient plutôt ce qui semble ne pouvoir être que ce qui est vraisemblable, et qui s’attachent fortement à défendre ce qu’ils n’entendent point seulement parce qu’ils se sont imaginé qu’ils l’entendent. En effet, cet homme avait si ardemment embrassé l’opinion de Pythagore, qu’il tenait pour extravagants ceux qui ne croyaient pas que les âmes ne faisaient continuellement que changer de corps. Si bien qu’Amilcar voyant quatre rivaux tout à la fois à l’entour de sa maîtresse, ne fut pas sans occupation. Il se démêla pourtant bien mieux qu’un autre de cet embarras, qui contribua à rendre la conversation encore beaucoup plus agréable qu’à l’ordinaire, car un des amants de Plotine qui se nommait Acrise, était un homme qui parlait plus que nul autre n’a jamais parlé. Sicinius ne parlait presque point, Telane parlait agréablement de tout, et Damon aimait fort à parler de la secte dont il était. De sorte que quand Amilcar trouvait tous ses rivaux auprès de Plotine, il n’y en avait pas un de qui la conversation ne fût divertissante de la manière dont Amilcar la tournait. Et quand ils n’y étaient pas, il s’en divertissait encore admirablement, tantôt en contrefaisant le silence de l’un, tantôt en voulant parler trop comme l’autre, et tantôt en examinant plaisamment toutes les opinions de la nouvelle secte de Pythagore. Si bien que par là, il nuisait à ses rivaux, il divertissait sa maîtresse, et ne s’ennuyait jamais.
Un jour entre les autres, Acrise parla tant et dit tant de choses inutiles, et Sicinius parla si peu, qu’ils importunèrent tous deux car comme ils étaient venus l’un après l’autre chez Plotine, elle se plaignit agréablement à Amilcar qui arriva chez elle, après qu’ils furent partis. « De grâce, lui dit-elle dès qu’elle le vit, promettez-moi deux choses que j’ai à vous demander. L’une est que vous ne parlerez pas tant que je ne puisse dire un mot si j’en ai envie, et l’autre que je ne serai pas obligée de parler toujours et que vous vous mêlerez quelquefois dans mon discours, car j’ai vu deux hommes aujourd’hui dont l’un ne m’a pas laissé dire une parole, et l’autre ne m’en a pas dit quatre.
— Je devine aisément, répliqua Amilcar, qu’Acrise et Sicinius vous sont venus voir. Mais aimable Plotine, ajouta-t-il, puisque vous venez d’éprouver ces deux sortes de défauts, dites-moi lequel est le plus insupportable afin que je sache lequel je dois le plus éviter.
— Je vous assure, reprit-elle, qu’ils m’ont fort importunée tous deux car c’est une chose fort incommode de voir mourir la conversation à tous les moments. Pour moi, ajouta-t-elle en riant, j’aimerais autant avoir soin d’entretenir le feu sacré des Vestales, que d’avoir à entretenir ces gens qui ne fournissent rien à la conversation, à qui il faut toujours dire choses nouvelles, qui sont même ennemis des longues paroles, qui ne disent presque jamais que oui et non, et qui même pour s’épargner quelquefois la peine de prononcer une syllabe, font un petit signe de tête pour témoigner qu’ils vous entendent. Tout de bon, poursuivit Plotine, je ne sais rien de plus ennuyeux que cette espèce de profond silence qui revient de moment en moment entre deux personnes, dont il y en a une qui parle trop peu. Le silence en toute autre occasion a quelque chose de doux, mais en celle-là il importune, et il n’y a point de bruit si fâcheux qui ne me plaise davantage.
— Sérieusement, reprit Amilcar, le bruit de ceux qui parlent trop est bien aussi importun que le silence de ceux qui ne parlent guère et si vous y voulez bien songer, vous le trouverez pour le moins aussi incommode ! Car enfin, y a-t-il rien de plus fâcheux que d’entendre ce grand nombre de choses fausses et inutiles que disent tous les grands parleurs ? Je présuppose hardiment que dès qu’on parle beaucoup, on dit des mensonges et des choses qui ne servent à rien. Et ce qu’il y a de plus incommode, c’est que ces gens-là dans le même temps qu’ils font de longs récits dont on se passerait bien, empêchent les autres de dire des choses que l’on voudrait bien savoir. En effet, ajouta Amilcar, Acrise, Sicinius, Telane et moi, étions hier ensemble au bord du Tibre, et comme Telane qui est curieux me demanda précisément en quel lieu les fondateurs de Rome avaient marqué la première enceinte de leur ville, dès que je voulus lui répondre et commencer de parler en disant “Romulus”, Acrise m’interrompit et sept fois de suite, comme le meilleur écho du monde, je recommençais de parler et de dire “Romulus” sans pouvoir achever de répondre à Telane, qui ne pouvait s’empêcher de rire de mon opiniâtreté et de ma patience. Mais à la fin, il fallut céder à Acrise, et se résoudre à l’écouter, quoiqu’il dît des choses dont on se pouvait passer toute sa vie, car outre que comme je l’ai déjà dit, ceux qui parlent trop sont sujets à dire des mensonges ou des choses inutiles, ils disent même encore des choses fâcheuses. Car le moyen de n’en dire pas quand on n’a point assez de jugement pour laisser parler ceux avec qui l’on est, et pour ne connaître point que la société doit être libre, qu’il ne doit point y avoir de tyrannie dans la conversation, que chacun y a sa part et a droit de parler à son tour, et qu’enfin ce ne peut jamais être que par l’attention de ceux qui écoutent, que ceux qui parlent bien ont droit de parler plus que les autres. »
Comme Amilcar disait cela, Valerie et Cefonie entrèrent. Un moment après, Herminius, Horace et Zenocrate vinrent aussi, si bien que Plotine voyant tant de gens capables de juger du sujet de sa conversation avec Amilcar, leur dit l’ennui qu’elle avait eu de s’être trouvée avec Acrise qui parlait trop, et avec Sicinius qui parlait trop peu, les priant ensuite de vouloir dire leur avis sur ces deux défauts. « Pour moi qui suis paresseuse, dit Valerie, je pense que j’aimerais encore mieux parler trop peu, que parler trop.
— Vous avez raison, ajouta Cefonie, car encore qu’on accuse en général les femmes d’aimer parler beaucoup, je trouve qu’une trop grande parleuse est plus importune qu’un trop grand parleur. En effet, quand les femmes parlent trop, pour l’ordinaire leur conversation n’est qu’un torrent de bagatelles et de paroles superflues qui ennuient fort ceux qui ont l’esprit un peu raisonnable.
— Pour moi, reprit Amilcar en souriant, je ne suis pas de votre avis, car quand une grande parleuse est jeune et belle, qu’elle ne fait point de grimaces en parlant, et qu’au contraire elle montre des dents bien blanches et des lèvres incarnates, je l’écoute avec moins de peine, qu’un de ces grands parleurs à mine audacieuse et insolente qui ennuient autant les yeux que les oreilles.
— En mon particulier, dit Herminius qui ne hait pas trop quelquefois à ne rien dire, j’avoue que je ne voudrais pas être un grand parleur, mais en autrui je m’accommoderais mieux d’un homme qui parlerait toujours beaucoup, que d’un homme à qui il faudrait toujours beaucoup parler.
— Je vous assure, reprit Horace, qu’encore que tout le monde parle, peu de gens savent comment il faut parler,
— Vous avez sans doute raison, répliqua Herminius, et je soutiens même qu’il n’y a presque rien dont les hommes demeurent d’accord, si ce n’est que la santé est un bien. La beauté même n’est pas sans contestation ; les richesses sont regardées comme des choses nuisibles, les sciences sont mises par quelques-uns au rang des choses douteuses et la médecine, qui n’a pour objet que de donner la santé et de prolonger la vie est encore regardée par certains peuples, comme un art dangereux qui fait plus de mal que de bien, tant il est vrai qu’il y a de faiblesse et d’incertitude dans l’esprit des hommes. Les uns approuvent ce que les autres condamnent, et il n’y a presque rien qui soit loué par quelqu’un sans être blâmé par quelque autre. Ainsi, les uns croient que parler peu est un défaut, les autres que parler beaucoup est une perfection, quelques-uns que parler éloquemment est dire de grandes paroles, les autres que parler bien est parler naturellement et juste, quelques-uns qu’il faut des paroles choisies, quelques autres qu’il faut parler négligemment pour fuir l’affectation, sans penser que la négligence affectée est la plus mauvaise de toutes. Il y en a même qui croient que pour bien parler, il faut parler comme un livre et il s’en trouve qui pour éviter ce défaut-là qui est sans doute très grand, parlent aussi grossièrement que le peuple sans considérer que tout excès est également mauvais, et que s’il est dangereux de parler trop bien, il l’est aussi de parler trop mal. Mais à mon avis, il y a une chose dans le langage qui est généralement blâmée de tout le monde, qui est le galimatias et l’obscurité, puisqu’il est vrai que quiconque écoute veut entendre ce qu’on lui dit, et que quiconque parle est obligé de se faire entendre.
— Herminius a sans doute raison, reprit Zenocrate, lorsqu’il dit que les faiseurs de galimatias sont condamnés par tout le monde.
— Il y en a pourtant beaucoup, reprit Plotine, mais ce qui m’étonne le plus est que je connais de plusieurs sortes de gens qui en sont capables et que je connais même des gens qu’on ne peut pas dire qui soient absolument sans esprit.
— Cela est sans doute ainsi, répliqua Herminius, et cela vient de ce qu’il y a de plusieurs sortes de galimatias.
— Mais pourrez-vous bien me dire clairement, reprit Plotine, pourquoi des gens qui ont quelque sorte d’esprit, ne s’expliquent pas nettement et sans embarras ?
— Ce sont sans doute, répliqua Herminius, de ces gens qui pensent quelquefois à peu près ce qu’il est à propos de penser, mais de qui les paroles embrouillent si fort les pensées, qu’on ne peut deviner ce qu’ils veulent qu’on entende.
— Il y en a d’autres, reprit Zenocrate, qui ne s’expliquent mal que parce qu’ils ne s’entendent pas eux-mêmes. Ainsi ils cherchent non seulement les paroles qu’ils veulent dire, mais encore les choses qu’ils veulent penser.
— Vous voyez donc bien, répliqua Herminius, que j’ai raison de soutenir qu’il y a des galimatias de plusieurs espèces. En effet, ces gens dont j’ai parlé les premiers, ne sont obscurs dans leurs discours que parce qu’ils ne choisissent pas bien les paroles qui pourraient exprimer leurs pensées, et les seconds dont Zenocrate vient de parler ne le sont que parce que leurs pensées étant confuses, il n’y a point d’expression qui leur convienne, ni qui les puissent bien faire entendre. Il y a même plusieurs sortes de galimatias innocents, s’il est permis de parler ainsi, dont quelques-uns peuvent être corrigés. En effet, je connais de ces gens qui pour montrer qu’ils ont une imagination vive et prompte, ne donnent pas loisir à ceux qui leur parlent, d’achever ce qu’ils veulent dire. Si bien que se mêlant mal à propos de deviner, ils coupent la parole à ceux qui parlent, et parlant eux-mêmes avec précipitation, on peut dire qu’ils parlent devant qu’on leur ait rien dit, puisqu’à parler raisonnablement une personne qui n’a pas achevé de dire tout ce qu’elle veut, n’a encore rien dit sur quoi on puisse s’assurer de répondre à propos, parce que bien souvent les dernières paroles d’un discours en renversent le commencement. Aussi arrive-t-il presque toujours que ces gens qui interrompent si brusquement les autres et qui veulent deviner hors de saison, disent des choses sans nul sens et font un galimatias étrange, quoique d’ailleurs ils aient l’esprit fort droit.
— Pour moi, dit Valérie, je connais des diseurs de choses obscures qui ne le sont que parce qu’ils ont l’esprit distrait, et que n’écoutant pas bien ce qu’on leur dit et ne voulant pas laisser de répondre par habitude, ils le font pour l’ordinaire fort mal,
— Il y a aussi certains faiseurs de galimatias, reprit Horace, qui ne le font que parce qu’ils veulent toujours faire les fins, et qu’ils s’imaginent que pour être crus habiles, il ne faut jamais parler clairement.
— Pour moi, dit Amilcar, je sais qu’il y a des hommes et des femmes à qui l’on entend quelquefois dire des choses qui n’ont point de sens, seulement parce qu’ils veulent être des premiers à se servir de ces paroles nouvelles venues que le hasard introduit, que le caprice du monde fait recevoir, et que le temps et l’usage autorisent quelquefois car ces gens-là ne sachant pas la véritable signification de ces mots à la nouvelle mode, les placent mal à propos et disent bien souvent le contraire de ce qu’ils veulent dire,
— Il y en a encore d’autres, reprit Herminius, qui ne savent ce qu’ils disent, parce qu’ayant résolu de parler hardiment de tout, quoiqu’ils ne sachent rien, ils se hasardent avec un esprit très médiocre de parler de certaines choses, dont on ne peut presque jamais bien parler si on ne les a apprises. Cependant, il y a beaucoup plus de honte à faire le capable mal à propos, qu’à se taire judicieusement et qu’à avouer qu’on ne sait rien aux choses dont on parle.
— De grâce, dit alors Plotine, laissons-là ces faiseurs de galimatias qui ne sont pas dignes d’occuper l’esprit de tant de gens qui parlent si clairement et parlons seulement, je vous prie, de ceux qui parlent trop ou trop peu, car pour moi, je vous le confesse, il me semble que les derniers s’ennuient tant en ennuyant les autres, que j’aimerais mieux parler trop que parler trop peu, puisque du moins en importunant mes amis je me divertirais moi-même.
— Quoiqu’il ne semble pas, répliqua Herminius, que l’on puisse être d’un avis contraire au vôtre sans prendre un mauvais parti, je ne laisse pas de dire encore une fois que j’aimerais mieux parler trop peu que parler trop, et que pourtant j’aimerais quelquefois mieux la conversation d’un grand parleur, que celle d’un homme qui ne parlerait presque point. Car enfin, il peut arriver souvent qu’un homme qui ne parle guère a du bon sens, mais il ne peut presque jamais arriver qu’un homme qui parle trop ait du jugement.
— Vous avez raison, reprit Amilcar, mais il n’arrive aussi pas souvent que ces gens qui ne parlent presque point aient beaucoup d’esprit, et il arrive assez souvent que les gens qui parlent trop en ont assez, car pour moi, je suis persuadé que l’esprit est comme le feu et qu’il faut absolument qu’il paraisse de quelque manière que ce soit quand il y en a.
— L’on a pourtant vu de grands hommes, répliqua Horace, qui n’ont pas aimé à parler,
— Il est vrai, reprit Herminius, mais ils ont fait voir leur esprit par leurs écrits, ou par leurs actions s’ils ne l’ont pas montré par leurs paroles, car je suis en effet persuadé, aussi bien qu’Amilcar, que l’esprit ne peut être absolument caché, et qu’il faut nécessairement qu’il se montre. On pourra pourtant voir de grands princes, de grands philosophes, de grands poètes, de grands peintres, et d’excellents artisans, qui parlent peu mais leurs actions ou leurs ouvrages parleront pour eux, et feront voir que leur silence n’est pas un silence de stupidité. Il n’en est pas de même de ces gens de qui l’esprit n’est qu’en paroles et qui ne s’occupent jamais qu’à parler, car je suis assuré que leurs actions, pour l’ordinaire, ne disent rien à leur avantage.
— Mais, répliqua Zenocrate, encore tous les gens qui ont du jugement ne sont-ils pas si grands amis du silence.
— Je ne vous dis pas, reprit Herminius, que tous ceux qui parlent beaucoup n’ont point de jugement, car je ferais injustice à trop d’honnêtes gens, mais seulement que ceux qui parlent trop, n’en peuvent avoir.
— Croyez-moi, répliqua Plotine, qu’entre parler beaucoup et parler trop, il y a souvent peu de différence à faire.
— La libéralité et la prodigalité se ressemblent en quelque sorte, répondit Herminius, cependant on distingue fort bien que l’une est un vice, et l’autre une vertu, ainsi on peut assez aisément distinguer celui qui parle beaucoup et bien, de celui qui parle trop et qui parle mal, ou du moins mal à propos.
— Mais, reprit Valerie, n’y a-t-il pas des gens qui parlent trop, qui ne laissent pas de parler bien ?
— Il y en a sans doute, répondit Amilcar, et j’ai connu un Grec en Sicile qui parlait avec toute la pureté attique, qui ne laissait pas d’importuner parce qu’il parlait plus qu’il ne devait. Car à définir un homme qui parle trop, c’est principalement par le petit nombre de choses, et par le grand nombre de paroles qu’il dit, qu’on le peut connaître, c’est par le peu de nécessité qu’il a de parler sans cesse, c’est par l’empressement qu’il a de dire son avis de tout, de couper la parole à tout le monde, d’épuiser un sujet dont il parle, de parler toujours sans songer même quelquefois si on l’écoute et de ne pouvoir se taire quoiqu’il soit avec des personnes de plus de qualité que lui ou de plus de capacité. Ce n’est pas que je ne crois que ceux qui parlent beaucoup ne soient quelquefois exposés, quoiqu’ils parlent bien, à importuner des gens qui aiment à parler aussi bien qu’eux, mais enfin, comme cela ne se rencontre pas toujours, il ne faut pas pour la commodité d’un petit nombre de personnes, condamner des gens qui parlent beaucoup et bien, et qui donnent mille plaisirs par leur conversation parce qu’ils ne disent jamais rien qui ne soit nécessaire ou agréable. En effet, quand un homme aime à parler seulement parce que la nature lui a donné la facilité de s’exprimer, qu’il a l’esprit étendu, l’imagination vive, la mémoire remplie de mille choses choisies et raisonnables, que son jugement est maître de son esprit et de son imagination, et que sa conversation a le véritable air du monde, il peut sans doute parler beaucoup sans parler trop car je suis assuré que si cet homme est tel que je le dis, il saura se taire toutes les fois qu’il le voudra, qu’il laissera parler tous ceux qui en auront envie, et qu’il ne fera pas comme un grand parleur que je trouvai en abordant à Syracuse, à qui je voulus commencer de conter un grand péril que j’avais couru sur la mer, par une tempête qui s’était élevée et dont il m’avait prié de lui faire le récit car à peine eus-je commencé de lui dire que la mer s’était émue tout d’un coup, que me coupant la parole, – Cela me fait souvenir, me dit-il, d’une fois que je voyageais sur la mer, que pareille chose m’arriva. Car imaginez-vous, ajouta-t-il sans se souvenir de ce qu’il m’avait demandé, qu’après m’être embarqué à Tarente dans un fort bon vaisseau dont le pilote était de Cumes et qui était chargé de plusieurs marchandises, car Tarente est une ville puissante et riche où il se fait un grand commerce de toutes sortes de choses, le vent s’étant changé tout d’un coup, le vaisseau fut contraint de demeurer encore quinze jours au port de Tarente où il m’arriva une assez plaisante aventure. Lorsque je m’étais embarqué, j’avais dit adieu à une assez belle femme à qui j’avais dit quelques douceurs durant quelque temps et qui à ma considération avait banni de chez elle un amant qu’elle avait, devant que je fusse le sien. Mais comme elle croyait que je fusse parti la nuit, le lendemain quand je me débarquai et que je fus pour lui dire que j’aurais encore quelques jours le plaisir de la voir, je la trouvai qui riait de fort bon cœur avec mon ancien rival quoiqu’elle m’eût dit adieu avec des larmes. Si bien que la colère me prenant, je querellai le rival et la maîtresse. La colère me guérit de ma passion et au sortir de cette visite j’en fis une autre où je devins amoureux d’une jolie fille, avec qui je fis galanterie, et pour qui j’eus tant d’amour, que je laissai partir le vaisseau dans lequel je m’étais embarqué, avec intention de partir. – Mais, lui dis-je en l’interrompant à mon tour, quand vous m’aviez interrompu je pensais que c’était pour me représenter quelque tempête qui ressemblât à celle que vous voulez que je vous décrive, et cependant après vous être embarqué, je vous revois à terre, engagé à faire l’amoureux. – Donnez-vous patience, me dit-il, nous n’y sommes pas encore. Et en effet, j’en eus grand besoin car par cette prodigieuse envie qu’il avait de parler toujours et de ne laisser parler personne, il me conta tout ce qui lui était arrivé de plus particulier dans sa nouvelle amour. Il me fit voir des lettres de sa maîtresse, il me récita des chansons, il se rembarqua encore une fois, et fit un voyage sans tempête, devant que de venir à me dire celui où en effet il avait pensé périr. Ainsi, cet homme qui avait eu dessein de savoir comment j’avais pensé faire naufrage, n’en sut rien, et m’apprit cent choses dont je n’avais que faire. Cependant, il parlait juste, et supposé qu’il eût été à propos de me faire savoir tout ce qu’il m’apprit, on eût pu dire que cet homme eût admirablement bien parlé. Mais comme je n’avais que faire de tout ce qu’il me disait, que je n’avais encore conté qu’une fois ou deux le péril que j’avais couru, et qu’il est assez naturel à tout le monde d’aimer à raconter une tempête dont on est échappé depuis peu, je souffris plus que vous ne pouvez vous imaginer et son éloquence m’importuna si fort, que si je n’eusse pris le parti de me moquer de lui en secret durant qu’il parlait, je me serais mal diverti.
— Vous avez fait ce récit-là si plaisamment, reprit Plotine en riant, que ce serait dommage qu’il n’y eût jamais eu de gens qui eussent trop parlé, et ce qu’il y a de bon, ajouta-t-elle en raillant, c’est qu’en contrefaisant un homme qui parle beaucoup, vous ne vous contraignez pas autant qu’un autre.
— Il est vrai, répliqua Amilcar en la regardant avec beaucoup d’amour, que je parle quelquefois assez volontiers, mais pour prouver à toute la compagnie que je sais m’empêcher de parler quand je le veux, je n’ai qu’à lui apprendre que je vous ai aimée plus de huit jours sans vous le dire, quoique j’en eusse envie à tous les moments.
— De grâce, reprit Plotine, ne changeons point si tôt de discours, et ne nous amusons pas à dire des folies qui ne sont guère plus nécessaires à la compagnie, que le récit des aventures de votre Grec vous l’était. Car comme je ne hais pas trop à parler, et que c’est une des choses du monde qu’on fait le plus souvent, je ne serais pas trop marrie qu’on me fît bien entendre comment il faut parler pour parler bien.
— Premièrement, dit Amilcar en souriant, il faut avoir bien de l’esprit, assez de mémoire, et beaucoup de jugement. Ensuite, il faut parler le langage des honnêtes gens du pays où l’on est, et fuir également celui du peuple bas et grossier, celui des sots beaux esprits, et celui qu’ont certaines gens qui tenant un peu de la Cour, un peu du peuple, un peu du siècle passé, un peu du présent, et beaucoup de la ville, est le plus bizarre de tous.
— Mais, dit Plotine, encore ne trouvai-je pas que ce soit assez, car vous dites bien comment il ne faut pas parler, mais vous ne dites pas précisément comment on peut bien parler.
— Je vous assure, reprit Horace, qu’on a qu’à parler comme vous faites pour parler juste et agréablement.
— En effet, ajouta Herminius, l’aimable Plotine parle comme il faut qu’une femme raisonnable parle pour parler agréablement, car toutes ses expressions sont nobles et naturelles tout ensemble. Elle ne cherche point ce qu’elle dit, il n’y a nulle contrainte en ses paroles, son discours est clair et facile, il y a un tour galant à ses manières de parler, nulle affectation au son de sa voix, beaucoup de liberté en ses actions, et un merveilleux rapport entre ses yeux et ses paroles, qui est une chose qui contribue à rendre le parler plus agréable.
— Mais comment tout ce que vous dites pourrait-il être en moi, répliqua Plotine, qui ne pense presque jamais à ce que je dis ?
— Si vous y pensiez plus attentivement, reprit Zenocrate vous ne parleriez pas aussi agréablement que vous parlez, car dès qu’on y pense tant, on ne dit plus rien qui vaille.
— Mais, interrompit Cefonie, encore voudrais-je bien savoir quelle doit être la différence qu’il faut qu’il y ait entre un homme qui parle bien et une femme qui parle bien, car encore que je sache de certitude qu’il doit y en avoir, je ne sais pas précisément en quoi elle consiste. On se sert des mêmes paroles, on parle quelquefois des mêmes choses et l’on a même assez souvent des pensées qui se ressemblent. Cependant comme je l’ai déjà dit, il ne faut pas qu’une honnête femme parle toujours comme un honnête homme, et il y a certaines expressions dont les uns se peuvent servir à propos et qui feraient de mauvaise grâce aux autres.
— En effet, reprit Plotine, il y a certaines choses qui sont tout à fait bizarres en la bouche d’une femme, qui ne surprennent pas en celle d’un homme. Car par exemple, si j’allais jurer par le feu sacré ou par Jupiter, j’épouvanterais ceux à qui je parlerais. Si j’allais juger décisivement de quelque question difficile, je passerais pour ridicule si j’affirmais seulement ce que je dis d’un ton de voix trop ferme et trop fier. On douterait si je mériterais le nom de fille si je parlais de guerre comme un tribun militaire, et toutes mes amies se moqueraient de moi. Cependant il faut bien parler, et il faut même se garder de tomber dans un autre défaut, qui est celui de parler avec une certaine simplicité affectée qui sent l’enfant, et qui sied fort mal. Il ne faut pas non plus parler étourdiment, mais il faut encore moins s’écouter parler comme font certaines femmes, qui écoutent effectivement le son de tous les mots qu’elles prononcent comme elles écouteraient celui d’une lyre qu’elles voudraient accorder, et qui d’un certain ton de suffisance disent souvent de fort mauvaises choses, avec de fort belles paroles.
— Ce que dit l’aimable Plotine, reprit Amilcar, est admirablement bien dit mais pour parler d’un défaut qui convient également aux hommes et aux femmes, c’est qu’il se faut garder soigneusement d’un certain accent populaire qui rend les plus belles choses désagréables, car je soutiens qu’il vaut sans comparaison bien mieux que j’aie un petit accent africain en parlant le langage de Rome, que si j’avais un bizarre accent qui est particulier aux plus vils artisans. En effet, j’avance hardiment qu’il n’y a point de lieu au monde où il n’y ait de la différence entre l’accent des honnêtes gens et celui du peuple, et j’ajoute ensuite qu’un étranger n’est point blâmable de conserver celui de son pays, et qu’un homme ou une femme de qualité, le sont s’ils parlent comme leurs esclaves car pour moi qui ai le goût délicat pour toutes choses, je suis sensiblement touché du son de la voix, d’un accent doux et pur et de je ne sais quoi de noble, que je trouve en la prononciation de certaines personnes que je connais, et principalement en celle de la charmante Plotine,
— Mais de grâce, dit alors Cefonie, dites-moi ce que peuvent faire ceux qui ne parlent pas comme Plotine, afin d’acquérir ce qu’elle a de bon, et de perdre ce qu’ils ont de mauvais.
— Aimer les honnêtes gens, reprit Herminius, et n’en voir guère d’autres car enfin, il n’appartient point aux livres d’apprendre à parler, et ceux qui se contentent de lire pour être propres à la conversation, s’abusent étrangement et ne savent pas à quoi la lecture est bonne. Elle est sans doute nécessaire à parer l’esprit, à régler les mœurs, et à former le jugement, elle peut même servir à apprendre une langue, mais pour l’agrément du langage, la conversation toute seule le peut donner, encore faut-il que ce soit une conversation de gens du monde, dont les femmes fassent la plus grande partie, autrement il y aurait quelque chose de trop élevé, de trop savant, de sec, de rude ou d’affecté, à ceux qui voudraient régler leurs façons de parler par ce qu’ils lisent. Car comme ordinairement les livres ne parlent pas comme les gens parlent en conversation, il ne faut pas non plus parler en conversation comme les livres.
— Tout de bon, dit Plotine, je m’étonne que tout le monde ne songe à apprendre à bien parler, puisqu’il n’y a ce me semble rien de plus aisé à faire, que d’être toujours avec de fort honnêtes gens, car pour toutes les autres choses il n’en est pas de même quand on les veut apprendre. Au contraire, il est quelquefois assez importun d’avoir à entretenir ceux qui montrent à chanter, à peindre, à danser, mais puisque pour bien parler, il ne faut faire autre chose que de voir des gens du monde et des gens qui parlent agréablement, je fais vœu d’apprendre toute ma vie à parler, et de n’en voir jamais d’autres volontairement.
— C’est plutôt aux autres à vous chercher, répliqua Zenocrate, qu’à vous à chercher les autres,
— Vous avez raison, reprit Amilcar, mais il y a une autre sorte de chose que l’aimable Plotine aurait besoin d’apprendre, qui est d’écouter un peu plus favorablement ce que je lui dis quelquefois.
— Pour celle-là, répliqua-t-elle, on ne l’apprend que trop tôt mais il y en a une autre que je voudrais que l’on apprît à tous ceux qui ne la savent pas, qui est de penser à ce qu’on leur dit et de n’aller pas rêver hors de propos en compagnie. Pour une petite distraction, ajouta-t-elle, je la pardonne, mais pour cet enchaînement de rêveries continuelles qu’ont certaines gens qui ne sont jamais où on les voit et qui ne sont même jamais en nulle part, je trouve qu’il est bon de s’en corriger. Car quand on a tant de choses à penser qui valent mieux que ce que l’on entend dire, il faut demeurer dans son cabinet à s’entretenir soi-même, puisqu’il y a sans doute de l’incivilité à n’écouter point du tout ce que l’on dit au lieu où vous êtes, et à compter pour rien la compagnie où l’on est, et pour moi, je suis persuadée qu’il n’y a que le murmure d’un ruisseau et le bruit d’une fontaine qu’on puisse écouter civilement en rêvant.
— Quoique vous en puissiez dire, reprit Amilcar, la liberté de rêver est une douce chose et si vous voulez y prendre garde, il y a partout certaines maisons qu’on trouve beaucoup plus agréables que d’autres, seulement parce que ceux qui en sont les maîtres, n’y contraignent personne. En effet, on y rêve, on y parle, on y rit, on y chante, on s’y entretient avec qui l’on veut, l’on y entre et l’on en sort sans rien dire, et l’on y est enfin avec une liberté qui a quelque chose de si doux qu’on les préfère à beaucoup d’autres.
— Quoiqu’il en soit, reprit Plotine, je m’en tiens à ce qu’Herminius a dit car sans tant apprendre de choses, il me sera bien plus commode de ne voir que de fort honnêtes gens. Aussi suis-je résolue de n’en voir plus d’autres si je le puis.
— Vous avez bien fait d’ajouter ces derniers mots, répliqua Amilcar, car de la manière dont le monde est fait, il est assez difficile de ne voir que d’honnêtes gens. »
À peine eut-il achevé ces paroles, qu’on vint avertir Herminius que Valerius le demandait pour quelque affaire pressée. On vint aussi dans le même temps dire à Horace, que le second consul qui était son parent, avait besoin de lui, si bien que cette aimable compagnie se sépara, car Valerie ayant quelque curiosité de savoir ce que son père voulait à Herminius, s’en alla bientôt, et Amilcar et Zenocrate se retirèrent ensuite et laissèrent Cefonie et Plotine toutes seules. Cependant, ils ne furent pas plutôt dans la rue, qu’ils rencontrèrent Émile qui leur dit qu’il était venu un homme de Clusium qui avait apporté quelque nouvelle qui obligeait les consuls d’assembler le sénat extraordinairement. Et en effet, c’était un envoyé d’Artemidore, qui avertissait Valerius qu’on parlait déjà de faire des levées dans les États du Roi d’Etrurie, et de faire avancer les troupes de Veies et de Tarquinies. On disait même que la Reine Galerite, accompagnée de la Princesse des Leontins, était allée à l’île des Saules où l’on avait mis Aronce, afin de lui persuader d’obéir aveuglement à Porsenna, et qu’on ne doutait nullement qu’il ne le fît, n’ayant nulle apparence qu’il pût refuser de porter les armes contre tous ceux que le Roi son père, déclarerait tenir pour ennemis. Si bien que Valerius sachant la chose comme elle était, jugea qu’il était à propos de s’aller emparer d’un passage important et d’y faire construire un fort, devant que les ennemis eussent eu le temps de s’apercevoir combien il leur était nécessaire d’en être maîtres. Mais comme le second consul était autant dans les intérêts d’Horace, que Valerius était dans ceux d’Aronce, quoiqu’ils cherchassent tous deux le bien public il y avait entre eux quelque disposition à se quereller facilement. Valerius connaissant parfaitement combien il importait qu’il n’y eût point de division entre eux voulut éviter une contestation qui eût pu nuire aux affaires générales. Pour cet effet, s’agissant de deux choses importantes tout à la fois, dont l’une était de savoir qui des deux consuls irait commander les troupes destinées à s’emparer de ce passage difficile qui était entre Rome et Clusium, et l’autre de savoir si ce serait le consul Horace ou Valerius qui dédirait le temple de Jupiter, Valerius proposa d’en remettre la décision au caprice du sort, voyant que la chose pressait, car le peuple s’imaginait que tout irait mal si le temple n’était pas dédié, et les gens habiles voyaient bien qu’il était nécessaire de s’emparer d’un lieu qui pourrait empêcher que les ennemis ne pussent venir sitôt assiéger Rome, et donner, par conséquent, loisir de la fortifier. Aussi, était-ce pour parler de cette affaire que Valerius avait envoyé quérir Herminius et que le second consul avait voulu parler à Horace. Valerius eût bien voulu demeurer à Rome où il croyait que sa présence était nécessaire mais comme la dédicace du temple de Jupiter était un honneur que son collègue désirait avec une passion démesurée, il mit la chose au pouvoir du sort, qui en décida en faveur du second consul. De sorte que Valerius fut obligé d’aller commander l’armée pour cette expédition secrète que l’on jugeait si nécessaire. Horace tout amoureux qu’il était, le voulut accompagner et ne voulut pas demeurer paisible spectateur de la dédicace d’un temple, pendant qu’il y aurait des troupes en campagne. Themiste, Herminius, Amilcar, Zenocrate, Émile, et tous les autres amis de Valerius eussent bien voulu faire la même chose, mais il jugea qu’il lui était nécessaire que ses véritables amis demeurassent à Rome pendant son absence. Joint que ce qu’il allait entreprendre se devant exécuter par surprise, il ne jugeait pas qu’il eût besoin de tant de braves gens pour cela. Il consentit pourtant que Mutius fût avec lui, car sachant combien il avait l’humeur impérieuse, et quelle était sa passion pour Valerie, il était toujours bien aise de le séparer d’Herminius et d’Émile qu’il aimait fort. Pour Spurius il demeura à Rome à importuner Valerie. Themiste y demeura aussi de peur que si le Prince de Messene l’y venait chercher, il ne s’imaginât qu’il avait voulu fuir. Meleagene demeura avec son ami, Caliante suivit Valerius et Merigene fit la même chose que Themiste. Pour le second consul, quoiqu’il n’eût qu’un fils unique, il l’envoya à l’armée, qui en trois jours fut prête à partir. Dès qu’elle fut partie, le consul Horace ne songea qu’à avoir l’honneur de dédier le temple de Jupiter. Pour cet effet, on le purifia selon la coutume, avec des cérémonies plus anciennes que Rome. Tout le peuple quitta son travail ce jour-là, on offrit des sacrifices dans tous les autres temples. Celui qu’on dédiait fut éclairé par plus de mille lampes magnifiques ; toutes les personnes de qualité de l’un et de l’autre sexe s’y trouvèrent. La grande vestale s’y rendit, les Saliens y furent, et l’on ne soupçonna point qu’il pût rien arriver qui fit obstacle à l’achèvement de la cérémonie. Cependant, comme le second consul tenait déjà les portes du temple à demi ouvertes et que suivant l’ancienne coutume il était prêt de prononcer les paroles solennelles qui devaient faire la dédicace du temple, un frère de Valerius qui était tout contre la porte, élevant la voix : « Sache, lui dit-il, que ton fils est mort à l’armée et qu’étant obligé de songer à ses funérailles, ce n’est pas à toi à faire ce que tu fais car c’est une profanation que de verser des larmes le jour qu’on dédie un temple à Jupiter.
— Si mon fils est mort, reprit Horace sans s’émouvoir, il est mort pour sa patrie et cela étant, me préservent les dieux de pleurer sa perte. Que les Romains prennent donc soin de sa sépulture, ajouta-t-il, car il était plus à Rome qu’à moi, et puisqu’il est mort pour défendre la liberté, je dois m’en réjouir et achever la cérémonie. »
Herminius qui était de l’autre côté de la porte connut bien que ce qu’avait dit le frère de Valerius, était un artifice dont il s’était servi pour tâcher d’empêcher cette cérémonie, s’imaginant que le consul serait si troublé de la nouvelle de la mort de son fils unique, qu’il ne pourrait l’achever. Il s’imagina même que cet artifice lui avait été inspiré par Spurius qui était son ami, de sorte que sachant combien cela déplairait à Valerius qui était ennemi déclaré du mensonge aussi bien que lui, il ne put s’empêcher de dire tout haut que cette nouvelle n’avait pas été mandée par Valerius. Cependant, le consul, soit qu’il connût que ce qu’on lui avait dit n’était pas vrai, soit qu’il eût l’âme ferme, ou que le désir de la gloire l’eût rendu insensible, ne témoigna nulle marque de douleur et acheva la cérémonie. Mais comme elle était prête de finir, Horace et le fils de ce consul arrivèrent, qui venaient de la part de Valerius l’avertir qu’il s’était emparé assez facilement de ce passage dont ils avaient jugé à propos de se saisir, et qu’il reviendrait dès qu’il l’aurait fait fortifier. Si bien qu’Herminius voyant arriver celui qu’on disait qui était mort et sachant par lui ce qu’il venait de dire, le voulut conduire lui-même au consul Horace, afin de faire voir clairement que Valerius ni lui, n’avaient nulle part à l’artifice dont on s’était servi pour le détourner de la cérémonie. Et en effet, il fut aisé de connaître ceux qui avaient eu part à cette fourbe, car le frère de Valerius et Spurius se retirèrent, et Herminius, Émile, Amilcar, Zenocrate, et tous les autres amis de Valerius demeurèrent et se réjouirent avec le consul du retour de son fils, et de la nouvelle qu’il avait apportée. Cependant, Clelius qui avait alors assez de joie parce qu’on lui assura qu’Octave échapperait, apprenant qu’on croyait qu’Aronce serait obligé de porter les armes contre Rome, appela Clélie et lui parlant avec toute l’autorité d’un père et d’un Romain dont la vertu était austère, « Ma fille, lui dit-il, vous n’ignorez pas quelle est la haine que je dois porter à Tarquin, et vous avez vous-même été assez persécutée pour le haïr horriblement, et pour devoir oublier sans peine un prince, qui selon les apparences, a trempé son épée dans le sang de votre frère, et qui apparemment va se mettre en état de le tuer et de me tuer moi-même, s’il est vrai comme on le dit, qu’il doive faire la guerre à Rome.
— Mais Seigneur, reprit froidement Clélie, si Aronce a blessé mon frère, ç’a été sans le connaître ! Il a servi Rome importamment contre Tarquin à la dernière bataille, et s’il est vrai qu’il change de parti, ce ne sera sans doute que parce que le Roi son père, ayant pris celui de Tarquin, l’honneur ne lui permettra plus de combattre pour Rome puisqu’il ne le pourrait faire sans combattre contre celui à qui il doit la vie. Ainsi je vous avoue, si je le puis sans perdre le respect que je vous dois, que je ne pense pas qu’après m’avoir commandé tant de fois de regarder Aronce comme un homme que je devais épouser et que j’eusse effectivement épousé sans cet effroyable tremblement de terre qui rompit le dessein que vous aviez, je puisse aussi facilement oublier Aronce que vous le voulez, car il n’est pas en mon pouvoir de ne me souvenir point de toutes les obligations que je lui ai.
— J’entends bien, interrompit brusquement Clelius, que vous voulez me faire connaître que je dois aussi me souvenir de celles que vous prétendez que j’aie à Aronce, mais sans m’amuser à répondre à tout ce que vous venez de dire, je vous déclare que je révoque tous les commandements que je vous ai faits en faveur d’Aronce, et que je vous fais encore de plus forts en faveur d’Horace que je veux que vous épousiez à la fin de la guerre. Je vous le ferais même épouser dès demain, ajouta-t-il, si ce n’était que Valerius par son exemple, m’apprend qu’il ne faut point s’amuser à faire des noces pendant que la patrie est en guerre, puisqu’il a remis celle de Valerie par cette seule raison. Joint que ne voulant pas vous traiter sévèrement, je consens que vous ayez quelque temps à vous résoudre de m’obéir de bonne grâce.
— Mais, Seigneur, reprit modestement Clélie, que deviendront les promesses que vous avez faites au malheureux Aronce ?
— J’ai promis toutes choses à l’inconnu Aronce, répliqua-t-il, mais je n’ai rien promis au fils de Porsenna et au protecteur de Tarquin et puis, ajouta fièrement Clelius, à vous dire ce que je pense, il ne faut pas que vous vous imaginiez qu’Aronce soit à Clusium ce que vous l’avez vu autrefois à Carthage et ce que vous l’avez encore vu à Rome ! Son exemple vous apprendra peut-être bientôt à obéir à votre père comme il obéira au sien. C’est pourquoi il vaudrait mieux que vous le voulussiez prévenir. Résolvez-vous donc, car aussi bien vous serait-il inutile de me résister, et je vais de telle sorte publier la résolution où je suis, qu’il sera assez difficile que quelqu’un des amis d’Aronce ne l’a lui fasse pas savoir dès qu’il sera en liberté.
— Vous pouvez sans doute, reprit Clélie, dire votre résolution à tout le monde, mais, Seigneur, vous ne changerez jamais celle que j’ai faite de n’être jamais à personne si je ne puis être à Aronce. »
Clelius s’emporta avec beaucoup de violence et laissa Clélie avec une douleur incroyable. Il est vrai que Sulpicie la consola avec beaucoup de bonté, car comme elle aimait Aronce et qu’elle haïssait Horace, elle entrait dans les sentiments de Clélie et n’oubliait rien pour la soulager. Octave lui donnait aussi tous les sujets du monde de se louer de sa générosité, mais après tout, Aronce était absent et prisonnier, et s’il sortait de prison elle jugeait bien que ce serait pour faire la guerre à Rome, et qu’ainsi elle en serait plus malheureuse. Elle craignait même que le temps ne changeât le cœur d’Aronce. Elle appréhendait qu’Horace ne redevînt aussi violent qu’il avait été, et ne trouvant nul avantage ni à la paix, ni à la guerre, elle se trouvait toujours malheureuse. Mais si elle était infortunée, Aronce n’était pas heureux, car il était vrai que la Reine sa mère, accompagnée de la Princesse des Leontins, étaient allée le trouver à l’île des Saules, pour lui dire de la part du roi qu’il fallait qu’il se résolût à une prison perpétuelle ou à prendre les armes contre Rome en faveur de Tarquin. D’abord la pensée de changer de parti tout d’un coup lui donnait de l’horreur, principalement quand il songeait qu’il se verrait l’épée à la main contre le père de Clélie, et contre tant d’illustres amis. Mais aussi, quand il venait à penser que son rival était a Rome car on lui apprit qu’il était délivré et qu’il songeait que durant sa prison Horace pourrait profiter de son malheur, il trouvait qu’il ne pouvait rien faire de plus désavantageux pour lui, que de demeurer en prison. Comme il savait que la Reine sa mère, et la Princesse des Leontins, étaient dans ses intérêts et qu’elles savaient sa passion, il ne leur dissimula point ses sentiments. « De grâce, Madame, disait-il à Galerite, souvenez-vous que je suis dans la même prison où l’amour vous avait autrefois enfermée. Rappelez-vous toute la tendresse que vous avez eue pour le roi, et entrez dans les sentiments d’un malheureux qui a perdu sa liberté, devant qu’il sût qu’il vous dût la vie. Considérez donc le déplorable état où je me trouve. Si j’obéis au roi, je me verrai l’épée à la main contre le père de Clélie, et je servirai importamment Tarquin et Sextus qui ont été, et qui sont peut-être encore, les amants de la personne que j’aime et ses persécuteurs, et les miens. Si je cherche à échapper de ma prison et que je me jette dans Rome, je fais une action horriblement criminelle envers le Roi mon père, et je prends le parti d’Horace qui est un redoutable rival ! Et si je demeure en prison, je ne fais rien ni pour le roi, ni pour Clélie, ni pour moi-même, ni contre Horace, ni contre Tarquin, et je ne fais enfin que souffrir inutilement. De sorte que je me trouve au plus malheureux état que jamais nul autre amant se soit trouvé. »
La Princesse des Leontins voulant, du moins, donner quelque consolation à Aronce, lui apprit que le Prince de Numidie avait cessé d’être prince et était frère de Clélie, sans lui apprendre pourtant qu’on croyait qu’il l’eût blessé quoiqu’elle l’eût su par Artemidore et Zenocrate, de peur de l’affliger. « Si cela est ainsi, reprit Aronce, j’aurai perdu un rival et acquis un protecteur, car je ne doute nullement qu’entre Horace et moi, ce généreux frère de Clélie ne se déclare à mon avantage.
— Hélas ! dit alors Galerite en soupirant, que vous sert-il qu’il se déclare à votre avantage si la Fortune est contre vous ? Car enfin, pour vous dire les choses comme elles sont, j’ai ordre du roi de vous offrir la liberté et ses bonnes grâces, pourvu que vous veuillez épouser la fille du Prince de Cere que Tarquin lui propose, ne pouvant, dit-il, s’assurer autrement de vous, après vous être déjà une fois échappé de sa Cour.
— Ha ! Madame, s’écria Aronce, je mourrai mille fois plutôt que de faire ce que le roi me propose, et j’aime sans comparaison mieux mourir, que de faire jamais rien contre mon amour et contre mon honneur. Cependant, en l’état où je me trouve, il est si difficile de faire quelque chose pour l’un sans faire quelque chose contre l’autre, que la mort est le seul remède que je puis trouver. Cessez donc Madame, ajouta ce prince affligé, cessez d’avoir de l’amitié pour moi, puisque je ne puis jamais faire autre chose que donner de la douleur à ceux qui m’aiment.
— L’espérance est un bien si doux, reprit la Princesse des Leontins, qu’il ne faut pas l’abandonner si facilement. Ainsi, je voudrais que vous laissassiez à la reine le pouvoir de ménager les intérêts de votre amour et de votre honneur, sans vous informer de ce qu’elle dira au roi.
— Hélas ! Madame, reprit tristement Aronce, qu’il est difficile de conserver l’espérance en l’état où je suis, quand on n’a pas perdu la raison.
— Quoiqu’il en soit, dit Galerite, laissez-vous conduire si vous voulez ne vous perdre point,
— Mais Madame, répliqua-t-il, que puis-je faire et que pouvez-vous faire vous-même ?
— Je puis dire au roi, répliqua-t-elle, que vous êtes au désespoir de ne sentir pas votre âme en état de pouvoir lui obéir si promptement,
— Mais Madame, interrompit Aronce, je ne lui obéirai jamais s’il me commande toujours de n’aimer plus Clélie !
— Ayez patience, reprit Galerite, et laissez-moi achever ce que je veux dire. Je prétends donc, ajouta-t-elle, parler au roi comme je viens de vous le proposer, et tâcher de lui persuader de vous laisser la liberté d’être seulement gardé dans son palais et de permettre à tout le monde de vous voir.
— Mais à quoi aboutira cela, reprit Aronce, puisque je ne veux pas épouser la fille du Prince de Cere ?
— Durant que les choses seront en cet état, répliqua Galerite, on essaiera de faire changer de sentiments au roi, et s’il n’en change pas, il faudra avoir recours à un artifice que j’imagine, où la Princesse des Leontins est absolument nécessaire.
— Si cela est Madame, dit alors cette généreuse princesse, vous n’avez qu’à me dire ce qu’il faut que je fasse, car je vous obéirai à l’heure même. 656-1
— Vous n’aurez donc, reprit Galerite, qu’à venir voir Aronce toutes les fois que je le visiterai. Ensuite, il faudra qu’il agisse comme s’il vous aimait, et comme vous n’êtes pas en état de disposer de vous tant que vous serez mal avec le Prince de Leonte, les choses tireront en longueur. Porsenna qui ne cherche à faire épouser la fille du Prince de Cere à Aronce que pour le guérir de l’amour qu’il a pour Clélie n’y pensera plus, si bien que l’obstacle paraissant alors venir de votre côté, il le laissera en repos. Cependant, les choses pourront changer de face !
— Quoiqu’il y ait peut-être quelque chose qui choque la bienséance, reprit la Princesse des Leontins en souriant, à souffrir apparemment d’être aimée d’un prince aussi bien fait qu’Aronce, je prends tant d’intérêt à ce qui le touche que je consentirai à cette innocente fourbe, qui d’ailleurs me pourra servir auprès du Prince mon frère.
— Mais Madame, répliqua Aronce, ne serait-ce point un crime de feindre d’aimer une personne aussi aimable que vous ? Il est vrai que j’ai tant d’estime et tant d’amitié pour vous, s’il m’est permis de parler ainsi, que vous n’avez rien à me reprocher puisque je n’ai eu l’honneur de vous voir que lorsque je n’avais plus de cœur à perdre. Mais enfin, quand cette feinte réussirait, elle serait assez dangereuse pour moi si Clélie ne la savait pas, et à mon avis il serait assez dangereux de confier ce secret-là à une lettre !
— Pour cela, dit la Princesse des Leontins, ne vous en mettez pas en peine, car je me charge quand il en sera temps, de lui écrire moi-même pour l’empêcher d’être trompée, et de faire tenir une lettre de vous à cette belle et vertueuse personne.
— Cela étant ainsi, reprit Aronce, je conçois bien que cette feinte peut empêcher qu’on ne me propose plus la Princesse de Cere, mais je ne vois pas comment je pourrai éviter avec honneur de suivre le roi à la guerre, ni comment je pourrai, sans irriter Clélie, et sans être haï de Clelius, servir au siège de Rome.
— Si Clélie est équitable, reprit Galerite, elle vous plaindra sans vous accuser, et si Clelius est généreux, il vous louera quand vous défendrez la vie de votre père, et ne vous en aimera pas moins.
— Ha ! Madame, répliqua Aronce, vous ne savez pas combien Clelius aime sa patrie, combien il hait Tarquin, et combien il a sujet de le haïr !
— Mais enfin sans songer aux choses de si loin, reprit Galerite, songeons seulement à faire que vous ne soyez plus à l’île des Saules, que vous veniez à Clusium, que vos amis vous y voient, et qu’on ne parle plus du mariage de la fille du Prince de Cere, car en un mot, ajouta Galerite, la constante affection que vous avez pour Clélie me fait pitié, et si le roi se souvenait aussi tendrement que je fais, de l’amour qui l’a rendu malheureux durant tant d’années, il excuserait la vôtre comme je l’excuse puisque vous aimez une personne qui a de la beauté, de la vertu et de la naissance, puisque comme je l’ai su par un de nos plus vieux devins qui est savant en toutes choses, et particulièrement en généalogies, Clelius est véritablement de la race des rois d’Albe, quoiqu’il n’ose le dire à Rome à cause des anciens différends des Sabins avec les Romains, et qu’aujourd’hui que ces deux peuples n’en font plus qu’un, il ne cherche point de plus grande gloire que celle d’être Romain. »
Aronce entendant parler Galerite de cette sorte, lui dit mille choses douces et touchantes, et n’oublia rien de tout ce qu’il crut capable de lui attendrir le cœur. De sorte qu’il obtint même de cette princesse, la permission d’écrire à Clélie, car comme elle croyait qu’après avoir été si prêt de l’épouser, c’était irriter les dieux de troubler une affection aussi innocente que celle-là, elle voulut bien donner cette consolation à un prince qu’elle aimait avec une tendresse infinie. Ainsi, durant que Galerite et la Princesse des Leontins furent se promener sur une terrasse, il écrivit à Clélie et donna sa lettre à la Princesse de Leonte qui lui promit de la faire tenir sévèrement. Et en effet, dès qu’elle fut retournée à Clusium, elle la donna au Prince Artemidore son frère, qui la voyait tous les jours en secret. Si bien qu’à l’heure même, il envoya un esclave exprès à Rome, qui porta cette lettre à Zenocrate afin qu’il la rendît à Clélie. En effet, il ne l’eut pas plutôt reçue, qu’il fut chez Sulpicie qui n’y était pas, mais comme elle n’avait pas mené Clélie, il lui donna la lettre d’Aronce qu’elle reçut avec un transport de joie le plus grand du monde. Elle l’ouvrit donc avec précipitation, et en ayant trouvé une dedans pour Octave, elle la garda, et se mit à lire celle qui lui était adressée, qui était telle :
ARONCE À CLÉLIE
Si je ne vous aime plus que je ne vous ai jamais aimée et si je ne suis résolu de vous aimer éternellement, je veux ne sortir jamais de la prison où je suis, quoiqu’elle me soit insupportable. Après cette sincère protestation, souffrez que je vous conjure de ne juger point de moi par des apparences, car peut-être l’amour que j’ai pour vous m’obligera-t-elle à faire des choses qui vous paraîtront criminelles quoiqu’elles ne le soient pas, mais encore une fois, je serai toujours absolument à vous et je ne serai jamais qu’à vous.
Clélie ayant achevé de lire cette lettre, trouva quelque sujet d’inquiétude par la prière que lui faisait Aronce, mais après tout, l’assurance d’en être toujours aimée lui redonna une joie qu’elle n’avait point sentie il y avait longtemps. Elle en cacha pourtant une partie à Zenocrate, car encore que l’affection d’Aronce et de Clélie ne fût point un secret, la modestie de cette vertueuse fille l’obligeait toujours à ne montrer qu’une partie de la tendresse qu’elle avait dans l’âme. De sorte que pour la cacher plus aisément en cette occasion, elle mena Zenocrate à la chambre d’Octave à qui elle donna le billet qui était pour lui. En le recevant, il ne put s’empêcher de soupirer, s’imaginant bien qu’Aronce lui redemandait son amitié après avoir su qu’il ne pouvait plus être son rival, et en effet, il trouva que ce billet était généreux et tendre, le voici :
ARONCE À SON CHER OCTAVE
Je ne m’étonne plus de n’avoir jamais pu vous haïr autant que mes autres rivaux puisque vous êtes frère de l’admirable Clélie. Mon cœur discernait sans doute Octave d’avec le Prince de Numidie car malgré nos démêlés, il a toujours eu du respect pour votre vertu. Mais de grâce ne vous contentez pas de m’ôter un rival, redonnez-moi un ami et veuillez être mon protecteur auprès de Clélie et de Sulpicie. J’aurai peut-être le malheur de me trouver dans un parti opposé à celui de Rome, mais si l’honneur et l’amour m’y forcent, plaignez-moi, et croyez que je n’en serai pas moins à vous.
Octave après avoir lu ce billet le montra à Clélie, qui ne put achever de le lire sans soupirer, car elle comprit bien qu’Aronce se verrait forcé de porter les armes contre Rome. Elle connaissait bien que l’honneur ne lui permettait pas de se venir jeter dans Rome, puisque le Roi son père, lui ferait la guerre, et elle concevait bien encore que Clelius était si zélé pour sa patrie, qu’il haïrait encore plus Aronce de ce qu’il ferait dans l’armée ennemie, qu’il ne le haïssait dans la pensée où il était qu’il eût blessé Octave à la bataille. Mais enfin, elle ne laissa pas de trouver toujours beaucoup de douceur à recevoir des marques de la confiance d’Aronce, joint que la lettre qu’il écrivait à Octave faisait si bien voir que si c’était lui qui l’eût blessé il ne l’avait pas connu, qu’elle demanda à son frère s’il n’était pas à propos de la faire voir à Clelius. Et en effet, le généreux Octave lui promit de le faire, et lui tint la parole qu’il lui donna. Mais comme Clelius était alors mal disposé pour Aronce et très favorable à Horace, il dit qu’il ne voyait rien dans cette lettre qui justifiât Aronce, et qu’au contraire, il voyait qu’elle était écrite par un homme qui se préparait à être le protecteur de Tarquin et l’ennemi de Rome. Octave lui dit alors que la nature et l’honneur ne permettant pas à Aronce d’abandonner le Roi son père, il fallait le plaindre d’être engagé parmi les ennemis de Rome et ne le regarder pourtant pas comme un ennemi. Mais ce fut en vain qu’il lui parla, car dans les sentiments où il était alors, tout ce qui était favorable à Aronce le fâchait, et tout ce qui était contraire à Horace le mettait en colère. Cependant, comme ce que Valerius avait fait était assez important, et que la politique voulait qu’on fît valoir cet avantage autant qu’on pourrait, afin de tenir le peuple dans une favorable disposition pour la continuation de la guerre, toutes les personnes principales affectèrent de témoigner de la joie. La maison de Racilia était pourtant toujours mélancolique, et Hermilie et Colatine étaient presque toujours seules à plaindre leurs infortunes. En ce même temps, ceux de Veies ayant demandé quinze jours pour résoudre avec tous leurs devins s’ils rendraient cette figure qu’on devait mettre au haut du temple de Jupiter, Telane demeura libre à Rome sur la parole de Clelius à qui il avait donné la sienne. Mais à dire la vérité, il n’en fut pas trop marri, car Plotine lui plaisait si fort et il trouvait tant d’honnêtes gens à Rome et tant d’aimables femmes, qu’il eût volontiers souhaité d’y être toute sa vie. Il est vrai qu’il n’était pas étrange qu’il se plût en un lieu où son inclination l’attachait, et où l’on prenait tant de soin de le divertir. Car Horace voulant reconnaître en sa faveur le bon traitement qu’il avait reçu de Mamilius, n’y oubliait rien, et Clelius le regardant comme un parent de son ancien ami, commanda à Sulpicie et à Clélie de le divertir autant qu’elles pourraient, car Octave étant alors hors de danger, il avait l’esprit fort content. Et puis à dire vrai, Telane était si aimable par lui-même que tout le monde contribuait avec plaisir à le divertir. Ainsi Horace, Herminius, Themiste, Meleagene, Zenocrate, Spurius, Émile, Merigene, et même Amilcar tout son rival qu’il était, faisaient ce qui leur était possible afin de lui faire passer agréablement le temps qu’il devait être à Rome. Clélie ayant alors l’esprit un peu moins affligé, était aussi plus maîtresse d’elle-même et se contraignait plus aisément, et Valerie, Cefonie, Plotine, Flavie, et Salonine, étant d’elles-mêmes assez disposées à se divertir, la conversation était toujours assez divertissante en quelque lieu qu’elle fût. Joint que la coutume étant que toutes les fois qu’on dédiait un temple à Rome, on était trois jours en fête et en joie, chacun pensa à se réjouir. Si bien que Sulpicie pour suivre la coutume, et pour obéir à Clelius, fit le dessein d’aller souper à un des jardins de Numa, qui était au pied de cette petite colline couverte de lauriers, où il allait recevoir en secret les inspirations de la nymphe Égérie. Et en effet, les principales dames de Rome en étant conviées, outre Valerie, Cefonie, Plotine, Flavie et Salonine, elles y furent toutes dans des chariots. Pour les hommes ils s’y rendirent séparément, et à cheval. Comme les dames arrivèrent en ce lieu-là, elles virent un chariot rompu devant la porte du jardin où elles allaient, et elles remarquèrent que ceux qui regardaient s’il pouvait être raccommodé n’étaient pas Romains. Elles demandèrent au jardinier qui était à la porte à qui était ce chariot, et il leur répondit que c’était à des dames de Sicile qui venaient d’entrer dans le jardin, qui après avoir abordé à Ostie, avaient pris un chariot pour venir à Rome. Après cela, Sulpicie entra, suivie de toutes les autres dames et comme Horace, Herminius, Amilcar et Zenocrate étaient arrivés devant Émile, Spurius, Themiste, Sicinius, Acrise et Merigene, ils donnèrent la main à ces dames et furent ensuite dans ce jardin. À peine Zenocrate qui aidait à marcher Clélie parce qu’Horace s’était trouvé obligé de donner la main à Sulpicie, eut-il fait vingt pas, qu’il vit deux belles personnes assises au bord d’une fontaine, sur des sièges de gazon, qui sans prendre garde à la compagnie, s’entretenaient attentivement pendant que deux filles qui étaient à elles, cueillaient des fleurs dans le parterre. Dès qu’il les eut regardées, il connut que celles qu’il voyait étaient Clidamire et Berelise, maîtresses d’Artemidore, si bien qu’étant fort agréablement surpris, il ne put s’empêcher de témoigner sa surprise et sa joie. « Ô dieux ! s’écria-t-il, comment est-il possible que je trouve ensemble deux des personnes du monde qui me plaisent le plus, et qui s’aiment le moins ? De grâce Madame, dit-il à Clélie, obligez la généreuse Sulpicie à leur faire civilité, car les personnes que vous voyez sont de la première qualité d’Agrigente et de Leonte, comme vous le pourrez savoir dès que je vous aurai dit qu’elles se nomment Clidamire et Berelise, car je sais que Valerie vous a raconté tout ce qu’elle m’a ouï-dire autrefois des aventures d’Artemidore. Clélie entendant parler Zenocrate de cette sorte, avertit Sulpicie de la condition de ces dames, qui tournant à la fin la tête vers cette belle et grande compagnie, abaissèrent leurs voiles, et se levèrent avec l’intention de prendre le chemin d’une allée, pour éviter la compagnie qu’elles voyaient. Cependant, Zenocrate après en avoir demandé permission à Clélie, la quitta et fut vers ces dames qu’il n’eut pas plutôt abordées, qu’elles le reconnurent pour l’avoir vu à Leonte et à Agrigente. Elles levèrent alors leurs voiles, et soupirèrent toutes deux en le voyant, car comme elles savaient bien qu’il savait toutes leurs aventures, elles ne purent retenir ce premier mouvement. Elles furent pourtant bien aises de l’avoir trouvé, mais s’imaginant que peut-être Artemidore était-il dans ce jardin aussi bien que lui, elles en eurent le cœur fort ému. Il est vrai que Zenocrate les désabusa bientôt, car après la première civilité, il leur dit que le Prince Artemidore ne devinait sans doute pas, au lieu où il était, quelle était son aventure. Ensuite de quoi, leur apprenant quelles étaient les dames qu’elles voyaient, il les disposa à bien recevoir les civilités de Sulpicie, qui après avoir su par Clélie la condition et le mérite de ces dames, fut leur offrir tout ce qui dépendait d’elle. Après quoi, elle les convia à passer le reste du jour dans ce jardin et les assura qu’elle les remènerait dans son chariot pendant qu’on raccommoderait le leur, et elle leur offrit même sa maison de fort bonne grâce. « Je vous assure, dit alors agréablement Telane qui était présent, que l’on reçoit admirablement bien les étrangers chez Sulpicie, encore qu’ils soient ennemis. Ainsi, il y a lieu de croire qu’on y recevra fort bien d’aussi belles étrangères que vous.
— En mon particulier, reprit modestement Berelise, je mérite si peu la qualité de belle, que je ne prends aucune part à un discours si obligeant,
— Et pour moi, ajouta galamment Clidamire, quand je me serais quelquefois trouvée belle en Sicile, je me trouverais aujourd’hui fort laide en un lieu où je vois de plus belles personnes que je n’en ai jamais vu ailleurs.
— Il me semble, reprit alors Valerie en regardant Clélie, que c’est à vous à répondre, car vous avez plus de part que toutes les autres aux louanges de Clidamire,
— Je suis si peu persuadée de ce que vous dites, reprit Clélie, que je me préparais à vous écouter, et ne songeais nullement à répondre.
— C’est sans doute, ajouta Plotine, que vous n’avez pas la force de vous opposer à une vérité qui ne peut être contestée par quiconque a des yeux. Mais, ajouta-t-elle en souriant, encore que je ne sois pas de ces grandes beautés qui donnent de l’admiration, je ne laisse pas de vouloir hardiment prendre quelque part aux louanges de Clidamire, car je serais bien marrie de ne plaire pas à une personne qui me plaît déjà beaucoup.
— Clidamire, reprit Berelise en regardant Zenocrate, est accoutumée à plaire dès qu’on la voit, mais pour moi qui ne fais pas des conquêtes si promptement je ne laisse pourtant pas d’espérer, si je tarde à Rome, qu’on y contera mes louanges pour quelque chose, quoiqu’on n’ait parlé que de celles de ma belle-sœur.
— Vous dites cela d’un air si fin, répliqua Plotine, que je vois bien que plus on vous connaîtra, plus on voudra vous connaître, et que vous savez bien conserver ce que vous avez acquis.
— Vous la connaissez déjà si bien, répliqua Clidamire avec un souris un peu malicieux, que je crois que vous l’avez vue ailleurs car non seulement elle conserve ce qu’on lui donne ou ce qu’elle acquiert, mais elle ôte même bien souvent aux autres ce qu’ils ont acquis, et ne le leur rend jamais.
— Quand on trouve quelque chose que quelqu’un a perdu par sa faute, répliqua Berelise, et qui faudrait absolument qui fût toujours à quelque autre, il vaut autant le prendre et le garder que de le laisser à des gens qui n’en auraient peut-être pas grand soin. C’est pourquoi, ajouta Berelise en regardant toutes les belles personnes qui l’environnaient, s’il arrive que nous fassions quelque séjour à Rome, vous n’avez qu’à vous préparer à m’aimer plus à la fin qu’au commencement. Cependant, comme il n’est pas juste de troubler votre divertissement et d’être d’une fête dont le hasard nous fait convier, si ma sœur m’en croit, nous accepterons le chariot qu’on nous a offert, et nous vous laisserons dans la liberté, qui est la chose du monde la plus nécessaire à une promenade pour la rendre agréable, puisque bien souvent une seule personne étrangère ou incommode, trouble le plaisir de plusieurs.
— Pour incommodes, reprit Sulpicie, vous savez bien que vous ne l’êtes pas,
— Et pour étrangères, ajouta Plotine, vous l’êtes moins à Rome que vous ne pensez, n’étant pas possible d’y avoir tant vu le Prince Artemidore et Zenocrate, sans vous connaître parfaitement. »
Clélie joignant alors ses prières à celles de Sulpicie, et toutes les autres dames approuvant les prières de celles-là, Clidamire et Berelise se résolurent de demeurer. Elles en firent pourtant encore quelque difficulté parce qu’elles étaient trop négligées pour se trouver à une fête préméditée, mais comme leur négligence était pourtant fort propre, leur excuse fut trouvée mauvaise et elles furent contraintes d’augmenter cette belle compagnie. Si bien qu’après avoir donné ordre à leurs gens d’aller avertir un ami de Spurius, chez qui elles devaient loger, qu’elles arriveraient le soir, elles se mêlèrent dans la conversation de toutes les dames, avec la même liberté que si elles eussent été de leurs plus anciennes amies. Clidamire et Berelise louèrent la beauté de Clélie avec beaucoup d’esprit, car il y a sans doute un art de louer de bonne grâce qui est plus difficile que l’on ne pense. Mais comme Clélie était modeste, elle détourna les louanges qu’elles lui donnaient d’une manière si douce que sans les refuser, ni les accepter, elle leur fit changer de discours. En effet, voyant entrer un homme de bonne mine, et d’un air noble et enjoué, « Je voudrais bien, dit-elle, que celui que je vois fût quelque étranger aussi agréable que vous,
— Il l’est sans doute bien davantage, reprit Clidamire qui le reconnut, et je pense que Berelise ne me désavouera pas,
— Vous le connaissez donc ? répliqua Clélie,
— Nous ne le connaissons, reprit Berelise, que pour avoir fait le trajet de Sicile à Ostie en même vaisseau, mais je puis vous assurer qu’il n’y a jamais eu un homme plus agréable qu’Anacréon.
— Quoi ? reprit Herminius, celui qui vient est cet Anacreon dont les ouvrages m’ont charmé en Grèce et dont la réputation est si grande ? Qui a une imagination si galante, un esprit si délicat, et des expressions si naturelles, qui aime tous les plaisirs en général, et qui en particulier ne hait pas trop les festins ?
— C’est celui-là même, répliqua-t-elle.
— Pour moi, dit Amilcar, qui suis enchanté de ses écrits aussi bien qu’Herminius, je suis ravi de le voir. »
Berelise entendant ce qu’on disait d’Anacreon, fut au-devant de lui et prenant la parole : « Venez, lui dit-elle, venez en un lieu où vous avez plus d’amis que vous ne croyez et où vous pourrez peut-être rompre le serment que vous avez fait de n’aimer pas une belle à Rome, car vous en verrez d’assez charmantes dans ce jardin pour changer peut-être de résolution.
— Puisque je n’ai eu que de l’admiration et de l’estime pour vous et pour Clidamire depuis que j’ai l’honneur de vous connaître, reprit-il car il parlait passablement bien la langue romaine, je pense qu’il n’y a point de belles au monde qui se doivent offenser quand elles ne me donneront point d’amour.
— Peut-être, reprit galamment Plotine, aurions-nous tort de nous en offenser mais si vous êtes tel qu’on vient de vous dépeindre, peut-être aurait-on raison de s’en affliger, car il y aurait assez de plaisir d’arrêter à Rome un aussi honnête homme que vous.
— Je vous assure, répliqua-t-il, que la bonne compagnie me peut arrêter partout, et que comme celle où je me trouve à la mine d’être fort agréable, il ne tiendra qu’à elle que je ne m’arrête ici tant qu’il lui plaira. »
Après cela, toutes ces dames firent mille civilités à Anacreon, et l’obligèrent en effet à souper dans ce jardin avec toute la compagnie. « Pour moi, reprit-il lorsque ces dames commencèrent de se promener, je tire un heureux présage de mon séjour à Rome, puisque d’abord je me trouve en un festin, moi qui suis le protecteur de la joie, et qui malgré tous les sages qui ne font que vanter la solitude et la simplicité, je suis persuadé que la société et la bonne chère des honnêtes gens, est fort nécessaire à la félicité de la vie.
— Pour la société, reprit Clélie, je crois que quiconque a de cette raison qui n’est point sauvage en demeure d’accord, mais pour les grands festins je crois qu’on pourrait ne s’y trouver de sa vie sans perdre un grand plaisir et qu’ainsi on s’en pourrait passer pour toujours.
— Quand je parle comme je fais, reprit Anacréon, je n’entends pas parler de ces festins qu’on fait pour des noces, c’est-à-dire d’une assemblée de personnes qui pour la plupart ne s’entreconnaissent point, qui ne savent de quoi parler, où il y a plus de sots que d’honnêtes gens, où l’on parle pourtant beaucoup sans rien dire, où la conversation est plutôt un bruit confus qu’une véritable société, où la cérémonie règne, où l’ennui et le chagrin se trouvent toujours, où la multitude fait qu’on regrette de ne pouvoir être seul et où bien souvent on meurt de faim au milieu de l’abondance, parce que la liberté, la délicatesse, l’ordre et la propreté, ne s’y trouvent pas. En effet, on a un certain dégoût qui fait qu’on ne trouve rien de bon, on est bien souvent vis-à-vis de gens qui déplaisent, l’on en a auprès de soi qui incommodent, et de quelque côté qu’on se tourne, on ne trouve que le désordre et par conséquent le chagrin.
— La peinture qu’Anacreon a faite d’un ennuyeux festin est tout à fait bien, reprit Amilcar, et s’il veut en représenter un qui plaise, je crois que la compagnie en aura beaucoup de plaisir. Pour moi, dit alors cet amant de Plotine qui était de la secte Pythagore, je n’ai jamais compris que la joie des honnêtes gens dût dépendre de la bonne chère et que la délicatesse du goût fût nécessaire à la félicité d’un homme raisonnable. Au contraire, je crois que ceux qui ont cette inclination sont ordinairement ennemis de toute bienséance et de toute vertu, et qu’il y a peu de vices qui ne soient de leur connaissance. Quand Anacreon entend parler d’un festin agréable, reprit Amilcar, il n’entend pas parler d’un de ces festins déréglés où les dames raisonnables ne se trouvent point, d’où la bienséance est bannie, où le libertinage prend la place de la liberté, où la joie ressemble à la fureur, où l’on fait gloire de perdre la raison, où le désordre fait le plus grand plaisir qu’on y trouve, où l’on parle bien souvent sans suite et sans esprit, où ceux qui parlent ne sont point écoutés, où ceux qui écoutent n’entendent rien de ce qu’on leur dit, où l’on chante tantôt bien tantôt mal, où l’on se moque de la vertu et des bonnes mœurs et où l’insolence passe pour une chose agréable, car à n’en mentir pas, je mets les hommes qui passent toute leur vie dans des festins de cette nature beaucoup au-dessous des bêtes.
— Vous avez sans doute raison, répliqua Anacreon, car ces sortes de festins tiennent plus de la fête des Bacchanales que de la véritable joie. Mais ce que je trouve tout à fait agréable, est de se trouver cinq ou six amis ensemble, sans affaires, sans chagrin, et qui regardant seulement la bonne chère comme un lien qui les rapproche et qui les assemble, comme une chose qui donne de la liberté et qui contribue à la joie, y trouvent en effet, tout le plaisir qu’ils y cherchent. La conversation y est libre, enjouée et même plaisante. On dit ce qu’on veut et ce qu’on pense, on donne autant de joie qu’on en reçoit, l’esprit y brille plus qu’ailleurs quoiqu’il n’ait pas tant de dessein d’y paraître ; on se souvient de ses amis absents, on y parle même de ses amours, on prémédite de nouveaux plaisirs en faisant le dessein d’un autre festin et, entremêlant la fête de chansons agréables, de musique, d’un peu de promenade et d’un peu de conversation, on peut dire que le corps et l’esprit sont contents et qu’il ne reste rien à désirer que le renouvellement du même plaisir. Mais pour faire que ce plaisir soit parfait, il faut que l’amitié des conviés leur donne plus de joie d’être ensemble, que la délicatesse des officiers de celui qui traite ses amis ne leur en peut donner. Ce n’est pas que je blâme ceux qui ont le goût exquis, au contraire, c’est un avantage de la nature aussi bien que d’avoir la vue bonne, mais il n’en faut pas faire sa principale volupté. Il ne faut pas non plus qu’une agréable fête ressemble trop à un festin. Il y faut de l’ordre, du choix, de la politesse, de la propreté, une honnête abondance, rien de superflu, de la joie et de la liberté.
— Ce que vous dites me plaît tout à fait, reprit Plotine, mais ce qui me fâche c’est que vous ne parlez non plus de dames dans vos festins à la grecque, que s’il n’en était point. Il est vrai, ajouta-t-elle, que devant la guerre, les dames à Rome, n’y allaient pas trop souvent ! Mais du moins, tirons-nous cet avantage de notre malheur d’avoir un peu plus de liberté que nous n’en avions. »
Comme Plotine parlait ainsi, on vit entrer Clelius et avec lui Artemidore qui venait d’arriver, et qui après avoir dit au consul Horace ce qui l’amenait, s’était laissé conduire à ce jardin par Clelius sans savoir rien de l’arrivée de Clidamire et de Berelise. Si bien qu’il fut étrangement surpris de voir ces deux belles personnes parmi toutes ces dames romaines. Berelise et Clidamire furent aussi fort surprises de le voir et ne purent s’empêcher de rougir. Elles se regardèrent même l’une l’autre, comme pour chercher dans leurs yeux ce qu’elles pensaient, et elles regardèrent aussi Artemidore, pour tâcher de connaître laquelle il regardait le plus favorablement. Pour lui, il évita les yeux de Clidamire comme s’il eût appréhendé de les rencontrer, et chercha ceux de Berelise. Clélie de son côté, qui savait qu’il lui pourrait dire des nouvelles de son cher Aronce, s’approcha de lui avec autant d’empressement que ses maîtresses qui lui firent chacune un compliment, où il paraissait quelque contrainte, parce qu’en effet, elles n’osaient parler selon leurs véritables sentiments. Mais comme elles virent Artemidore en un lieu où il y avait tant de belles personnes, elles eurent des sentiments bien différents, car Berelise craignit qu’Artemidore n’en aimât quelqu’une, et Clidamire le souhaita presque pour avoir le plaisir de voir qu’Artemidore n’aimait plus Berelise ; mais enfin comme elles étaient en grande compagnie, elles se contraignirent et cachèrent leurs sentiments. Pour Artemidore, la première agitation de son cœur étant passée, il chercha à s’approcher de Berelise mais comme cette aimable fille s’aperçut que la compagnie savait ses aventures, après lui avoir dit en deux mots qu’elle l’entretiendrait avec plaisir quand elle le pourrait sans être observée de tant de monde, elle le pria de ne l’obliger point alors à une conversation particulière. Et en effet, ce jour étant destiné à la joie de toute la compagnie en général, Clelius à qui l’on présenta ces belles étrangères, et Anacreon après les avoir bien reçus, dit que pour suivre l’ordre des grandes fêtes qu’on faisait à Rome, il fallait qu’on nommât un roi du festin qui fût propre à bien choisir les divertissements de la compagnie. Amilcar proposa alors Anacreon comme étant le plus propre à inspirer la joie en une semblable fête, il voulut s’en excuser parce qu’il disait ne savoir pas les coutumes de Rome. Mais Clelius lui ayant dit qu’Herminius les lui apprendrait et ferait même exécuter ses ordres, il consentit à ce qu’on voulut. Après quoi, la première chose qu’il commanda fut que chacun parlât et se promenât avec qui bon lui semblerait, pendant qu’Herminius et Amilcar l’instruiraient de ce qu’il fallait qu’il sût. Si bien que la compagnie lui obéissant, se sépara en diverses troupes. Sulpicie s’assit dans un cabinet de verdure avec deux ou trois femmes qui arrivèrent alors. Clelius fut parler des affaires publiques avec un de ses amis, Artemidore se promena entre Berelise et Cefonie, Horace s’approcha de Clélie qui pour l’empêcher de lui parler de sa passion retint Plotine, auprès de qui étaient Sicinius, Telane et Acrise ; Zenocrate entretint Clidamire, et Valerie malgré qu’elle en eût, fut obligée de souffrir Émile et Spurius. Il est vrai qu’elle obligea Flavie à demeurer auprès d’elle. Cette belle compagnie étant donc partagée en tant de petites troupes, on voyait du monde presque en tous les divers endroits du jardin mais comme Zenocrate voulait que Clidamire n’eût pas loisir d’observer Artemidore, et qu’il avait une envie extrême de savoir ce qui l’obligeait d’être avec Berelise et pour quelles raisons elles venaient en Italie, il le lui demanda. Si bien que comme il avait été autrefois tantôt son amant et tantôt son confident, elle lui apprit que le père de Berelise s’étant remarié par amour à une personne qui n’avait pas voulu que cette charmante fille demeurât avec elle, son père lui avait absolument commandé d’entrer parmi les Vierges voilées où était la Princesse Philonice, et d’y entrer pour n’en ressortir jamais, ou d’aller demeurer avec elle à Léonte, et que quelque jalousie qu’eût eu Berelise, elle avait mieux aimé demeurer avec elle que de renoncer pour toujours aux prétentions qu’elle avait pour Artemidore. « Je vois bien, reprit alors Zenocrate, que Berelise a eu sujet de choisir plutôt de demeurer avec vous, que d’entrer dans les Vierges voilées pour n’en ressortir de sa vie, mais je ne vois pas si bien pourquoi vous avez consenti d’avoir auprès de vous une belle-sœur que vous n’aimez pas.
— Ha ! Zenocrate, reprit Clidamire, je m’aperçois bien que vous ne savez pas mieux aimer que vous faisiez du temps que je vous voyais, car si vous étiez plus savant en véritable amour, vous comprendriez que malgré ma jalousie, j’ai eu assez de satisfaction d’avoir ma rivale en ma puissance. Quand elle était à Agrigente, je croyais toujours qu’Artemidore y était déguisé ou qu’il lui écrivait tous les jours, et je souffrais sans comparaison plus que je n’ai souffert depuis qu’elle est à Leonte où j’ai sans doute tant de crédit, qu’Artemidore et la Princesse sa sœur, n’y retourneront jamais si je ne négocie leur accommodement auprès du prince.
— Mais pourquoi, reprit Zenocrate, ne faites-vous pas cette négociation afin d’obliger Artemidore à oublier votre prétendue inconstance ?
— Ha ! Zenocrate, répliqua-t-elle, s’il pouvait oublier Berelise, il oublierait bientôt ma prétendue inconstance. Mais enfin, pour achever de vous dire ce que vous désirez savoir, il faut que vous sachiez que ma belle-sœur et moi avons eu mille contestations pour Artemidore depuis que nous sommes ensemble, car je lui ai dit cent fois que je ne ferais jamais rappeler ce prince qu’elle ne m’eût promis de n’y songer plus, et elle m’a dit mille et mille fois, qu’elle savait d’une certitude infaillible que ce prince ne m’aimerait jamais quand même il ne l’aimerait plus, et qu’ainsi je le rendais malheureux sans pouvoir tirer nul avantage du malheur que je lui causais. Si bien que voulant m’éclaircir de l’avenir par toutes les voies que les hommes peuvent savoir, et un de mes amis m’ayant assuré que les sorts prénestins2 décident absolument sur toutes les choses pour lesquels on les consulte, nous avons pris la résolution de venir ensemble en Italie pour les consulter, car pour moi je vous l’avoue, comme j’ai causé la première passion d’Artemidore, je ne puis croire qu’il ne revienne point à moi. Pour Berelise elle croit qu’on ne peut jamais oublier l’inconstance, et qu’une amour morte ne ressuscite point. C’est pourquoi, nous voulons voir laquelle des deux se trompe pour régler après notre vie, selon ce que l’on nous dira. Cependant, je crains bien que la rencontre d’Artemidore ne décide plus tôt la chose ! Néanmoins, puisqu’il me fuit, ajouta-t-elle, il me craint encore, et je ne dois pas désespérer que les sorts de Préneste ne me puissent être favorables. »
Pendant que Clidamire parlait ainsi et que tout le reste de la compagnie s’entretenait selon son inclination, Herminius instruisait Anacréon des coutumes de Rome, afin qu’il s’acquittât mieux de la charge que Clelius lui avait donnée. Entre les autres, il lui apprit que depuis que la belle et puissante ville d’Albe avait été confondue avec Rome, il s’était introduit une espèce de jeu de hasard qui était assez divertissant, car comme il avait alors fallu loger tout ce qui restait d’habitants d’Albe en un quartier de Rome, pour ôter la contestation des lieux qu’on leur donnait à habiter, on avait mis la chose au sort par des billets, dans lesquels on avait écrit les noms des habitants d’Albe et dans d’autres billets les maisons qu’on leur destinait. Si bien que depuis cela, dit Amilcar, on a trouvé quelque chose de plaisant à se servir du hasard en choses galantes, de sorte que lorsque le roi d’un festin est libéral, il donne grand nombre de choses magnifiques que l’on distribue au hasard, en mettant tous les noms des convives dans des billets, et marquant toutes les choses que l’on veut donner dans d’autres. Mais afin de voir le bonheur, ou le malheur, on met moins de présents qu’il n’y a de personnes au festin, afin qu’il y ait quelques malheureux, ou qu’on puisse plaindre, ou que l’on puisse railler.
— Je trouve cette coutume tout à fait galante, reprit Anacréon, mais comme je suis un étranger qui n’ai ici rien à donner, il faut chercher quelque invention d’employer le hasard de quelque manière divertissante. »
En effet, Amilcar et Herminius étant convenus avec lui de toutes choses, Herminius se chargea de l’exécution et Anacreon et Amilcar se rapprochèrent de la compagnie. En s’en rapprochant, ils virent dans une allée cet homme qui parlait trop et celui qui parlait trop peu, qui avaient été contraints de se joindre, parce que Plotine s’en était défaite et que tout le monde avait évité celui qui parlait trop, et que personne n’avait voulu de celui qui parlait trop peu. Si bien qu’Amilcar y prenant garde, dit à Anacreon l’humeur différente de ces deux hommes qui étaient tout à fait bien ensemble, puisque l’un voulait toujours parler et que l’autre ne parlait presque point. Cependant, comme Clelius fut mandé par le consul Horace, la compagnie en fut encore plus libre car Sulpicie était une de ces femmes dont la vertu n’est point sauvage et qui ne troublent jamais les divertissements des jeunes personnes pourvu que la bienséance s’y trouve, joint qu’ayant vécu si longtemps en Afrique elle en était un peu moins austère. Toutes ces petites troupes s’étant donc jointes dans un grand rond où il y avait des sièges tout à l’entour, toute la compagnie s’y ou trois, assit et parut admirablement belle, car comme les dames s’étaient promenées quelque temps, l’incarnat de leur teint en parut plus vif lorsqu’elles vinrent à lever leurs voiles. Mais encore que toutes les dames qui étaient là fussent très belles, la beauté de Clélie surpassa de beaucoup celle de toutes les autres, quoiqu’elle n’eût pas alors toute la joie qui est nécessaire à faire éclater la grande beauté. Pour les hommes, ils étaient tantôt assis, tantôt debout, tantôt à genoux devant les dames, selon l’envie qu’ils en avaient, mais comme Clidamire et Berelise étaient étrangères, Clélie et Valerie prirent grand soin de les entretenir et de parler même à Anacreon car encore que le langage dont il se servait fût un peu mêlé parce que c’était en Sicile qu’il avait appris le langage de Rome. Il parlait pourtant si agréablement, que tout le monde l’écoutait avec plaisir, aussi parla-t-il de cent choses différentes, dont il parla toujours bien. « De grâce, disait Clélie à Berelise, dites-moi un peu, d’où est Anacreon ?
— Il est d’une de ces îles qu’on appelle Cyclades en général, répliqua-t-elle, qui s’appelle Teia en particulier et qui est auprès de Delos. Mais il a passé une grande partie de sa vie à Samos auprès de Polycrate, de qui il a été fort aimé. L’amour l’a pourtant brouillé auprès de lui depuis quelques temps.
— Est-ce qu’il a été rival de ce prince ? reprit Valerie,
— Il y a grande apparence, répliqua Berelise, mais je ne le sais pas bien précisément, car encore qu’Anacreon nous ait témoigné beaucoup d’amitié à Clidamire et à moi, nous avons bien remarqué qu’il n’aimait pas à nous faire confidence de ses amours, et tout ce que j’en sais est qu’il nous a dit qu’un jour, Polycrate faisant danser devant lui plusieurs dames de qualité de sa Cour habillées en dieux, en déesses, en nymphes et en muses. Il y avait eu une jeune personne déguisée en Apollon qui avait si fort touché son cœur, qu’il n’avait loué que celle-là, et que Polycrate en avait eu depuis une si horrible jalousie, qu’emporté de colère et de fureur contre cette belle personne qu’il avait soupçonnée de répondre à sa passion, il lui avait fait couper les cheveux, afin qu’elle en parût moins belle aux yeux d’Anacreon. Il en avait été si fort affligé, que pour éterniser la mémoire de ces beaux cheveux, il avait fait les plus beaux vers du monde sur ce sujet.
— J’avais ouï conter cette aventure d’une autre sorte, reprit Amilcar qui était présent, mais puisque vous la savez d’Anacreon, il vous faut croire.
— Pour moi, interrompit Anacreon sans savoir de quoi Amilcar parlait, je pense qu’il est bon de douter de tout,
— Vous n’avez pourtant pas la mine, reprit Clélie, d’avoir l’esprit défiant !
— Vous avez raison, reprit-il, mais pour vous montrer pourtant que je doute aisément de ce qu’on me dit, c’est que je doute même si ce que je viens de dire est raisonnable ou ne l’est pas, et je ne sache présentement qu’une chose dont je ne puis douter, qui est que vous êtes la plus belle personne que je vis jamais.
— Anacreon dit cela d’un certain air, répliqua Clidamire, que je crois qu’il vous aimera bientôt autant qu’il aime les roses, quoiqu’il les aime assez pour vouloir leur donner l’immortalité par ses écrits.
— En effet, ajouta Berelise, il a fait des vers tout à fait jolis qui ne parlent que des privilèges des roses,
— Je préfère sans doute les roses à toutes les autres fleurs, reprit Anacreon, mais ce n’est pourtant pas le printemps tout seul qui a fait naître la tendresse particulière que j’ ai pour elles ! C’est je ne sais quelle autre chose, ajouta-t-il en souriant, qui ressemble assez au printemps.
— C’est-à-dire, répliqua Amilcar, que l’amour que vous avez eu ou que vous avez pour quelque belle et jeune personne qui aimait les roses, vous les a encore plus fait aimer, que vous ne les eussiez aimées !
— Je l’avoue, reprit Anacreon, et je confesse que le souvenir m’en est encore si cher, que je ne puis jamais voir ni roses, ni rosiers, sans sentir je ne sais quoi de doux et de piquant tout ensemble qui me touche le cœur.
— Vous avez pourtant l’air bien gai, répliqua Herminius, pour être sujet à de grandes passions, du moins est-on accoutumé à Rome, à ne soupçonner pas les gens enjoués d’être capables d’un grand attachement.
— J’aime sans doute fort la joie, reprit Anacreon, et si l’amour était sans plaisir je ne serais jamais amoureux. Mais comme il y a des mélancoliques par tempérament qui ne laissent pas d’être capables de sentir de la joie, il y a aussi des enjoués qui sentent de la douleur. Ainsi, quoique je sois assez gai, que je cherche le plaisir partout, et que je le porte même assez souvent aux lieux où je vais, je ne laisse pas d’être dépit, chagrin et jaloux, quand j’ai de l’amour, car il faut savoir distinguer la mélancolie et la douleur, et mettre de la différence entre l’enjouement et la joie.
— Il me semble pourtant, reprit Plotine, que l’enjouement et la joie se ressemblent fort, et qu’avec tout l’esprit que vous avez, vous ne m’en ferez pas voir bien clairement la grande différence.
— Pour l’apercevoir distinctement, répondit Anacreon, il ne faut que savoir qu’il n’y a personne au monde qui ne puisse être capable de quelque joie, et qu’il n’y a qu’un certain nombre de personnes qui soient capables d’enjouement. Cette dernière chose est une qualité particulière de l’humeur de ceux qui sont d’un tempérament gai, mais pour la joie, quand la fortune le veut, elle se trouve dans le cœur des personnes les plus mélancoliques.
— Elle y est même quelquefois plus sensible que dans celui des personnes enjouées, ajouta Herminius, non seulement parce que les choses opposées se font plus sentir les unes aux autres quand elles sont en même lieu, mais encore parce que les personnes de ce tempérament-là ayant ordinairement des désirs plus violents, ont aussi une plus grande joie quand ils peuvent les satisfaire, que n’en ont ceux dont les désirs sont plus modérés. Il se trouve même que la joie fait quelquefois soupirer quand elle est extrême, mais pour l’enjouement, il fait toujours rire. La joie ne peut jamais naître toute seule, il faut toujours qu’elle ait une cause étrangère. Il n’en est pas ainsi de l’enjouement, car il naît de lui-même, et il ne faut tout au plus, que de la santé à ceux qui sont d’humeur à être enjoués. La joie est une suite infaillible de toutes les passions quand elles sont satisfaites, l’enjouement subsiste sans aide, quoiqu’il puisse être augmenté par des causes de dehors. En effet, on peut remarquer à l’heure que je parle, que la présence de ces belles étrangères, et d’Anacreon redouble l’enjouement de l’aimable Plotine et d’Amilcar, du moins, le vois-je ainsi dans leurs yeux.
— Mais pourquoi n’y mettez-vous pas aussi Zenocrate ? reprit Clélie,
— C’est assurément, dit alors Plotine sans donner loisir à Amilcar de parler, parce que Zenocrate est tantôt triste et tantôt gai, et que rêvant aussi souvent qu’il fait, on ne peut pas bien aisément définir s’il est sérieux, quoiqu’on puisse assurer qu’il est toujours très agréable. Mais après tout, s’il ne songe à se corriger de ces petites distractions que ses chères amies lui reprochent, je prévois qu’il y aura quelque jour guerre entre les enjoués et les mélancoliques, car comme il a bien du mérite, les uns diront qu’il est des leur, et les autres aussi !
— Je ne suis pourtant pas si distrait, reprit Zenocrate en riant, que je ne m’aperçoive bien que vous raillez de moi fort ingénieusement, et si j’étais aussi vindicatif que vous êtes malicieuse, je vous reprocherais votre enjouement avec autant de malice que vous me reprochez mes rêveries. »
1 Pont Sublicien, aujourd’hui nommé « pont Sublicius » est le premier et le plus ancien pont de Rome, construit exclusivement en bois pour pouvoir être démonté rapidement.
2 Célèbres oracles de la ville de Præneste ou Palestrina.
| Poids | 230 g |
|---|---|
| Dimensions | 13 × 138 × 204 mm |
| Disponible | Oui |
| Genre | Récit historique, Roman |
| Version papier ou numérique ? | Version numérique (Epub ou PDF), Version papier |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.