Tous les livres
5,99 € – 19,00 €
Vue des Cordillères et monuments des peuples indigènes de l’Amérique – Tome 1
Alexandre de Humboldt
138 x 204 mm – 152 pages – Texte – Noir et blanc – Broché
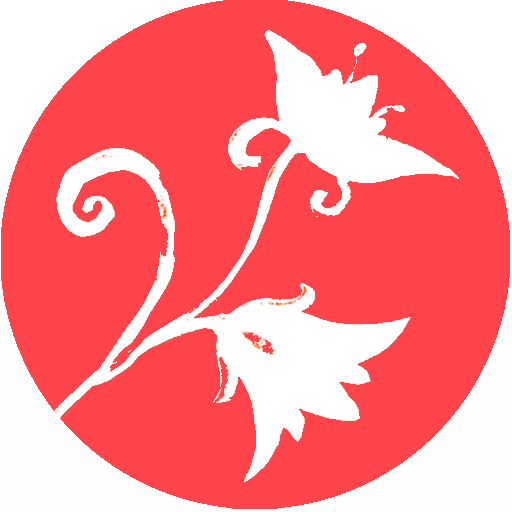
5,99 € – 19,00 €
Vue des Cordillères et monuments des peuples indigènes de l’Amérique – Tome 1
Alexandre de Humboldt
138 x 204 mm – 152 pages – Texte – Noir et blanc – Broché
![]()
INTRODUCTION
J’ai réuni dans cet ouvrage tout ce qui a rapport à l’origine et aux premiers progrès des arts chez les peuples indigènes de l’Amérique. Les deux tiers des planches qu’il renferme offrent des restes d’architecture et de sculpture, des tableaux historiques, des hiéroglyphes relatifs à la division du temps et au système du calendrier. À la représentation des monuments qui intéressent l’étude philosophique de l’homme sont jointes les vues pittoresques de différents sites, les plus remarquables du nouveau continent. Les raisons qui ont motivé ce mélange se trouvent énoncées parmi les considérations générales placées à la tête de cet essai.
La description de chaque planche forme, autant que la nature du sujet l’a permis, un mémoire particulier. J’ai donné plus de développement à celles qui peuvent répandre quelque jour sur les analogies que l’on observe entre les habitants des deux hémisphères. On est surpris de trouver, vers la fin du quinzième siècle, dans un monde que nous appelons nouveau, ces institutions antiques, ces idées religieuses, ces formes d’édifices qui semblent remonter, en Asie, à la première aurore de la civilisation. Il en est des traits caractéristiques des nations comme de la structure intérieure des végétaux répandus sur la surface du globe. Partout se manifeste l’empreinte d’un type primitif, malgré les différences que produisent la nature des climats, celle du sol et la réunion de plusieurs causes accidentelles.
Au commencement de la conquête de l’Amérique, l’attention de l’Europe était singulièrement fixée sur les constructions gigantesques de Couzco, les grandes routes tracées au centre des Cordillères, les pyramides à gradins, le culte et l’écriture symbolique des Mexicains. Les environs du port Jackson dans la Nouvelle-Hollande et l’île d’Otahiti n’ont pas été décrits plus souvent de nos jours, que ne l’étaient alors plusieurs contrées du Mexique et du Pérou. Il faut avoir été sur les lieux pour apprécier cette naïveté, cette teinte vraie et locale qui caractérisent les relations des premiers voyageurs espagnols. En étudiant leurs ouvrages, on regrette qu’ils ne soient pas accompagnés de figures qui puissent donner une idée exacte de tant de monuments détruits par le fanatisme ou tombés en ruine par l’effet d’une coupable insouciance.
L’ardeur avec laquelle on s’était livré à des recherches sur l’Amérique diminua dès le commencement du dix-septième siècle; les colonies espagnoles, qui renferment les seules régions jadis habitées par des peuples civilisés, restèrent fermées aux nations étrangères et récemment, lorsque l’abbé Clavigero publia en Italie son Histoire ancienne du Mexique, on regarda connue très douteux des faits attestés par une foule de témoins oculaires souvent ennemis les uns des autres.
Des écrivains célèbres, plus frappés des contrastes que de l’harmonie de la nature, s’étaient plu à dépeindre l’Amérique entière comme un pays marécageux, contraire à la multiplication des animaux et nouvellement habité par des hordes aussi peu civilisées que les habitants de la mer du Sud. Dans les recherches historiques sur les Américains, un scepticisme absolu avait été substitué à une saine critique. On confondait les descriptions déclamatoires de Solis et de quelques autres écrivains qui n’avaient pas quitté l’Europe, avec les relations simples et vraies des premiers voyageurs; il paraissait du devoir d’un philosophe de nier tout ce qui avait été observé par des missionnaires.
Depuis la fin du dernier siècle, une révolution heureuse s’est opérée dans la manière d’envisager la civilisation des peuples et les causes qui en arrêtent ou favorisent les progrès. Nous avons appris à connaître des nations dont les mœurs, les institutions et les arts diffèrent presque autant de ceux des Grecs et des Romains, que les formes primitives d’animaux détruits diffèrent de celles des espèces qui sont l’objet de l’histoire naturelle descriptive. La société de Calcutta a répandu une vive lumière sur l’histoire des peuples de l’Asie. Les monuments de l’Égypte, décrits de nos jours avec une admirable exactitude, ont été comparés aux monuments des pays les plus éloignés, et mes recherches sur les peuples indigènes de l’Amérique paraissent à une époque où l’on ne regarde pas comme indigne d’attention tout ce qui s’éloigne du style dont les Grecs nous ont laissés d’inimitables modèles.
Il aurait été utile de ranger les matériaux que renferme cet ouvrage, d’après un ordre géographique; mais la difficulté de réunir et de terminer à la fois un grand nombre de planches gravées en Italie, en Allemagne et en France, m’a empêché de suivre cette méthode. Le défaut d’ordre compensé, jusqu’à un certain point, par l’avantage de la variété, est d’ailleurs moins répréhensible dans les descriptions d’un Atlas pittoresque que dans un discours soutenu. Je tâcherai d’y remédier par une table dans laquelle les planches sont classées d’après la nature des objets qu’elles représentent.
J’ai tâché de donner la plus grande exactitude à la représentation des objets qu’offrent ces gravures. Ceux qui s’occupent de la partie pratique des arts savent combien il est difficile de surveiller le grand nombre de planches qui composent un atlas pittoresque. Si quelques-unes sont moins parfaites que les connaisseurs ne pourraient le désirer, cette imperfection ne doit pas être attribuée aux artistes chargés sous mes yeux de l’exécution de mon ouvrage, mais aux esquisses que j’ai faites sur les lieux dans des circonstances souvent très pénibles. Plusieurs paysages ont été coloriés parce que dans ce genre de gravure les neiges se détachent beaucoup mieux sur le fond du ciel, et que l’imitation des peintures mexicaines rendait déjà indispensable le mélange de planches coloriées et de planches tirées en noir. On a senti combien il est difficile de donner aux premières cette vigueur de ton que nous admirons dans les Scènes Orientales de M. Daniel.
Je me suis proposé, dans la description des monuments de l’Amérique, de tenir un juste milieu, entre deux routes suivies par les savants qui ont fait des recherches sur les monuments, les langues et les traditions des peuples. Les uns se livrant à des hypothèses brillantes, mais fondées sur des bases peu solides, ont tiré des résultats généraux d’un petit nombre de faits isolés. Ils ont vu en Amérique des colonies chinoises et égyptiennes; ils y ont reconnu des dialectes celtiques et l’alphabet des Phéniciens. Tandis que nous ignorons si les Osques, les Goths on les Celtes sont des peuples venus d’Asie, on a voulu prononcer sur l’origine de toutes les hordes du nouveau continent. D’autres savants ont accumulé des matériaux sans s’élever à aucune idée générale, méthode stérile dans l’histoire des peuples comme dans les différentes branches des sciences physiques. Puissé-je avoir été assez heureux pour éviter les écarts que je viens de désigner! Un petit nombre de nations, très éloignées les unes des autres, les Étrusques, les Égyptiens, les Tibétains et les Aztèques, offrent des analogies frappantes dans leurs édifices, leurs institutions religieuses, leurs divisions du temps, leurs cycles de régénération et leurs idées mystiques. Il est du devoir de l’historien d’indiquer ces analogies, aussi difficiles à expliquer que les rapports qui existent entre le sanskrit, le persan, le grec et les langues d’origine germanique : mais en essayant de généraliser les idées, il faut savoir s’arrêter au point où manquent les données exactes. C’est d’après ces principes que j’exposerai ici les résultats auxquels semblent conduire les notions que j’ai acquises jusqu’à ce jour sur les peuples indigènes du Nouveau Monde.
En examinant attentivement la constitution géologique de l’Amérique, en réfléchissant sur l’équilibre des fluides qui sont répandus sur la surface de la Terre, on ne saurait admettre que le nouveau continent soit sorti des eaux plus tard que l’ancien. On y observe la même succession de couches pierreuses que dans notre hémisphère, et il est probable que, dans les montagnes du Pérou, les granites, les schistes micacés ou les différentes formations de gypse et de grès ont pris naissance aux mêmes époques que les roches analogues des Alpes de la Suisse. Le globe entier paraît avoir subi les mêmes catastrophes. À une hauteur qui excède celle du Mont-Blanc se trouvent suspendues, sur la crête des Andes, des pétrifications de coquilles pélagiques. Des ossements fossiles d’éléphants sont épars dans les régions équinoxiales et, ce qui est très remarquable, ils ne se trouvent pas au pied des palmiers dans les plaines brûlantes de l’Orénoque, mais sur les plateaux les plus froids et les plus élevés des Cordillères. Dans le Nouveau Monde comme dans l’ancien, des générations d’espèces détruites ont précédé celles qui peuplent aujourd’hui la Terre, l’eau et les airs.
Rien ne prouve que l’existence de l’homme soit beaucoup plus récente en Amérique que dans les autres continents. Sous les tropiques, la force de la végétation, la largeur des fleuves et les inondations partielles ont mis de puissantes entraves aux migrations des peuples. De vastes contrées de l’Asie boréale sont aussi faiblement peuplées que les savanes du Nouveau-Mexique et du Paraguay et il n’est pas nécessaire de supposer que les contrées les plus anciennement habitées soient celles qui offrent la plus grande masse d’habitants.
Le problème de la première population de l’Amérique n’est pas plus du ressort de l’histoire, que les questions sur l’origine des plantes et des animaux et sur la distribution des germes organiques ne sont du ressort les sciences naturelles. L’histoire, en remontant aux époques les plus reculées, nous montre presque toutes les parties du globe occupées par des hommes qui se croient aborigènes, parce qu’ils ignorent leur filiation. Au milieu d’une multitude de peuples qui se sont succédés et mêlés, les uns aux autres, il est impossible de reconnaître avec exactitude la première base de la population, cette couche primitive au-delà de laquelle commence le domaine des traditions cosmogoniques.
Les nations de l’Amérique à l’exception de celles qui avoisinent le cercle polaire, forment une seule race caractérisée par la conformation du crâne, par la couleur de la peau, par l’extrême rareté de la barbe et par des cheveux plats et lisses. La race américaine a des rapports très sensibles avec celle des peuples mongols qui renferme les descendants des Hiong-nu, connus jadis sous le nom de Huns, les Kalkas, les Kalmuks et les Burattes. Des observations récentes ont même prouvé que non seulement les habitants d’Unalaska, mais aussi plusieurs peuplades de l’Amérique méridionale, indiquent par des caractères ostéologiques de la tête un passage de la race américaine à la race mongole. Lorsqu’on aura mieux étudié les hommes bruns de l’Afrique et cet essaim de peuples qui habitent l’intérieur et le nord-est de l’Asie et que des voyageurs systématiques désignent vaguement sous le nom de Tartars et de Tschoudes, les races caucasienne, mongole, américaine, malaye et nègre paraîtront moins isolées et l’on reconnaîtra, dans cette grande famille du genre humain, un seul type organique modifié par des circonstances qui nous resteront peut-être à jamais inconnues.
Quoique les peuples indigènes du nouveau continent soient unis par des rapports intimes, ils offrent dans leurs traits mobiles, dans leur teint plus ou moins basané et dans la hauteur de leur taille, des différences aussi marquantes que les Arabes, les Persans et les Slaves, qui appartiennent tous à la race caucasienne. Les hordes qui parcourent les plaines brûlantes des régions équinoxiales n’ont cependant pas la peau d’une couleur plus foncée que les peuples montagnards ou les habitants de la zone tempérée, soit que dans l’espèce humaine et dans la plupart des animaux il y ait une certaine époque de la vie organique au-delà de laquelle l’influence du climat et de la nourriture est presque nulle, soit que la déviation du type primitif ne devienne sensible qu’après une longue série de siècles. D’ailleurs, tout concourt à prouver que les Américains, de même que les peuples de race mongole, ont une moindre flexibilité d’organisation que les autres nations de l’Asie et de l’Europe.
La race américaine, la moins nombreuse de toutes, occupe cependant le plus grand espace sur le globe. Elle s’étend à travers les deux hémisphères, depuis les 68 degrés de latitude nord jusqu’aux 55 degrés de latitude sud. C’est la seule de toutes les races qui ait fixé sa demeure dans les plaines brûlantes voisines de l’Océan, comme sur le dos des montagnes, où elle s’élève à des hauteurs qui excèdent de 200 toises (≈ 390 m.) celle du Pic de Ténériffe.
Le nombre des langues qui distinguent les différentes peuplades indigènes paraît encore plus considérable dans le nouveau continent qu’en Afrique, où, d’après les recherches récentes de MM. Seetzen et Vater, il y en a au-delà de cent quarante. Sous ce rapport, l’Amérique entière ressemble au Caucase, à l’Italie avant la conquête des Romains, à l’Asie Mineure lorsqu’elle réunissait sur une petite étendue de terrain, les Ciliciens de race sémitique, les Phrygiens d’origine thrace, les Lydiens et les Celtes. La configuration du sol, la force de la végétation, la crainte qu’ont sous les tropiques, les peuples montagnards de s’exposer aux chaleurs des plaines, entravent les communications et contribuent à l’étonnante variété des langues américaines. Aussi l’on observe que cette variété est moins grande dans les savanes et les forêts du Nord que les chasseurs peuvent parcourir librement, sur les rivages des grandes rivières, le long des côtes de l’Océan et partout où les Incas ont étendu leur théocratie par la force des armes.
Lorsqu’on avance que se trouve plusieurs centaines de langues dans un continent dont la population entière n’égale pas celle de la France, on considère comme différentes des langues qui offrent les mêmes rapports entre elles, je ne dirai pas tels que l’allemand et le hollandais, ou l’italien et l’espagnol, mais que le danois et l’allemand, le chaldéen et l’arabe, le grec et le latin. À mesure que l’on pénètre dans le dédale des idiomes américains, on reconnaît que plusieurs sont susceptibles d’être groupés par familles, tandis qu’un très grand nombre restent isolés, comme le basque parmi les langues européennes et le japonais parmi les langues asiatiques. Cet isolement n’est peut-être qu’apparent et l’on est fondé à supposer que les langues qui semblent résister à toute classification ethnographique ont des rapports soit avec d’autres qui sont éteintes depuis longtemps, soit avec les idiomes de peuples que les voyageurs n’ont pas encore visités.
La plupart des langues américaines, même celles dont les groupes diffèrent entre eux comme les langues d’origine germanique, celtique et slave, offrent une certaine analogie dans l’ensemble de leur organisation, par exemple, dans la complication des formes grammaticales, dans les modifications que subit le verbe selon la nature de son régime et dans la multiplicité des particules additives (affixa et suffixa). Cette tendance uniforme des idiomes annonce, sinon une communauté d’origine, du moins une analogie extrême dans les dispositions intellectuelles des peuples américains depuis le Groenland jusques aux terres magellaniques.
Des recherches faites avec un soin extrême et d’après une méthode que l’on ne suivait pas jadis dans l’étude des étymologies ont prouvé qu’il y a un petit nombre de mots communs aux langues des deux continents. Dans quatre-vingt-trois langues américaines examinées par MM. Barton et Vater, on en a reconnu environ cent soixante-dix dont les racines semblent être les mêmes et il est facile de se convaincre que cette analogie n’est pas accidentelle, qu’elle ne repose pas simplement sur l’harmonie imitative, ou sur cette égalité de conformation dans les organes qui rend presque identiques les premiers sons articulés par les enfants. Sur cent soixante-dix mots qui ont des rapports entre eux, il y en a trois cinquièmes qui rappellent le mantchou, le tungouse, le mongol et le samojède, et deux cinquièmes qui rappellent les langues celtique et tschoude, le basque, le copte et le congo. Ces mots ont été trouvés en comparant la totalité des langues américaines avec la totalité des langues de l’Ancien Monde, car nous ne connaissons jusqu’ici aucun idiome de l’Amérique qui plus que les autres, semble se lier à un des groupes nombreux de langues asiatiques, africaines ou européennes. Ce que quelques savants, d’après des théories abstraites, ont avancé sur la prétendue pauvreté de toutes les langues américaines et sur l’extrême imperfection de leur système numérique, est aussi hasardé que les assertions sur la faiblesse et la stupidité de l’espèce humaine dans le nouveau continent, sur le rapetissement de la nature vivante, et sur la dégénération des animaux qui ont été portés d’un hémisphère à l’autre.
Plusieurs idiomes qui n’appartiennent aujourd’hui qu’à des peuples barbares, semblent être les débris de langues riches, flexibles et annonçant une culture avancée. Nous ne discuterons pas si l’état primitif de l’espèce humaine a été un état d’abrutissement, ou si les hordes sauvages descendent de peuples dont les facultés intellectuelles et les langues dans lesquelles ces facultés se reflètent étaient également développées : nous rappellerons seulement que le peu que nous savons de l’histoire des Américains tend à prouver que les tribus dont les migrations ont été dirigées du nord au sud, offraient déjà dans les contrées les plus septentrionales, cette variété d’idiomes que nous trouvons aujourd’hui sous la zone torride. On peut conclure de là, par analogie, que la ramification, ou, pour employer une expression indépendante de tout système, que la multiplicité des langues est un phénomène très ancien. Peut-être celles que nous appelons américaines n’appartiennent-elles pas plus à l’Amérique que le madjare ou hongrois et le tschoude ou linnois n’appartiennent à l’Europe.
On ne saurait disconvenir que la comparaison entre les idiomes des deux continents n’a pas conduit jusqu’ici à des résultats généraux : mais il ne faut pas perdre l’espérance que cette même étude ne devienne plus fructueuse lorsque la sagacité des savants pourra s’exercer sur un plus grand nombre de matériaux. Combien de langues de l’Amérique et de l’Asie centrale et orientale dont le mécanisme nous est encore aussi inconnu que celui du tyrhénien, de l’osque et du sabin! Parmi les peuples qui ont disparu dans l’Ancien Monde, il en est peut-être plusieurs dont quelques tribus peu nombreuses se sont conservées dans les vastes solitudes de l’Amérique.
Si les langues ne prouvent que faiblement l’ancienne communication entre les deux mondes, cette communication se manifeste d’une manière indubitable dans les cosmogonies, les monuments, les hiéroglyphes et les institutions des peuples de l’Amérique et de l’Asie. J’ose me flatter que les feuilles suivantes justifieront cette assertion, en ajoutant plusieurs preuves nouvelles à celles qui étaient connues depuis longtemps. On a tâché de distinguer avec soin ce qui indique une communauté d’origine, de ce qui est le résultat de la situation analogue dans laquelle se trouvent les peuples lorsqu’ils commencent à perfectionner leur état social.
Il a été impossible jusqu’ici de marquer l’époque des communications entre les habitants des deux mondes; il serait téméraire de désigner le groupe de peuples de l’ancien continent avec lequel les Toltèques, les Aztèques, les Muyscas ou les Péruviens offrent le plus de rapports, puisque ces rapports se manifestent dans des traditions, des monuments et des usages qui peut-être sont antérieurs à la division actuelle des Asiatiques en Mongols en Hindous, en Tongouses et en Chinois.
Lors de la découverte du Nouveau Monde, ou, pour mieux dire, lors de la première invasion des Espagnols, les peuples américains, les plus avancés dans la culture étaient des peuples montagnards. Des hommes nés dans les plaines sous des climats tempérés, avaient suivi le dos des Cordillères qui s’élèvent à mesure qu’elles se rapprochent de l’équateur. Ils trouvaient dans ces hautes régions une température et des plantes qui ressemblaient à celles de leur pays natal.
Les facultés se développent plus facilement partout où l’homme fixé sur un sol moins fertile et forcé de lutter contre les obstacles que lui oppose la nature, ne succombe pas à cette lutte prolongée. Au Caucase et dans l’Asie centrale, les montagnes arides offrent un refuge à des peuples libres et barbares. Dans la partie équinoxiale de l’Amérique où des savanes toujours vertes sont suspendues au-dessus de la région des nuages, on n’a trouvé des peuples policés qu’au sein des Cordillères : leurs premiers progrès dans les arts y étaient aussi anciens que la forme bizarre de leurs gouvernements qui ne favorisaient pas la liberté individuelle.
Le nouveau continent, de même que l’Asie et l’Afrique, présente plusieurs centres d’une civilisation primitive dont nous ignorons les rapports mutuels, comme ceux de Méroé, du Tibet et de la Chine. Le Mexique reçoit sa culture d’un pays situé vers le nord; dans l’Amérique méridionale, les grands édifices de Tiahuanaco ont servi de modèles aux monuments que les Incas élevèrent au Couzco. Au milieu des vastes plaines du Haut-Canada, en Floride et dans le désert limité par l’Orénoque, le Cassiquiaré et le Guainia, des digues d’une longueur considérable, des armes de bronze et des pierres sculptées, annoncent que des peuples industrieux ont habité jadis ces mêmes contrées que traversent aujourd’hui des hordes de sauvages chasseurs.
La distribution inégale des animaux sur le globe a exercé une grande influence sur le sort des nations et sur leur acheminement plus ou moins rapide vers la civilisation. Dans l’ancien continent, la vie pastorale forme le passage de la vie des peuples chasseurs à celle des peuples agricoles. Les ruminants, si faciles à acclimater sous toutes les zones, ont suivi le Nègre africain comme le Mongol, le Malaye et l’homme de la race du Caucase. Quoique plusieurs quadrupèdes et un plus grand nombre de végétaux soient communs aux parties les plus septentrionales des deux mondes, l’Amérique ne présente cependant dans la famille des bœufs, que le bison et le bœuf musqué, deux animaux difficiles à subjuguer, et dont les femelles ne donnent que peu de lait, malgré la richesse des pâturages. Le chasseur américain n’était pas préparé à l’agriculture par le soin des troupeaux et les habitudes de la vie pastorale. Jamais l’habitant des Andes n’a été tenté de traire le lama, l’alpaca et le guanaco. Le laitage était jadis une nourriture inconnue aux Américains, comme à plusieurs peuples de l’Asie orientale.
Nulle part on n’a vu le sauvage libre et errant dans les forêts de la zone tempérée abandonner, de son gré, la vie de chasseur pour embrasser la vie agricole. Ce passage, le plus difficile et le plus important dans l’histoire des sociétés humaines, ne peut être amené que par la force des circonstances. Lorsque dans leurs migrations lointaines, des hordes de chasseurs poussées par d’autres hordes belliqueuses parviennent dans les plaines de la zone équinoxiale, l’épaisseur des forêts et une riche végétation les font changer d’habitudes et de caractère. Il est des contrées entre l’Orénoque, l’Ucajalé et la rivière des Amazones, où l’homme ne trouve pour ainsi dire, d’espace libre que les rivières et les lacs. Fixées au sol sur le bord des fleuves, les tribus les plus sauvages environnent leurs cabanes de bananiers, de jatropha et de quelques autres plantes alimentaires.
Aucun fait historique, aucune tradition ne lient les nations de l’Amérique méridionale à celles qui vivent au nord de l’isthme de Panama. Les annales de l’empire mexicain paraissent remonter jusqu’au sixième siècle de notre ère. On y trouve les époques des migrations, les causes qui les ont amenées, les noms des chefs issus de la famille illustre de Citin qui, des régions inconnues d’Aztlan et de Téocolhuacan, ont conduit des peuples septentrionaux dans les plaines d’Anahuac. La fondation de Ténochtitlan, comme celle de Rome, tombe dans les temps héroïques et ce n’est que depuis le douzième siècle que les annales aztèques, semblables à celles des Chinois et des Tibétains, rapportent presque sans interruption les fêtes séculaires, la généalogie des rois, les tributs imposés aux vaincus, les fondations des villes, les phénomènes célestes et jusqu’aux événements les plus minutieux qui ont influé sur l’état des sociétés naissantes.
Quoique les traditions n’indiquent aucune liaison directe entre les peuples des deux Amériques, leur histoire n’en offre pas moins des rapports frappants dans les révolutions politiques et religieuses, desquelles date la civilisation des Aztèques, des Muyscas et des Péruviens. Des hommes barbus et moins basanés que les indigènes d’Anahuac, de Cundinamarca et du plateau du Couzco, paraissent sans que l’on puisse indiquer le lieu de leur naissance. Grands prêtres, législateurs, amis de la paix et des arts qu’elle favorise, ils changent tout d’un coup l’état des peuples qui les accueillent avec vénération. Quetzalcoatl, Bochica et Manco-Capac sont les noms sacrés de ces êtres mystérieux. Quetzalcoalt, vêtu de noir, en habit sacerdotal, vient de Panuco, des rivages du golfe du Mexique; Bochica, le Bouddha des Muyscas, se montre dans les hautes plaines de Bogota où il arrive des savanes situées à l’est des Cordillères. L’histoire de ces législateurs, que j’ai tâché de développer dans cet ouvrage, est mêlée de merveilles, de fictions religieuses et de ces traits qui décèlent un sens allégorique. Quelques savants ont cru reconnaître dans ces étrangers des Européens naufragés ou les descendants de ces Scandinaves qui depuis le onzième siècle, ont visité le Groenland, Terre-Neuve et peut-être même la Nouvelle-Écosse; mais pour peu que l’on réfléchisse sur l’époque des premières migrations toltèques, sur les institutions monastiques, les symboles du culte, le calendrier et la forme des monuments de Cholula, de Sogamozo et du Gouzco, on conçoit que ce n’est pas dans le nord de l’Europe que Quetzalcoatl, Bochica et Manco-Capac ont puisé leur code de lois. Tout semble nous porter vers l’Asie orientale, vers des peuples qui ont été en contact avec les Tibétains, les Tartares chamanistes et les Ainos barbus des îles de Jesso et de Sachalin.
En employant dans le cours de ces recherches les mots monuments du Nouveau Monde, progrès dans les arts du dessin, culture intellectuelle, je n’ai pas voulu désigner un état de choses qui indique ce qu’on appelle un peu vaguement une civilisation très avancée. Rien n’est plus difficile que de comparer des nations qui ont suivi des routes différentes dans leur perfectionnement social. Les Mexicains et les Péruviens ne sauraient être jugés d’après des principes puisés dans l’histoire des peuples que nos études nous rappellent sans cesse. Ils s’éloignent autant des Grecs et des Romains qu’ils se rapprochent des Étrusques et des Tibétains. Chez les Péruviens, un gouvernement théocratique, tout en favorisant les progrès de l’industrie, les travaux publics et tout ce qui indique, pour ainsi dire, une civilisation en masse, entravait le développement des facultés individuelles. Chez les Grecs, au contraire, avant le temps de Périclès, ce développement si libre et si rapide ne répondait pas aux progrès lents de la civilisation en masse. L’empire des Incas ressemblait à un grand établissement monastique, dans lequel était prescrit à chaque membre de la congrégation, ce qu’il devait faire pour le bien commun. En étudiant sur les lieux ces Péruviens qui à travers des siècles, ont conservé leur physionomie nationale, on apprend à apprécier à sa juste valeur le code des lois de Manco-Capac et les effets qu’il a produits sur les mœurs et sur la félicité publique. Il y avait une aisance générale et peu de bonheur privé; plus de résignation aux décrets du souverain que d’amour pour la patrie; une obéissance passive sans courage pour les entreprises hardies; un esprit d’ordre qui réglait minutieusement les actions les plus indifférentes de la vie et point d’étendue dans les idées, point d’élévation dans le caractère. Les institutions politiques les plus compliquées que présente l’histoire de la société humaine avaient étouffé le germe de la liberté individuelle ; et le fondateur de l’empire du Couzco, en se flattant de pouvoir forcer les hommes à être heureux, les avait réduits à l’état de simples machines. La théocratie péruvienne était moins oppressive sans doute que le gouvernement des rois mexicains, mais l’un et l’autre ont contribué à donner aux monuments, au culte et à la mythologie des deux peuples montagnards, cet aspect morne et sombre qui contraste avec les arts et les douces fictions des peuples de la Grèce.
Paris, au mois d’avril 1813.
| Poids | 230 g |
|---|---|
| Dimensions | 13 × 138 × 204 mm |
| Disponible | Oui |
| Genre | Théâtre |
| Version papier ou numérique ? | Version numérique (Epub ou PDF), Version papier |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.