Noa Noa, ce qu’exhale Tahiti – Paul Gauguin
12,00 €
Noa Noa, ce qu’exhale Tahiti
Paul Gauguin
Texte original de Paul Gauguin
Comprenant le texte de Paul Gauguin, une biographie, une interview et un catalogue des œuvres du premier voyage à Tahiti.
138 x 204 mm – 96 pages – Texte, photos et gravures – Noir et blanc – Broché
Description
« Noa Noa » de Paul Gauguin n’est pas simplement une série de gravures, mais un récit visuel captivant qui plonge le spectateur au cœur des expériences et des émotions de l’artiste pendant son séjour à Tahiti. Ce texte autobiographique, rédigé par Gauguin lui-même pour accompagner ses œuvres, offre un regard intime sur sa quête de sens, d’authenticité et d’inspiration dans un paradis exotique.
Le titre « Noa Noa », signifiant « parfumé » en tahitien, résonne comme une métaphore de l’atmosphère enivrante de l’île et de la vie que Gauguin y a menée. À travers ses mots, l’artiste partage ses impressions, ses observations et ses réflexions profondes sur la nature, la culture et la spiritualité tahitiennes. Il nous entraîne dans un voyage littéraire où chaque page dévoile un nouveau chapitre de sa vie, marqué par la quête de soi et la recherche d’une expression artistique plus authentique.
Gauguin transcende les frontières entre la réalité et le rêve dans « Noa Noa », créant une prose poétique qui reflète son désir de capturer l’essence même de Tahiti. Ses descriptions vivantes et sensorielles transportent le lecteur dans un monde où les parfums, les couleurs et les paysages deviennent des éléments d’une symphonie artistique. L’écriture de Gauguin est imprégnée de son amour pour la nature luxuriante, les danses enivrantes et les croyances mystiques qui ont façonné son expérience à Tahiti.
En révélant les coulisses de son processus créatif, Gauguin offre au public une compréhension plus profonde de son art. « Noa Noa » n’est pas simplement un ensemble d’images, mais un récit qui donne du contexte, de la vie et de la profondeur à toute son œuvre. C’est une invitation à explorer les motivations et les inspirations qui ont alimenté l’imagination de l’artiste, transformant chaque peinture, chaque dessin en une fenêtre sur son monde intérieur.
![]()
Voyage autour de l’île
M’écartant du chemin qui borde la mer je m’enfonce dans un fourré qui va assez loin dans la montagne. Arrive dans une petite vallée. Là, quelques habitants qui veulent vivre encore comme autrefois. Tableaux Matamua « Autrefois » et Hina maruru.
… Je continue ma route. Arrivé à Taravao (extrémité de l’île), le gendarme me prête son cheval. Je file sur la côte est, peu fréquentée par les Européens.
Arrivé à Faaone petit district qui annonce celui d’Hitia, un indigène m’interpelle :
– Eh ! L’homme qui fait des hommes (il sait que je suis peintre), viens manger avec nous ! (Haere mai ta maha), la phrase hospitalière.
Je ne me fais pas prier, son visage est si doux. Je descends de cheval ; il le prend et l’attache à une branche, sans aucune servilité, simplement et avec adresse.
J’entre dans une maison où plusieurs hommes, femmes et enfants sont réunis, assis par terre, causant et fumant.
– Où vas-tu ? me dit une belle Maorie d’une quarantaine d’années.
– Je vais à Hitia.
– Pour quoi faire ?
Je ne sais pas quelle idée me traversa la cervelle. Je lui répondis :
– Pour chercher une femme. Hitia en a beaucoup et des jolies.
– Tu en veux une ?
– Oui.
– Si tu veux je vais t’en donner une. C’est ma fille.
– Est-elle jeune ?
– Eha (« oui »).
– Est-elle jolie ?
– Eha.
– Est-elle bien portante ?
– Eha.
– C’est bien, va me la chercher.
Elle sortit un quart d’heure et tandis qu’on apportait le repas — des maioré, des bananes sauvages et quelques crevettes — la vieille rentra suivie d’une grande jeune fille, un petit paquet à la main.
À travers la robe de mousseline rose excessivement transparente on voyait la peau dorée des épaules et des bras ; deux boutons pointaient dru à la poitrine. Son visage charmant me parut différent de celui des autres que j’avais vus dans l’île jusqu’à présent et ses cheveux poussés comme la brousse, légèrement crépus. Au soleil une orgie de chromes. Je sus qu’elle était originaire des Tonga.
Quand elle fut assise près de moi je lui fis quelques questions.
– Tu n’as pas peur de moi ?
– Aita (« non »).
– Veux-tu toujours habiter ma case ?
– Eha.
– Tu n’as jamais été malade ?
– Aita.
Ce fut tout. Et le cœur me battait tandis qu’elle, impassible, rangeait devant moi par terre sur une grande feuille de bananier les aliments qui m’étaient offerts. Je mangeais, quoique de bon appétit, timidement. Cette jeune fille, une enfant d’environ treize ans, me charmait et m’épouvantait : que se passait-il dans son âme ? Et dans ce contrat si hâtivement conçu et signé j’avais la pudeur hésitante de la signature, moi presque un vieillard.
Peut-être la mère avait ordonné, débattant chez elle le marché. Et pourtant chez la grande enfant, la fierté indépendante de toute cette race, la sérénité d’une chose louable. La lèvre moqueuse quoique tendre indiquait bien que le danger était pour moi, non pour elle. Je ne dirai pas que sans peur je sortis de la case. Je pris mon cheval et je montai.
La jeune fille suivit derrière ; la mère, un homme, deux jeunes femmes, ses tantes disait-elle, suivirent aussi. Nous revenions à Taravao, à neuf kilomètres de Faaone.
Un kilomètre plus loin on me dit :
– Parahi teie (« Réside ici »).
Je descendis et j’entrai dans une grande case proprement tenue, et surtout presque l’opulence. L’opulence des biens de la terre, de jolies nattes par terre, sur du foin. Un ménage assez jeune, gracieux au possible, y demeurait, et la jeune fille s’assit près de sa mère qu’elle me présenta. Un silence. De l’eau fraîche que nous bûmes à la ronde comme une offrande, et la jeune mère l’œil ému et humide me dit :
– Tu es bon ?
Mon examen de conscience fait, je répondis avec trouble
– Oui.
– Tu rendras ma fille heureuse ?
– Oui.
– Dans huit jours, qu’elle revienne. Si elle n’est pas heureuse elle te quittera.
Un long silence. Nous sortîmes et de nouveau à cheval je repartis. Elles suivaient derrière. Nous rencontrâmes sur la route plusieurs personnes
– Et quoi, tu es maintenant la vahiné d’un Français ? Sois heureuse.
– Bonne chance.
Cette question des deux mères m’inquiétait. Je demandais à la vieille qui m’avait offert sa fille :
– Pourquoi as-tu menti ?
La mère de Tehamana (ainsi ma femme se nommait) me répondit :
– L’autre aussi est sa mère, sa mère nourricière.
Nous arrivâmes à Taravao. Je rendis le cheval au gendarme. La femme de celui-ci (une Française) me dit (sans malice du reste mais aussi sans finesse) :
– Quoi ! Vous ramenez avec vous une gourgandine…
Et ses yeux colères déshabillaient la jeune fille impassible devenue altière. La décrépitude regardait la nouvelle floraison, la vertu de la loi soufflait impurement sur l’impudeur native mais pure de la confiance, la foi. Et sur ce ciel si beau je vis douloureusement ce nuage sale de fumée. J’eus honte de ma race, mes yeux se détachèrent de cette boue — vite je l’oubliai pour se fixer sur cet or que j’aimais déjà, celui-là, je m’en souviens.
Les adieux de famille se firent à Taravao chez le Chinois qui vend là de tout, — et les hommes et les bêtes. Nous prîmes tous deux, ma fiancée et moi, la voiture publique qui nous menait à vingt-cinq kilomètres de là, à Mataiea, chez moi.
Ma nouvelle femme était peu bavarde, mélancolique et moqueuse. Tous deux nous nous observions : elle était impénétrable, je fus vite vaincu dans cette lutte. Malgré toutes mes promesses intérieures, mes nerfs prenaient vite le dessus et je fus en peu de temps pour elle un livre ouvert.
Informations complémentaires
| Poids | 110 g |
|---|---|
| Dimensions | 8 × 138 × 204 mm |
| Disponible | Oui |
| Genre | Écrit d'artiste |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.


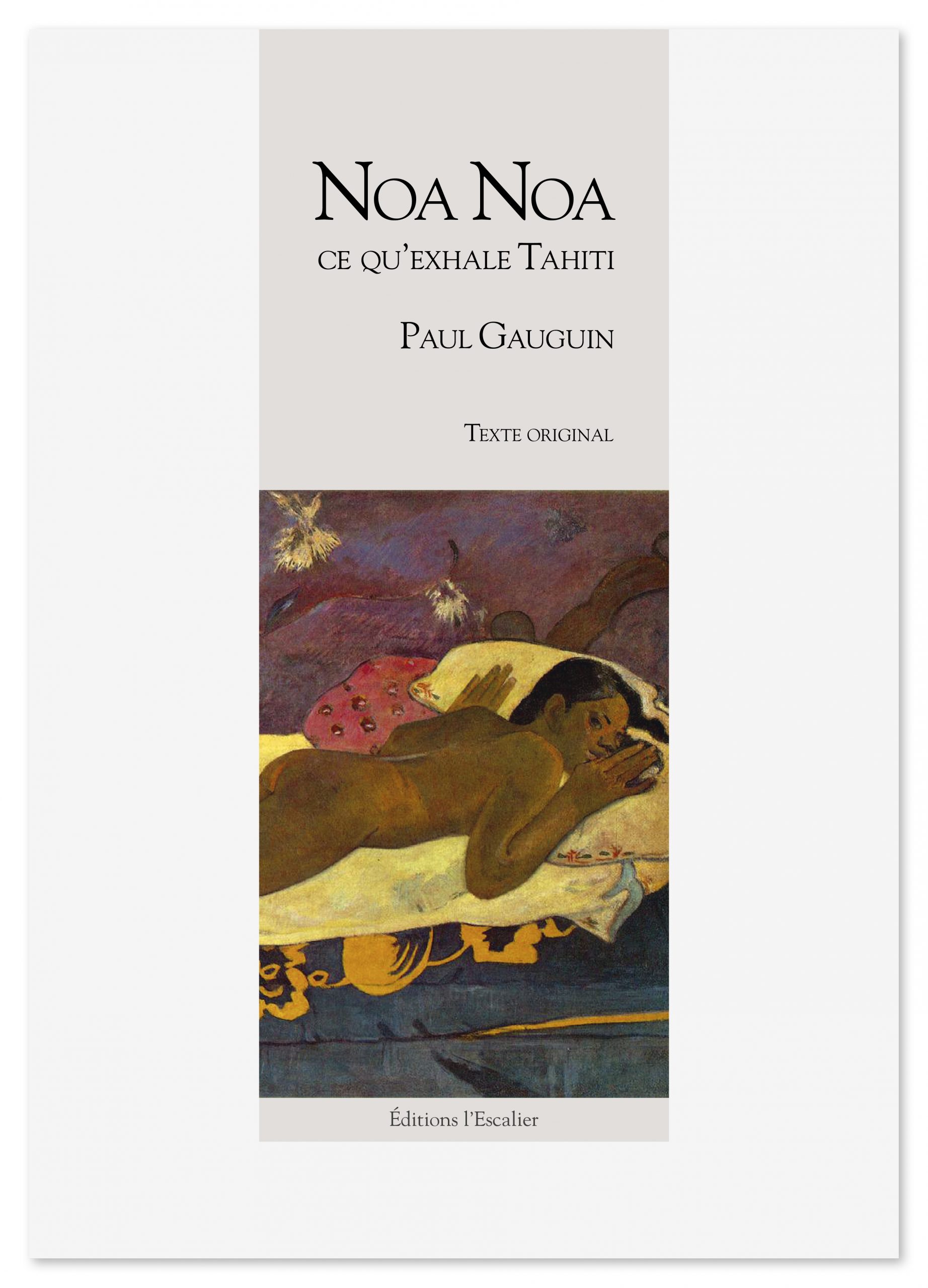


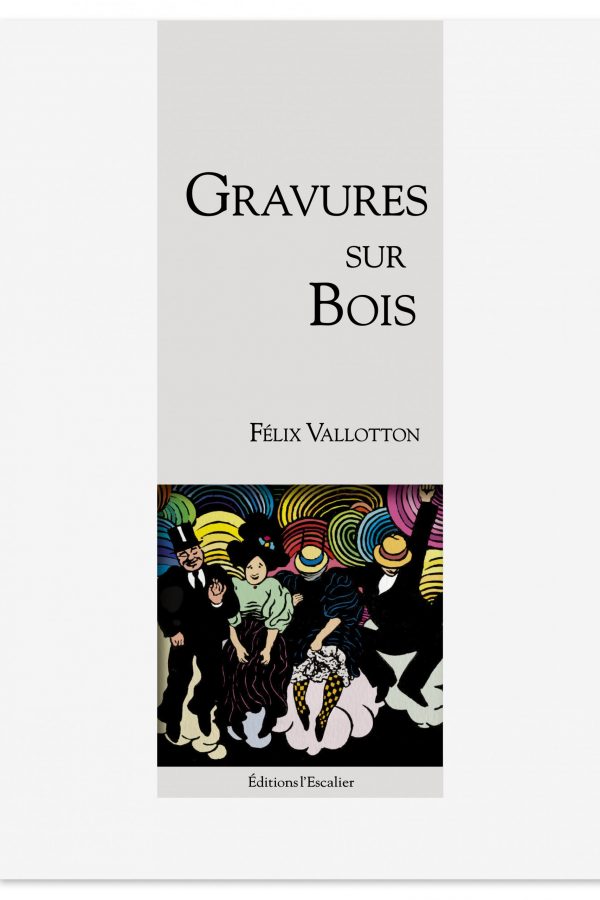
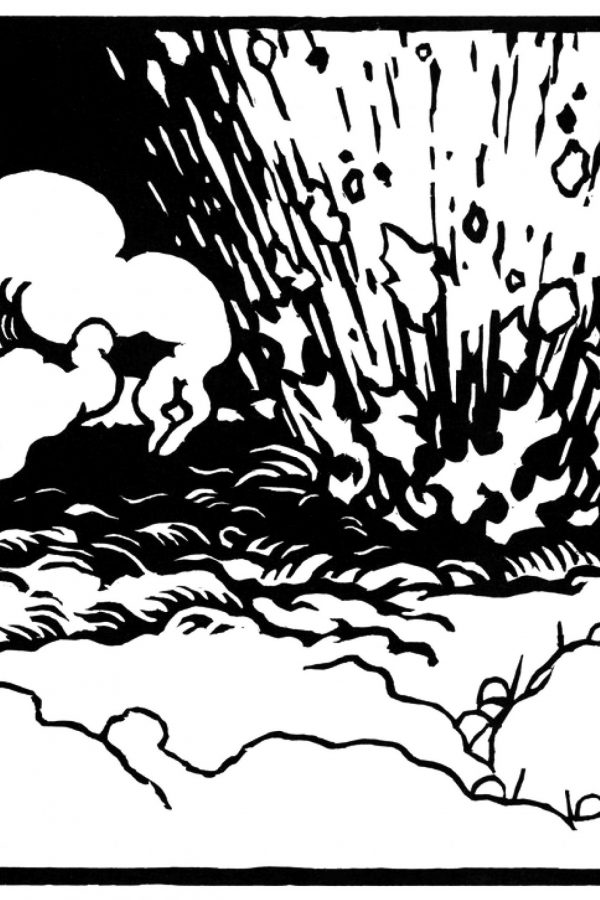
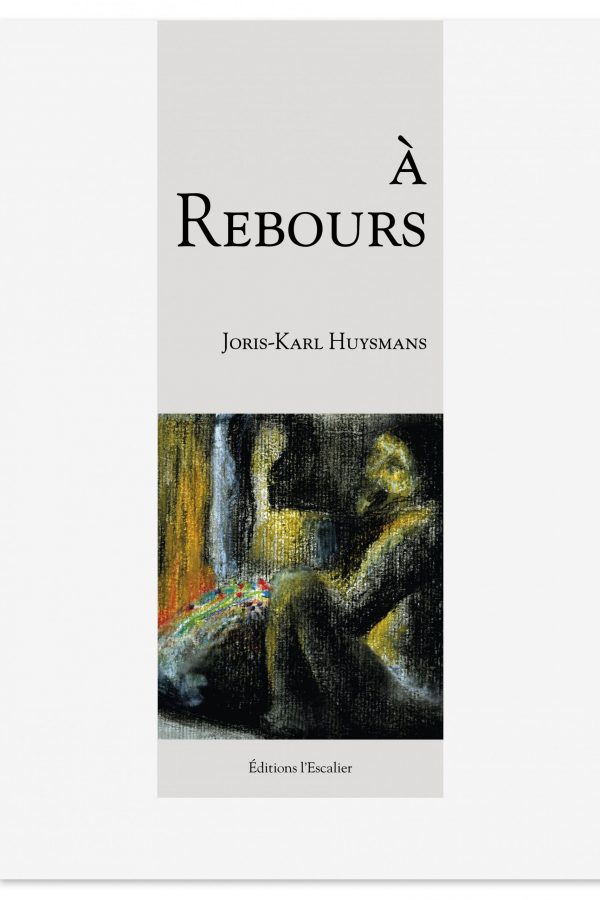
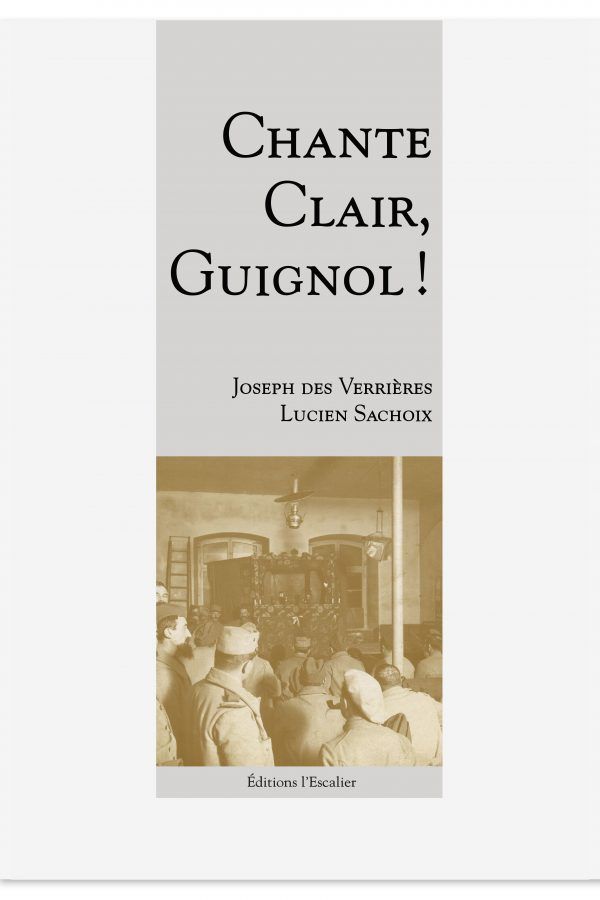

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.