Clélie, histoire romaine – Tome 10/10 – Amilcar
Plage de prix : 6,99 € à 23,00 €
Clélie, histoire romaine – Tome 10/10 – Amilcar
138 x 204 mm – 210 pages – Texte – Noir et blanc – Broché
Description
Clélie – Tome 10 sur 10
L’ensemble des 10 tomes de Clélie, histoire romaine, a été publié entre 1654 et 1660, signé par le frère de Madeleine de Scudéry.
Cette présente édition de 2022 rassemble le texte intégral de ce roman précieux publié en plein âge baroque. Seuls certains termes ont été actualisés et certains aspects de la structure du texte modernisés, restant au plus près du texte original tout en favorisant sa lecture.
![]()
Pendant que Clélie s’affligeait au camp de la prison d’Aronce, Horace s’en réjouissait en secret à Rome, n’étant pas possible qu’un rival quelque généreux qu’il puisse être, ne soit pas bien aise d’un malheur qui peut contribuer à le rendre heureux. Cependant, il pressait Publicola autant qu’il pouvait, et le second consul aussi, de hâter l’exécution du traité. Herminius n’en faisait pas moins, afin de voir revenir Valerie, mais pour Émile, Mutius, et Spurius, ils eussent mieux aimé ne revoir jamais leur maîtresse, que de la voir rendre Herminius heureux. Octave étant devenu amoureux d’Hermilie, désirait aussi ardemment que la paix fût exécutée. Clelius en avait une impatience extrême pour faire épouser Clélie à Horace, et tous les Romains en général supportant impatiemment que Tarquin et Tullie fussent encore si près de Rome faisaient des vœux continuels pour l’achèvement de la paix. Pour Artemidore, il lui amenda si considérablement en peu de jours, que ses médecins assurèrent qu’il sortirait bientôt. La Princesse des Leontins lui manda pourtant qu’elle l’irait bientôt voir pour une chose importante, mais qu’étant assez nécessaire auprès de Porsenna pour rendre office à Aronce, elle ne pouvait lui dire précisément quand ce serait. Comme Zenocrate avait l’esprit préoccupé de sa jalousie, il fut fort affligé de ce message qui lui persuadait qu’on ne pouvait manquer à visiter un frère que pour servir un amant, et non pas un ami. D’autre part, Berelise et Clidamire voyant Artemidore mieux, firent dessein d’aller à Preneste, et Anacreon s’offrit d’aller avec elles. Mais en attendant, tout ce qu’il y avait d’honnêtes gens à Rome étaient toujours chez ces deux belles personnes en l’absence de Clélie et de Valerie. Comme leurs intérêts étaient assez difficiles à démêler quoiqu’elles voulussent vivre très civilement ensemble, il était toujours assez aisé de s’apercevoir que leurs cœurs n’étaient pas d’accord. Pour Amilcar, quoique Plotine ne fût pas à Rome et qu’on pût dire que selon lui, son cœur devait être au camp puisque Plotine y était, il ne laissait pas de se divertir selon l’occasion, et de rire de la haine que Damon avait pour lui. Car il voyait bien qu’il le haïssait encore plus, parce qu’il avait fait ce dialogue de raillerie contre la secte de Pythagore, que parce qu’il était son rival. Acrise ne l’aimait pas trop non plus, parce qu’il l’empêchait souvent de parler autant qu’il en avait envie, et qu’il remarquait bien qu’on l’écoutait plus favorablement que lui. Mais pour Horace, il avait toujours le cœur rempli d’espérance, s’imaginant toujours que dès que Clélie ne pourrait plus espérer d’épouser Aronce, elle se résoudrait d’obéir à Clelius. Pour Themiste et Merigene, ils se disposaient à partir bientôt, mais en attendant ils étaient presque toujours chez Clidamire, auprès de qui était Berelise et chez qui Cefonie était souvent. La prison d’Aronce affligeait sans doute tous ceux qui le connaissaient, et ceux mêmes seulement qui avaient entendu parler de lui, mais comme ils ne jugeaient pas qu’il pût être accusé d’aucun crime, ils le regardaient comme un prisonnier d’État dont la vie était en sûreté, puisqu’il était fils de celui qui l’avait fait arrêter. Ainsi, quelques-uns de ses amis ne laissaient pas de se divertir quand l’occasion s’en présentait, car il se trouve très peu de gens qui sentent vivement tous les malheurs de ceux qu’ils aiment, ou qui, du moins, les sentent longtemps. En effet, presque toutes les douleurs de compassion sont des douleurs passagères dont le moindre plaisir soulage, et il n’y a sans doute qu’un très petit nombre de personnes qui soient assez généreuses pour entrer de bonne foi dans tous les intérêts de ceux qu’ils aiment, et dont le cœur soit assez sensible pour être pénétré de la douleur d’autrui. De sorte que comme Amilcar avait en sa propre joie un contrepoison contre toutes sortes de tristesses, soit qu’il fût à Rome, soit qu’il fût au camp, il était toujours agréable et comme il s’était acquis un droit de dire les vérités les plus difficiles à écouter sans qu’on s’en fâchât, il parlait à Berelise et à Clidamire de leurs différends avec toute sorte de liberté. Il leur disait quelquefois les choses du monde les plus embarrassantes pour elles, si elles n’eussent pas entendu raillerie, et les plus agréables pour ceux qui les écoutaient. « Mais, lui disait un jour agréablement Berelise en présence de Cefonie, de Clidamire et d’Anacreon, je crains fort qu’Herminius ne vous ait trop persuadé d’aimer la vérité le jour qu’il parla si bien contre le mensonge, car j’ai remarqué depuis quelque temps que vous dites votre avis sans vous contraindre de toutes les choses que vous voyez,
— Mais puisque je le dis sans fâcher personne, reprit Amilcar, de quoi me blâmez-vous ?
— Je vous blâme, reprit Berelise, de ce que vous donnez un exemple qui sera si mal suivi que tous ceux qui voudront vous imiter seront insupportables. Car enfin, il est bien plus difficile qu’on ne croit de faire guerre à ses amis sans leur déplaire,
— Il est vrai, dit Clidamire, que pour l’ordinaire on va un peu plus loin qu’il ne faudrait,
— En effet, ajouta Anacreon, ce n’est pas assez que de dire précisément ce que sa vraie raison permet de dire, car il faut bien connaître ceux à qui l’on parle librement devant que de leur parler ainsi. Car pour l’ordinaire, ceux qui aiment le mieux à faire la guerre, sont ceux qui ne veulent pas qu’on la leur fasse. Ainsi, il faut bien considérer ceux à qui on la fait et bien choisir les paroles dont on se sert, puisque bien souvent un mot un peu plus fort, fait d’une raillerie douce une raillerie aigre.
— Croyez-moi, dit Cefonie, il faut quelquefois encore quelque chose moins qu’un mot pour faire ce changement, car le ton de la voix seulement change le sens d’un discours, un souris malicieux fait une satire d’une simple raillerie, et il n’y a rien enfin, où il faille plus de jugement qu’à faire la guerre à quelqu’un sans le fâcher. Et pour moi, je n’ai jamais vu que Plotine et Amilcar qui aient bien su faire cette innocente guerre qui rend la conversation divertissante et qui finit toujours par la joie, quand ceux qui la font ont de la bonté et de l’esprit.
— Mais, reprit Anacreon, encore est-il juste d’excuser ceux qui ne peuvent pas être aussi adroits et aussi agréables que Plotine et Amilcar,
— De grâce Anacreon, reprit cet aimable Africain, ne vous engagez point à me louer, car comme nous faisons tous deux des vers, on pourrait bien nous mettre au rang de ces poètes qui ne font autre chose que s’entre-louer en vers les uns les autres, quoique bien souvent ils se déchirent en prose. Il est vrai, que pour cette dernière chose elle ne nous peut jamais convenir, car je sais que vous dites beaucoup plus de bien de moi que je n’en mérite, et que j’en dis autant de vous que vous en méritez.
— Pour moi, dit Clidamire, je vous avoue que je hais fort ces gens qui louent indifféremment toutes sortes de personnes et toutes sortes de choses, et qu’il n’y a rien de moins obligeant que des louanges profanées qui ont servi mille et mille fois à louer des gens qu’il fallait blâmer.
— Pour les louanges sans sujet reprit Berelise, je les hais aussi bien que vous, mais je vous avoue que j’aime assez à excuser les défauts d’autrui,
— Il y en a pourtant quelques-uns, répliqua Anacreon, qui ne méritent pas trop d’être excusés,
— Mais encore, dit Clidamire, à quoi les peut-on connaître ?
— Il n’est pas trop difficile, dit Anacreon, car enfin selon moi, il est plus juste d’excuser les défauts qui sont ordinaires à l’état où l’on est, que ceux qui sont opposés à l’âge ou à la condition où sont ceux qui les ont. En effet, un vieil avare mérite plutôt d’être excusé qu’un jeune, car encore qu’il y ait de la folie à amasser des trésors, lorsque l’on n’en a plus guère affaire, néanmoins comme c’est un défaut qui est bien souvent une suite de la vieillesse, il faut excuser ceux qui l’ont. Par la même raison, il faut ne trouver pas aussi étrange qu’un vieillard aime à raconter ce qu’il a vu dans sa jeunesse, et soit un peu sujet aux longs récits, que si c’était un jeune homme qui sans avoir encore rien vu, voulût être plus longtemps à conter ce peu qu’il a vu, qu’il n’a été à le voir.
— Cela est assurément fort juste, dit Cefonie, et je trouve même que non seulement il faut excuser les défauts qui semblent être attachés à l’âge, ou à la condition dont on est, mais même ceux des nations, car enfin, chaque peuple a ses vertus et ses défauts.
— Ce que vous dites est vrai, reprit Clidamire, mais y a-t-il des conditions qui entraînent des défauts avec elles ?
— Il y en a sans doute, reprit Amilcar, car par exemple, est-il possible que ceux qui sont dans les premiers emplois des républiques, puissent ne manquer jamais à ce qu’ils promettent ?
— Ha ! Amilcar, s’écria Berelise, malheureux sont ceux qui par la grandeur de leurs emplois sont contraints de manquer souvent à leur parole, et bien heureux sont ceux qui dans les grandes fortunes, conservent exactement les vertus des particuliers, et qui de peur de se manquer à eux-mêmes, ne manquent jamais à personne,
— Quoi qu’il en soit, dit Amilcar, je suis persuadé que ceux qui sont dans un certain rang ne peuvent pas toujours faire tout ce qu’ils veulent, et qu’ils méritent d’être excusés s’il paraît quelquefois qu’ils ne font pas tout ce qu’ils doivent, parce que bien souvent on ignore ce qui les pourrait justifier. Mais pour parler un peu moins sérieusement, n’est-il pas vrai que lorsqu’un amant est bien longtemps absent de sa maîtresse, s’il trouve quelque belle personne qui semble lui dire par ses regards qu’elle n’est pas trop marrie qu’on l’aime, il mérite d’être excusé s’il lui dit quelques douceurs ?
— Pour moi je suis de votre opinion, dit Clidamire,
— Je m’imaginais bien que vous en seriez, répliqua Berelise en souriant, mais pour moi qui mets la fidélité au-dessus de toutes choses, je vous assure que je ne puis excuser les amants infidèles quoique j’excuse volontiers toutes les autres faiblesses,
— Il y en a pourtant un si grand nombre, reprit Anacreon, qu’il serait assez nécessaire de les excuser, de peur d’être obligé à blâmer presque tous les hommes,
— Au contraire, répliqua Berelise, c’est parce qu’il y en a trop qu’il se faut bien garder de les excuser, de peur d’en accroître le nombre qui n’est déjà que trop grand !
— Pour moi, dit Clidamire, je crois qu’il y en a encore plus qu’on ne pense, car j’en connais qui tiennent pour maxime qu’il faut toujours parler de constance, et ne laisser pas d’être inconstant quand il s’en présente quelque occasion favorable.
— Pour ce qui me regarde, dit Anacreon, je crois qu’il serait plus galant de faire un peu plus l’inconstant qu’on ne le serait en effet,
— Et pour moi, dit Amilcar, je conclus qu’il faut toujours faire ce qui plaît, sans considérer si l’on est constant ou inconstant, parce que le plaisir à proprement parler, ne consiste pas aux choses que nous faisons, mais seulement à faire sa volonté. Car par exemple, j’avoue que si je devais avoir une longue amour en un lieu où je n’en pusse avoir d’autre, je pense que pour éviter la tiédeur qui est assez ordinaire aux grandes amours, je voudrais, du moins, renouveler l’ardeur de ma passion en faisant de temps en temps quelque petite querelle à ma maîtresse, afin de rompre presque avec elle et que notre raccommodement me parût une espèce de nouveauté,
— Vous êtes trop ingénieux de la moitié, reprit Berelise, et je ne doute pas que si Plotine est longtemps au camp de Porsenna vous ne cherchiez à vous consoler à Rome auprès de quelque belle, lorsque vous serez contraint d’y venir,
— Ha ! charmante Berelise, s’écria-t-il, ne m’allez pas faire la guerre trop cruellement, et croyez que j’ai plus d’amour pour Plotine, que je n’en ai eu pour six autres maîtresses que j’avais un jour tout à la fois,
— Je vois bien, dit alors Anacreon, qu’il est assez à propos que je détourne un peu la conversation, et que je demande à la compagnie pourquoi l’amour étant un sentiment universel que la nature inspire et qu’elle ne peut jamais manquer d’inspirer, les hommes se sont avisés de la condamner, ou du moins, d’en faire un si grand mystère ?
— Pour la rendre plus agréable reprit Amilcar avec précipitation, car sans toutes les façons qu’on y fait, l’amour ne serait pas ce qu’elle est. Joint qu’à parler sincèrement, ajouta-t-il, les cérémonies sont la principale beauté de beaucoup de choses, par exemple ôtez à un sacrifice le temple, l’autel, le bûcher, les vases, les couteaux sacrés, les bandelettes des victimes, et les fleurs qui les couronnent, vous ne trouverez plus qu’un misérable animal, qui n’est pas plus beau qu’un autre de son espèce, car bien souvent les hommes sont assez méchants pour ne choisir pas bien les victimes,
— De grâce, dit alors Cefonie, ne confondons point les choses, raillons de l’amour tant qu’il vous plaira, et ne mêlez jamais la religion parmi vos folies, car vous avez trop d’esprit pour faire ce que font quelques jeunes gens qui viennent dans le monde, qui croient qu’il n’y a rien de plus propre à leur donner la réputation de grand esprit que de ne s’assujettir pas aux sentiments de leurs pères. Cependant, il n’y a rien de plus contraire à la vraie raison, ni rien qui fasse plutôt passer un homme pour évaporé,
— En effet, dit Berelise, il ne faut jamais se faire un chemin particulier dans les choses de cette nature, il faut suivre hardiment les gens sages qui sont dans le chemin ordinaire, et ne s’aller pas égarer croyant trouver un chemin plus commode,
— Mais prenons garde que nous ne nous égarions nous-même, dit Amilcar en riant, car nous voilà bien éloignés du commencement de notre discours, qui a commencé par l’art de faire la guerre à ses amis,
— Nous n’en sommes pas encore trop loin, répliqua Cefonie en souriant, car en parlant comme vous faites, vous me faites vous-même la guerre, et vous m’enseignez comme il la faut faire aux autres. »
Comme Cefonie parlait ainsi, on vint avertir Amilcar qu’il venait d’arriver un étranger chez lui qui demandait à lui parler avec beaucoup d’empressement, de sorte qu’il fut contraint de s’en aller. Un moment après, Themiste entra, qui apprit à la compagnie qu’il courait bruit que Porsenna accusait Aronce d’un crime effroyable. Herminius vint un instant après qui dit avoir ouï-dire la même chose, mais que quoi qu’on en dît, il était fortement persuadé qu’Aronce était innocent. « Mais encore, dit Berelise, de quoi l’accuse-t-on ? »
À peine eut-elle prononcé ces paroles, que la Princesse des Leontins entra, qui après avoir été voir Artemidore, passa chez Clidamire pour voir Berelise. De sorte que dès que la première civilité fut passée, « De grâce, Madame, lui dit Herminius, ayez la bonté d’apprendre à la compagnie s’il est vrai que le Roi d’Étrurie accuse le Prince son fils, d’un crime effroyable ?
— Hélas ! reprit-elle en soupirant, il n’est que trop vrai qu’il l’accuse d’avoir été d’intelligence avec Mutius pour le faire tuer, et on lui a si fortement persuadé que ce malheureux prince, par un excès d’amour, s’est porté à conjurer contre lui, que la Reine d’Étrurie et moi avons bien de la peine à retenir sa colère,
— Quoi, Madame, reprit Herminius, Porsenna peut soupçonner le plus vertueux prince du monde, d’avoir eu un dessein comme celui-là ?
— Oui, répliqua-t-elle, et ce qu’il y a de cruel, c’est qu’il ne veut pas encore dire par quelle voie on lui a persuadé ce qu’il croit. Il est vrai que personne ne doute que ce ne soit un artifice de la cruelle Tullie,
— Mais peut-on croire une femme, reprit Cefonie, qui a passé avec son chariot sur le corps de son père ?
— Il paraît bien qu’on la croit, répliqua-t-elle, puisqu’Aronce est prisonnier, et que Porsenna dit hier tout haut que le Prince son fils, était un parricide. De sorte que voulant le servir en tout ce que je pourrai, ajouta cette princesse, je suis venue voir le Prince mon frère, afin qu’il voie Mutius et qu’il l’oblige à nous aider à justifier Aronce, qu’on dit qui l’a fait agir. Mais par malheur on ne l’a pu trouver en nulle part, quoiqu’Artemidore l’ait envoyé chercher chez lui,
— Je le rencontrai pourtant hier au soir dans les rues, dit Herminius,
— Je le vis aussi bien que vous, répondit Themiste, mais je l’ai vu de mes fenêtres sortir ce matin à cheval, en habit de campagne, avec deux esclaves seulement,
— S’il était allé loin, répliqua Lysimene, cela serait fâcheux pour Aronce, car on croirait que ce serait une fuite, et qu’au lieu d’avoir voulu seulement délivrer Rome, il aurait conjuré avec lui. Cependant, ajouta-t-elle, il serait fort à propos de savoir chez lui, où il est allé,
— Je me charge de ce soin-là, dit Herminius, car il y a un de mes gens qui connaît particulièrement un des siens. »
Et en effet, Herminius envoya à l’heure même un des siens s’informer de ce que Lysimene voulait savoir. Mais on revint lui dire qu’après avoir eu une assez longue conversation avec Publicola, il était parti fort chagrin, sans vouloir dire où il allait. De sorte que cela affligea toute la compagnie. « Ce n’est pas, dit alors Herminius, que je croie possible que Porsenna puisse faire mourir Aronce,
— Je ne veux pas le croire, reprit la Princesse des Leontins, mais je ne puis m’empêcher de le craindre. Porsenna est pourtant un fort grand prince et qui a même de l’humanité, mais la cruelle Tullie me fait peur, et tous les Tarquin à la réserve de Titus, me font horreur. Il est vrai qu’Aronce a diverses personnes importantes qui le protègent, car la généreuse Melinthe n’oublie rien pour le servir, la belle Hersilie qui est auprès de Galerite, n’en fait pas moins, Lucilius et un frère qu’il a, s’y emploient aussi bien qu’elle, Telane, et même Titus font tout ce qu’ils peuvent, et les amants de Terentia et d’Aurelise, n’y oublient rien. Pour Galerite, elle fait tout ce qu’elle peut et pour moi, quand je serais sœur d’Aronce, je ne pourrais faire que ce que je fais,
— Mais, Madame, dit Berelise, Clélie sait-elle de quoi on accuse Aronce ?
— Je crois qu’elle le sait, reprit Lysimene, et ce qui la rend encore plus digne de pitié, c’est qu’elle ne peut servir ce prince et que pour sa persécution, Sextus est redevenu aussi amoureux d’elle qu’il l’a jamais été, et peut être plus qu’il ne le fut jamais, de Lucrèce. De sorte qu’elle est assurément digne de compassion, car encore que Porsenna ne doive pas violer le droit des gens, et qu’il y ait apparence que les otages sont en sûreté dans son camp, elle a pourtant de très fâcheuses heures et la Reine d’Étrurie et moi avons prié Lucilius et Telane de prendre un soin particulier de faire garder ces vingt belles Romaines,
— Puisque la généreuse Melinthe, Lucilius, et son illustre frère, reprit Herminius, sont du parti d’Aronce, j’en ai beaucoup de consolation,
— Comme je me trouvais mal lorsque Lucilius vint ici, répliqua Berelise, je ne le vis pas, mais j’en ai entendu dire beaucoup de bien,
— On ne peut vous en avoir trop dit, reprit Lysimene, et pour vous faire voir quels sont ces deux illustres amis d’Aronce, je m’en vais vous les représenter. Mais pour commencer par celui qui n’est pas venu à Rome et qui s’appelle Theomene, vous saurez qu’il n’est pas possible d’avoir plus de véritable vertu qu’il en a. Je ne vous dis point que sa naissance est très noble, car puisque vous n’ignorez pas qu’il est frère de la généreuse Melinthe vous savez que sa maison est très ancienne et qu’il a eu un père d’un très grand mérite. Pour sa personne, il est de taille médiocre, ses cheveux sont châtains, il a les yeux noirs, le visage rond, et l’on trouve dans sa physionomie quand on l’observe bien, quelque chose de fin et de bon tout ensemble, et il sourit toujours si à propos que quelquefois il fait connaître en un moment qu’il entend des choses qu’on ne pourrait raconter en un jour si on l’entreprenait. Theomene est né avec beaucoup d’esprit, mais principalement avec de cet esprit qui peut et qui sait discerner les choses, qui les examine et les approfondit, et qui ne veut rien aimer, ni rien choisir sans connaissance. De cet esprit, dis-je, qui ne se mêle de rien sans appeler le jugement à son secours. Cependant, Theomene ne laisse pas d’avoir l’imagination vive et prompte, et c’est un des hommes du monde qui devine les choses les plus difficiles, avec le plus de facilité. En effet, je l’ai vu quelquefois en des lieux où l’on n’eût pas dit qu’il eût songé à ce qui s’y passait, et cependant, non seulement il avait remarqué jusqu’aux plus petites choses qui s’y étaient dites ou faites, mais il avait même deviné les intérêts les plus secrets de tous ceux qui composaient la compagnie. Theomene n’a pas seulement un esprit très pénétrant et très solide, il l’a encore cultivé avec beaucoup de soin. En effet, il juge fort bien de toutes choses, il connaît finement les beaux ouvrages, et ne loue et ne blâme jamais rien dont il ne sache bien rendre raison. Il a fait dans le commencement de sa vie des vers fort amoureux et fort galants, et il en fait encore quand il veut de très agréables. Il parle fort juste, et sa conversation est fort aimable, car enfin, il n’y a rien dont on ne puisse s’entretenir avec lui, depuis l’agriculture jusqu’à l’astrologie, et depuis la galanterie la plus enjouée, jusqu’à la politique la plus élevée. Et pour moi, je suis quelquefois demeurée fort surprise de voir que Theomene était également bien instruit des grandes et des petites nouvelles, et de trouver qu’un homme aussi sage que lui ne laissait pas d’être parfaitement informé de toutes les folies de son siècle. Si la profession que Theomene a choisie ne l’avait pas obligé à une retenue particulière, son âme aurait été capable de beaucoup d’amour, mais ç’aurait été d’une amour véritable, tendre, ferme, et galante tout ensemble. Mais comme sa fortune est disposée d’une autre manière, il connaît présentement l’amour en autrui, et a abandonné son cœur à l’amitié, dont il se trouve fort bien, car il a beaucoup d’amis et beaucoup d’amies dont il est fort estimé et fort aimé. Il est né officieux, équitable, bon et généreux. Il est exact dans les petites et dans les grandes choses, il sait quand il faut prendre courageusement les intérêts de ceux qu’il aime, s’intéresser à leur gloire, sentir les injures qu’on leur fait, aimer tout ce qu’ils aiment, haïr tout ce qui les hait, et mépriser tous ceux qui ne les estiment pas. Il n’est point de ces gens qui biaisent en certaines occasions, qui voudraient conserver les amis et les ennemis, et qui sans distinguer les vertueux de ceux qui ne le sont pas, manquent quelquefois à ceux qui ne leur ont jamais manqué. Au contraire Theomene est fidèle en toutes rencontres, sincère en toutes occasions, et toujours très sensible à tout ce qui touche ses véritables amis. Je m’arrête peut-être un peu trop longtemps à louer Theomene de cette bonne qualité qu’il a, mais je vous avoue que c’est parce qu’elle est assez rare présentement, et que je la crois nécessaire à un homme d’honneur. En effet, je trouve que quand nos premiers amis, ou nos premières amies, nous disent qu’ils ont des ennemis qu’il faut combattre, la première chose qu’il faut leur dire c’est où sont-ils, et non pas qui sont-ils, parce que quels qu’ils soient il faut absolument être contre eux. Mais quand au contraire, on a quelques amis du second ordre qui viennent nous dire qu’ils ont des ennemis, il faut promptement leur demander qui sont-ils, afin de ne s’exposer jamais à rien faire contre ses vrais amis, qu’on sait bien qui ne peuvent avoir tort. Mais pour Theomene, il sait si parfaitement toutes les règles de la véritable amitié, et son cœur est naturellement si porté à les suivre, qu’il n’a garde d’y manquer. Enfin, Theomene est doux, sociable, complaisant, sage et discret. Il a de la modération et de l’équité, il s’accommode du monde et s’en divertit, et sait trouver dans la solitude toutes les douceurs qu’elle peut donner. Il sait se faire à lui-même un spectacle de la cour qui l’amuse, et ce qui est le plus digne de louanges, il sait y vivre sans que sa vertu s’altère par tous les mauvais exemples qu’il y voit. Voilà donc quel est Theomene, qui outre tout ce que je viens de dire, a une si grande inclination à honorer les gens qui ont de la vertu, qu’on peut assurer que s’il était maître de toutes les grâces que la fortune peut faire, il n’y aurait pas une seule personne vertueuse qui eût sujet de se plaindre d’elle.
— Pour moi, dit Berelise, je suis déjà amie de Theomene sans l’avoir vu,
— Vous n’avez assurément qu’à le voir pour l’acquérir, reprit Clidamire, car vous n’avez jamais rien voulu gagner qui n’ait été à vous,
— Berelise est si charmante, reprit Themiste, qu’il ne faut pas s’étonner du pouvoir que vous dites qu’elle a,
— Pour moi, dit Herminius, qui ai eu l’avantage de connaître Theomene depuis que la paix est faite, j’ose assurer que la Princesse Lysimene ne l’a point flatté, et qu’il est tel qu’elle l’a dépeint.
— De grâce Madame, dit Berelise, dites-moi encore, quel est ce Lucilius dont on parle tant à Rome depuis quelques jours ?
— Il est tel, reprit la Princesse des Leontins, qu’il n’y a point d’amant si honnête homme qui ne dût craindre de l’avoir pour rival. Mais puisque même vous n’avez pas vu cet illustre frère de Melinthe et de Theomene, il faut que je vous dise qu’il est grand, bien fait et de très bonne mine. Il a l’action assez négligée, l’air fort noble, l’abord sérieux et civil, la physionomie heureuse, sage et agréable, les cheveux châtains, le visage d’une forme assez particulière, et le nez un peu haut. Pour les yeux il ne les a pas grands, mais il les a bleus, doux, et pleins d’esprit. Ils ont même une certaine langueur qui les rend fort propres à ces regards passionnés qui font entendre beaucoup de choses en un moment, et ils ont pourtant en quelques occasions un souris si plein d’enjouement, qu’on connaît bien que le cœur de Lucilius peut être capable d’une joie sensible, aussi bien que d’une violente douleur. Il a le teint beau pour un homme, et une petite marque naturelle au-dessous de l’œil gauche, qui siérait même bien à une belle et qui lui donne de l’agrément. Lucilius est propre, il s’habille d’un air de qualité qui lui sied bien, et si l’on pouvait louer un aussi honnête homme que lui de petites choses peu nécessaires, je dirais qu’il y a même plusieurs belles qui voudraient avoir les mains aussi blanches que lui. Mais à n’en mentir pas, j’ai trop de choses à vous dire de son esprit, de son courage, et de sa vertu, pour m’arrêter à vous parler plus longtemps de sa personne. Sachez donc que Lucilius est né avec un très grand esprit naturel, avec une imagination dont l’étendue ne se peut comprendre, et avec un jugement qui sait si bien régler l’un et l’autre, qu’il ne dit jamais rien en conversation dont il soit obligé de se repentir. Au reste, Lucilius a un de ces esprits qui pourraient s’ils voulaient se passer de rien apprendre, parce que regardant les choses en elles-mêmes, leurs propres réflexions les instruisent mieux qu’ils ne pourraient être instruits par tous les livres du monde. Aussi Lucilius n’a-t-il pas employé un grand nombre d’années à l’étude, et les voyages, la guerre, la cour, et sa propre raison, ont été ses maîtres. Il a pourtant beaucoup lu et il y a peu de belles choses qu’il ne connaisse, mais enfin, il a lu par inclination, et non pas par obéissance comme font pour l’ordinaire tous les jeunes gens qu’on veut bien élever. Cependant, la cour, la guerre, les voyages, et sa propre raison, l’ont si bien instruit, qu’on croit qu’il a tout appris tant il connaît bien toutes choses, et tant il parle raisonnablement de tout ce dont on peut parler. Ce qu’il y a de particulier à Lucilius, c’est qu’il est très vaillant sans avoir pas un des défauts qui sont assez ordinaires aux braves, car il n’a nulle vanité. Il est doux, civil, et modéré, et jamais nul autre que lui n’a tant haï la fausse gloire, ni tant aimé la véritable. Au reste, Lucilius a une égalité admirable, car ses amis le trouvent toujours le même, et quoiqu’il paraisse sérieux et que son tempérament penche un peu à la mélancolie, il aime pourtant tous les plaisirs raisonnables. La joie, et l’enjouement de ses amis lui plaisent et le divertissent, et il y contribue même autant qu’ils veulent, et ne les contrarie jamais. Lucilius a de l’honneur, de la probité, et de la confiance en amour et en amitié. Il a même de la fermeté dans les malheurs, et comme sa fortune n’a pas toujours été heureuse, qu’il s’est trouvé en plusieurs rencontres difficiles, qu’il a été blessé et prisonnier de guerre, qu’il a voyagé et sur la terre et sur la mer, on a vu sa vertu à l’épreuve, et l’on sait qu’il est sorti très glorieusement de toutes les occasions où la fortune l’a porté. Enfin, Lucilius est brave avec les braves, savant avec les savants, galant avec les galants, et également sage avec tous. Au reste, son inclination naturelle l’a toujours porté à la poésie et à l’amour, et ces deux sentiments sont d’autant plus avant dans son cœur, qu’ils y subsistent l’un par l’autre, car si l’amour lui a fait faire des vers dans le commencement de sa vie, je ne tiens pas impossible, s’il vit jusqu’à cet âge où l’amour n’est plus de raison, que l’inclination qu’il a pour les vers ne lui en fasse encore écrire d’amour, parce que la poésie et l’amour ont une telle sympathie, que rarement se peuvent-elles passer l’une de l’autre. Mais de grâce, n’allez pas vous imaginer que Lucilius fasse de ces vers qui se sentent un peu de la condition de ceux qui les font et qu’on pourrait peut-être appeler des vers de qualité, parce que pour l’ordinaire, les gens de cette condition ne sont pas assez éclairés en ces sortes de choses là pour les faire fort bien. Ceux qui s’y entendent mieux que moi assurent que Lucilius fait des vers qui pourraient avoir été faits par Homere ou par Hesiode. En effet, ils ont de l’invention, de la force, du génie, et une harmonie si charmante que tout le monde en est touché. Ses descriptions sont si belles, si poétiques et si naturelles, qu’on voit tout ce qu’il représente. S’il dépeint l’ombre d’une forêt, il séduit l’imagination, s’il représente la mer irritée, des rochers et un naufrage, on a le cœur transi de ce qu’il décrit. S’il bâtit un temple magnifique, on croit que c’est Apollon lui-même qui en a été l’architecte, et s’il représente un amant malheureux on ne peut s’empêcher d’avoir le cœur sensible à ses malheurs, de le plaindre, et de soupirer avec lui. Et comme la tristesse et l’amour ensemble font un merveilleux effet en vers, rarement les sépare-t-il. Ce n’est pas que quand il veut, sa muse ne se joue agréablement. En effet, un homme qui a un des plus agréables esprits de son siècle ayant fait un dialogue fort ingénieux et fort galant à l’exemple d’Anacreon qui en a fait un d’une colombe et d’un passant, où il introduit un petit oiseau qui revient tous les ans dans le jardin d’une de ses amies, cet ouvrage a ensuite fait produire à Lucilius et à Theomene, des vers les plus jolis du monde, et qui par un caractère naturel, enjoué, et plein d’esprit, font voir que rien ne leur est impossible. Pour l’amour, Lucilius en connaît toute la délicatesse, et jamais on n’a vu d’amant dont les sentiments aient été plus tendres que les siens. Il peut aimer avec constance même sans être aimé. L’absence augmente plutôt l’amour que de la diminuer dans son âme, et l’infidélité même a quelque peine à arracher une passion de son cœur. Il aime avec transport et avec respect, il se fait des plaisirs de ses peines dont les autres amants ne s’aviseraient pas, et il a des sentiments si pleins d’amour, que nul autre que lui ne les pourrait avoir. En effet, je lui ai entendu dire qu’un jour étant sur la mer, il s’éleva une tempête effroyable qui pensa faire périr le vaisseau dans lequel il était à la vue d’un château qui est bâti sur un rocher au pied duquel il y avait grande apparence qu’il ferait naufrage, car le vent le poussait de ce côté-là avec impétuosité et le timon était rompu. En cet état, sachant que sa maîtresse était dans ce château, au lieu d’abandonner son âme à la crainte comme les autres, ou de prendre, du moins, garde à ce que les mariniers faisaient pour s’empêcher de périr, il était appuyé au pied du mât et pensait avec plaisir que s’il faisait naufrage en ce lieu-là les vagues pourraient porter son corps au pied de ce rocher où sa maîtresse s’allant promener fort souvent pourrait le voir et l’arroser de ses larmes. Cette pensée l’occupa si fort, qu’il ne vit rien de tout ce que l’on fit pour résister à la tempête. Ainsi, il méprisa le péril et même la mort par un excès d’amour. Mais enfin, c’est assez de vous dire que Lucilius peut être aussi parfait amant que parfait ami, car c’est vous dire en peu de paroles qu’il est parfaitement honnête homme, et qu’il est digne d’être frère de la généreuse Melinthe.
— J’en tombe d’accord, dit Plotine, et si tous les hommes étaient comme lui, je pense qu’il faudrait excuser celles qui souffriraient d’en être aimées. »
Après cela, Lysimene se leva pour s’en retourner au camp, mais devant que de s’en aller, toute la compagnie l’exhorta à continuer de protéger Aronce et Clélie, ce qu’elle promit de faire avec beaucoup de tendresse. Mais devant que de partir elle tira Berelise à part et lui parlant bas : « Je viens de faire si bien connaître Clidamire à Artemidore, lui dit-elle, que vous ne devez plus craindre qu’il soit injuste pour vous. Cependant, je vous conseille de vous hâter de faire votre voyage de Preneste, car il pourra être qu’en ce lieu-là les dieux changeront le cœur de Clidamire, qui seule empêche présentement notre retour à Leonte, quoiqu’elle fasse semblant de négocier pour le Prince mon frère, et pour moi. »
Berelise eût bien voulu savoir un peu plus précisément ce que Lysimene avait dit à Artemidore, mais voyant qu’elle était pressée de partir, elle se contenta de la remercier de l’agréable nouvelle qu’elle lui donnait, ensuite de quoi Lysimene s’en retourna au camp, qui était fort ému de la prison d’Aronce, n’y ayant personne qui pût seulement le soupçonner d’avoir jamais eu la pensée de conjurer contre Porsenna. Mais ce qu’il y avait de fort glorieux pour ce prince, c’est que dès que ce bruit fut répandu dans Rome, tout le peuple se souvenant qu’Aronce avait été cause du gain de la bataille où Brutus était mort, murmura hautement contre Porsenna, et sans considérer que ce prince avait des otages entre ses mains, et sans penser même aux suites de cette affaire, il disait hardiment qu’il fallait rompre la paix, et aller demander Aronce au Roi d’Étrurie. Tous les honnêtes gens du sénat étaient aussi sensiblement touchés du malheur d’Aronce, et jugeant bien qu’ils ne pouvaient rien faire de plus dangereux pour ce prince que de témoigner trop de zèle pour lui, ils retenaient le peuple autant qu’ils pouvaient. Mais comme ils ne pouvaient pas empêcher qu’il ne parlât, qu’il ne plaignît Aronce, et qu’il ne murmurât contre Porsenna, Tullie qui sut tous ces murmures s’en servit pour confirmer tout ce qu’elle avait dit contre Aronce, en apprenant à Porsenna que ce prince avait encore plus d’amis dans Rome que dans son armée. De sorte que Porsenna ayant l’esprit fort irrité contre Aronce, ne pouvait souffrir qu’on lui parlât de lui. Galerite ne laissait pourtant pas de le faire, non plus que la Princesse des Leontins qui malgré la jalousie de Zenocrate, ne laissait pas de faire tout ce qu’elle pouvait pour Aronce, n’y ayant presque qu’elle qui osât parler fortement à Porsenna en faveur de ce prince. « De grâce, Seigneur, lui dit-elle à son retour de Rome, souffrez que je vous dise que vous vous faites un fort grand tort d’accuser Aronce d’un crime dont personne ne le soupçonne, et que vous ne vous en faites pas moins d’ajouter quelque créance à tout ce que vous dit Tullie, que vous savez bien qui n’a ni vertu ni probité, qui est artificieuse et cruelle et qui hait Aronce et Clélie.
— Je sais tout ce que vous me dites, reprit Porsenna, mais tout ce que vous dites ne justifie point Aronce et encore que Tullie soit méchante, cela n’empêche pas qu’Aronce ne soit un fils dénaturé et un parricide, dans le cœur de qui l’amour a étouffé tous les sentiments de la nature et de la vertu, et qui m’ayant regardé comme un obstacle invincible à sa félicité imaginaire, a prétendu être heureux dès que j’aurais perdu la vie.
— Mais, Seigneur, reprit Lysimene, comment concevez-vous qu’Aronce ait pu former ce dessein, et quelles preuves vous en a-t-on données ?
— J’ai su, reprit Porsenna, qu’Aronce, pendant que je le tins en prison à l’île des Saules, a supporté ce traitement-là avec beaucoup d’impatience, quoiqu’il parlât toujours avec respect à ceux que j’envoyais vers lui. J’ai su encore qu’il suborna celui qui le gardait, qu’il fut secrètement à Rome, et qu’il eut quelques conférences particulières dans un jardin avec diverses personnes. J’ai su, de plus, que pendant le siège il n’a jamais perdu nulle occasion de favoriser les Romains dans les choses qui n’étaient pas absolument contre l’ordre de la guerre. J’ai été averti qu’après avoir fait des prisonniers le jour de l’attaque du pont, il les renvoya et qu’il écrivit quelque chose dans ses tablettes qu’il donna à un de ceux qu’il renvoyait, et l’on m’a enfin fait parler à deux de ces trois cents conjurateurs dont Mutius me parla, qui disent que c’est eux qui ont été diverses fois employés pour faire la liaison de Mutius et de lui, et qu’Aronce lui avait promis de l’empêcher de périr. Et en effet, il fallait bien qu’il y eût quelque intelligence secrète que je ne découvre pas encore, car lorsque Mutius eut tué celui qu’il prenait pour moi, personne ne songeait à le prendre et si je n’eusse envoyé mes gardes pour cela Mutius n’eut pas été pris, joint que ce fut effectivement Aronce qui fut en partie cause que je pardonnai à Mutius.
— Mais, Seigneur, reprit Lysimene, si Aronce eût été de cette conjuration, il est à croire qu’il eût mieux instruit Mutius et qu’il n’eût pas pris un autre pour vous,
— Si les dieux favorisaient les crimes, reprit Porsenna, les criminels ne feraient jamais rien imprudemment, mais comme cela n’est pas, ils permettent souvent, pour la punition des coupables, que ceux qui veulent commettre une méchante action s’aveuglent, se trompent, et manquent de jugement. Ainsi Mutius se laissant tromper à la robe de pourpre que portait celui qu’il tua parce qu’on avait oublié à lui dire que la charge de cet homme lui permettait d’en avoir une, on peut dire qu’il se trompa. Heureusement pour moi, et malheureusement pour Aronce.
— Mais, Seigneur, reprit la Princesse des Leontins, je ne vois pas encore son crime bien prouvé, car les deux hommes qui l’accusent peuvent être subornés !
— Plût aux dieux, généreuse princesse, lui dit-il, que ces gens-là fussent de faux témoins, mais à n’en mentir pas toutes les apparences sont contre Aronce. En effet, la fermeté de Mutius à ne nommer point ses complices, marque assez qu’il y en avait quelqu’un que j’eusse pu faire punir, car si tous les conjurés eussent été Romains il n’y avait nulle raison à me cacher leurs noms.
— Mais Seigneur, répliqua Lysimene, l’opinion la plus commune est que Mutius vous dit un mensonge pour vous porter à la paix, et qu’il était seul qui avait eu le dessein de vous tuer.
— Je veux bien croire, répondit Porsenna, qu’ils n’étaient pas trois cents, mais je ne croirai jamais que Mutius fut seul. On joute encore, poursuivit-il, qu’Aronce pour porter Mutius à ce dessein, lui avait promis quand je serais mort, de donner la paix à Rome sans autres conditions que celle de remettre Valerie et Clélie en sa puissance, lui promettant après cela de lui faire épouser la première.
— Mais, Seigneur, répliqua Lysimene, si Aronce avait été assez méchant pour vouloir vous ôter la vie, pourquoi aurait-il eu besoin de Mutius et pourquoi n’aurait-il pas plutôt suborné quelqu’un de vos gardes ?
— Nullement, reprit Porsenna, car de cette façon on serait peut-être venu à le soupçonner, mais de l’autre manière perdant la vie par le bras d’un Romain, cette action paraissait un zèle pour délivrer Rome et ne donnait nul sujet d’accuser Aronce. Cependant, l’amour toute seule a fait leur crime, et pour vous témoigner que la chose est ainsi, ajouta-t-il, je viens d’être averti que Mutius a pris la fuite ! Jugez si je puis, après cela, douter du témoignage de ceux qui accusent Aronce. Mais afin que vous en doutiez moins, voyez une lettre de Clélie à Aronce, qu’on a trouvée dans sa chambre, et qui faut qui lui ait été donnée par un de ses gardes. »
Lysimene la prenant, connut en effet l’écriture de Clélie dont elle avait vu plusieurs lettres, et ouvrant le billet, elle y trouva ces paroles :
CLÉLIE À ARONCE
Tout criminel que vous êtes, je ne laisse pas de vous plaindre, et de vous assurer que malgré votre crime je ferai des vœux encore plus ardents pour votre liberté, que je n’en ferais pour la mienne.
« Ce billet semble sans doute être contre Aronce, reprit Lysimene, mais Seigneur, deux personnes qui s’aiment ont tant de petits différends qui les brouillent ensemble, qu’il ne faut pas conclure que cela veuille dire que Clélie sache qu’Aronce soit criminel envers vous ! Au contraire, il faut penser que si cela était, elle ne lui aurait pas écrit en ces termes-là.
— Vous êtes admirable, Madame, reprit brusquement Porsenna, de vouloir donner du jugement à des personnes préoccupées d’une grande passion. Cependant, tout ce que je puis faire pour Aronce, ajouta-t-il, c’est de différer son supplice, car je vous avoue que je voudrais bien le faire convaincre par Mutius même. Si ce n’était que les otages doivent être inviolables, je traiterais Clélie d’une manière que par elle je viendrais à savoir peut-être bien des choses, quoique je ne croie pas qu’elle ait su tout le secret de cette conjuration. Au contraire, je m’imagine que ce n’a été que depuis cela qu’Aronce ne voulant peut-être pas perdre auprès d’elle le mérite de son crime, lui en aura dit quelque chose. Cependant, j’ai deux hommes qui lui soutiendront qu’il est coupable. Mais comme je vous l’ai déjà dit, je veux faire chercher Mutius et obliger Publicola qui ne l’aime pas, à le forcer de dire la vérité. Après cela, je donnerai un aussi grand exemple de justice que Brutus en donna lorsqu’il vit mourir ses enfants, car je ne veux pas être surpassé par un Romain.
— Ha ! Seigneur, reprit Lysimene, vous me faites pâlir de crainte de vous entendre parler comme vous parlez. De grâce, examinez bien les choses, souvenez-vous que les apparences sont trompeuses, et croyez plutôt tout ce que vous disent les grandes actions que ce que vous dit la cruelle Tullie qui n’est accoutumée qu’à des artifices et qu’à des méchancetés. En effet Seigneur, ajouta-t-elle, pensez-vous que cette princesse prenne un grand intérêt à votre vie, après que vous avez donné la paix à Rome ? Et ne devez-vous pas plutôt craindre qu’elle ne veuille vous engager dans un crime ?
— Quoi qu’il en soit, répondit Porsenna, ce qu’elle me dit me paraît vrai. Toutes les conjectures sont contre Aronce qui ne peut être heureux tant que je vivrai, et je ne me rendrai ni à vos prières, ni à vos larmes, ni aux murmures de tous mes sujets, ni aux plaintes des Romains, qui me prouvent encore l’intelligence d’Aronce avec Rome, ni même aux secrets sentiments de la nature que je sens malgré moi dans mon cœur.
— Mais, Seigneur, reprit Lysimene, d’où vient que ces deux hommes qui accusent Aronce vous avertissent d’un mal passé, d’une entreprise qui a failli, et qu’ils s’accusent eux-mêmes ?
— Ces gens-là, répliqua-t-il, ne pouvaient pas m’approcher devant que la chose fût exécutée. Depuis, ils en ont averti le Prince de Messene pour m’en avertir, mais il n’en fit pourtant rien parce que sans doute il ne voulait pas nuire à Aronce. Mais comme ils ont bien jugé que je ne savais rien de la vérité, ils se sont adressés à Tullie à qui j’ai accordé leur grâce, à condition qu’ils me diraient tout ce qu’ils savaient de cette conjuration.
— Mais où sont ces gens-là, Seigneur ? reprit Lysimene,
— Ils sont en lieu sûr, répliqua Porsenna, jusqu’à ce que je veuille faire condamner Aronce publiquement. Vous savez, ajouta-t-il, que j’avais eu dessein de vous le faire épouser, mais, Madame, vous avez trop de vertu pour vous donner un parricide pour mari, et les dieux vous réservent sans doute une meilleure fortune. Cependant, ne me parlez plus de lui et empêchez Galerite de m’en parler, car plus on m’en parlerait plus je hâterais son supplice. »
Après cela Lysimene fut contrainte de se taire, de se retirer, et d’aller augmenter la douleur de la reine en lui apprenant de quelle manière Porsenna lui avait parlé. Comme tout le monde remarqua que Lysimene paraissait fort triste en sortant de chez le Roi d’Étrurie, toute la cour craignit pour Aronce, et le bruit s’en répandant partout, la rumeur augmenta dans le camp. Cependant, Tullie étant alors devenue nécessaire à Porsenna, non seulement parce que c’était par elle qu’il pouvait convaincre Aronce contre qui il était fort irrité, mais encore parce que sa propre armée étant mutinée contre lui, aussi bien que Rome, il craignait d’avoir affaire des troupes de Tarquin, Sextus allait et venait continuellement au quartier de Porsenna. Il importunait même étrangement Clélie qui était alors dans une douleur incroyable de voir augmenter dans son cœur la passion qu’il avait pour elle. Ce n’est pas qu’elle n’évitât sa vue autant qu’elle pouvait, mais en l’état où étaient les choses, elle ne savait où trouver nulle protection. Car dans les sentiments où elle était pour la Princesse des Leontins, elle avait même peine à lui parler. Mais la plus grande de ses douleurs était d’apprendre les sentiments de Porsenna pour le Prince son fils, le commerce de Tullie avec ce roi, et le soin qu’on avait de garder exactement Aronce. En effet, ce malheureux prince tout aimé qu’il était, ne pouvait trouver les voies de donner de ses nouvelles à Clélie pour répondre à la lettre qu’il en avait reçue, car Telane étant devenu suspect, n’osait seulement approcher de pas un de ses gardes. Clélie avait même le chagrin de voir moins de ses amis de Rome qu’à l’ordinaire, car les consuls en cette conjecture où le tumulte était et dans la ville, et dans le camp, firent en sorte qu’Horace, Herminius, Émile, Spurius, Octave, et tous les autres Romains, ne furent plus visiter ces vingt belles Romaines qu’on avait données en otage. Ils eurent pourtant bien de la peine à s’y résoudre, mais leur ayant fait considérer que si les choses se brouillaient, et qu’on les fit arrêter, Clélie, Valerie, et toutes les autres, seraient en pire état que s’ils étaient à Rome, ils firent par un sentiment d’amour, ce qu’ils n’eussent pu se résoudre de faire par politique. Ainsi, ils furent contraints de se contenter d’envoyer savoir des nouvelles des personnes du monde qui leur étaient les plus chères. Themiste, quoique pressé de s’en aller avec Merigene, voulut pourtant attendre encore quelques jours. Mais pour Amilcar, comme il avait des privilèges particuliers, il allait et venait continuellement du camp à Rome, et de Rome au camp. Artemidore étant beaucoup mieux commença de sortir et de faire sa première visite à Berelise qui devait partir le lendemain pour aller à Preneste, conduite par Anacreon qui ne les voulut pas quitter. Comme ce prince était très civil, il demanda permission à Berelise de voir Clidamire à sa chambre, « Aussi bien, ajouta-t-il, ai-je quelque chose à lui dire qu’il est à propos qu’elle sache,
— Ha ! Seigneur, reprit Berelise, ne quitterez-vous jamais cette exacte civilité pour une personne qui a le cœur si infidèle ? Et pouvez-vous l’estimer encore assez pour me vouloir cacher sa dernière faiblesse ? »
Artemidore rougit alors, car il ne pensait pas que la Princesse des Leontins eût rien dit à Berelise de ce qu’elle lui avait appris. « Non, non, Seigneur, lui dit-elle, votre silence n’a rien d’obligeant, et quand on n’aime plus du tout une infidèle, on aime à publier son infidélité. Mais c’est assurément que ne pouvant tout à fait cesser d’aimer Clidamire, vous auriez honte de m’apprendre qu’elle ne peut jamais cesser de vous tromper pour me pouvoir tromper.
— Pour me pouvoir tromper Madame, reprit Artemidore, il faudrait que je me fusse fié à ses paroles,
— Pourquoi ne m’apprenez-vous donc pas, répliqua Berelise, qu’elle a une nouvelle galanterie avec Meleonte ?
— C’est parce qu’étant votre belle-sœur, répliqua-t-il, je vous respecte en sa personne, joint que comme je vous l’ai dit cent fois, je crois qu’un honnête homme se fait toujours honneur de ne publier pas les faiblesses d’une personne qu’il a aimée et qui veut encore lui persuader qu’elle ne le hait pas. Mais dans le fond de mon cœur, je vous proteste que je la méprise autant que je vous estime, que je vois tous ses charmes sans en avoir le cœur touché, que je regarde les témoignages de son affection comme des marques de sa faiblesse ou de sa dissimulation, et que je ne vous ai jamais tant aimée que je vous aime. Après cela Madame, allez hardiment à Preneste, car comme les dieux ne sont pas menteurs vous n’y pouvez rien apprendre qui ne soit à votre avantage.
— Si vous voulez que je vous croie, répliqua Berelise, dites-moi donc tout ce que vous savez de Clidamire,
— Je sais, Madame, reprit-il, qu’elle a une liaison assez étroite avec Meleonte, et que par conséquent ni la Princesse ma sœur, ni moi, ne pouvons être rappelés de notre exil. Il est vrai que comme Clidamire est artificieuse, elle veut me persuader qu’elle trompe Meleonte et qu’elle n’entretient commerce avec lui que pour nous rendre service, cependant je sais ce que j’en dois croire. La prudence veut pourtant que nous dissimulions aussi bien qu’elle, car enfin, elle a beaucoup de crédit sur l’esprit de Meleonte, Meleonte est maître de celui du prince et Meleonte comme vous le savez hait Lysimene, parce qu’il l’a trop aimée.
— Croyez-moi, répliqua Berelise, on ne peut satisfaire à tant de devoirs à la fois et l’excessive prudence ne compatit pas toujours avec une excessive amour. Être bon citoyen, grand observateur des lois, ne manquer jamais à rien de ce qu’on doit à ses parents, à ses amis, à ceux que la fortune a mis au-dessus de soi-même à la seule bienséance, c’est avoir trop de choses à faire, et quand cela est ainsi, on manque souvent à sa maîtresse. Cependant, selon les lois de l’amour, il faut pouvoir manquer plutôt à tout qu’à elle.
— Mais ne considérez-vous pas, reprit Artemidore, que votre intérêt est joint au mien en cette rencontre ?
— Je sais tout ce que vous dites, reprit Berelise, mais je vous avoue que je sais pour le moins aussi bien, que quand on ne hait point ce que l’on a aimé on l’aime encore.
— Au contraire, répliqua ce prince, la haine n’est bien souvent qu’une amitié déguisée, et l’indifférence est une véritable preuve d’une amour éteinte.
— J’avoue, répliqua Berelise, qu’une indifférence toute pure est une marque qu’il n’y a plus d’amour mais lorsque cette indifférence est accompagnée d’une exacte civilité, croyez, Seigneur, croyez que si celui qui en est capable n’aime plus, il peut du moins encore aimer. Mais enfin, sans vouloir vous montrer davantage la faiblesse que j’ai de ne pouvoir vous cacher le dépit que vous me faites, j’irai à Preneste afin de savoir ce que l’on me dira de vos sentiments que vous ne connaissez pas assez bien vous-même pour m’en instruire,
— Ha ! cruelle personne que vous êtes, reprit-il, pourquoi me parlez-vous comme vous faites ? Pensez-vous que j’aie oublié tout ce que je vous ai promis ? Pensez-vous que je puisse comparer Clidamire à Berelise ? Et croyez-vous que je n’aie pas remarqué la différence qu’il y a eu entre ses sentiments et les vôtres durant mon mal ?
— Clidamire sait si bien feindre, reprit Berelise, que peut-être croyez-vous qu’elle était aussi triste que moi de voir votre vie en danger,
— Non, non, reprit Artemidore, Clidamire ne m’a point trompé, je lui ai vu une négligence affectée pour paraître plus triste qui ne m’a point persuadé, je lui ai vu composer ses yeux, appeler des larmes et faire des soupirs qui venaient plus de sa volonté que de son cœur, enfin je l’ai toujours vue propre dans sa négligence, et dans le plus fort de mon mal je ne lui ai pas vu abandonner un moment le soin de sa beauté, lors même qu’elle croyait que je devais abandonner la vie.
— Ha ! Seigneur, interrompit Berelise, vous n’auriez rien vu, ni rien remarqué, de tout ce que vous venez de dire, si Clidamire vous eut été indifférente.
— Vous êtes bien injuste, reprit Artemidore, d’empoisonner tout ce que je vous dis pour vous guérir. Car enfin, dans le même temps que j’ai remarqué tout ce que je viens de dire, j’ai vu une véritable douleur peinte sur votre visage, j’ai vu de véritables larmes tomber de vos beaux yeux, je vous ai entendu soupirer avec tendresse, je vous ai vu assez négligée pour me persuader qu’il ne vous souvenait pas alors que vous étiez belle, et si je l’ose dire je vous ai vu le cœur assez touché, pour me donner lieu de croire que ma mort aurait peut-être causé la vôtre. Après cela Madame, me querellerez-vous encore, et ne me permettrez-vous pas pour votre intérêt de dissimuler un peu avec Clidamire ?
— Je ne sais ce que je dois vous répondre, reprit-elle, mais je sais bien que je ne puis souffrir que Clidamire espère d’être aimée de vous, et que ce n’est que pour lui ôter cette espérance que je vais à Preneste. Car enfin, lorsque j’y pense bien, je ne puis croire qu’entre une infidèle et Berelise, vous puissiez mal choisir. »
Après cela, Artemidore dit tant de choses obligeantes à Berelise, qu’elle consentit qu’il allât dire adieu à Clidamire, à condition qu’elle irait dans sa chambre un moment après lui. Et en effet, ce prince n’y fut pas plutôt entré, que Berelise y fut conduite par Amilcar qui venait dire adieu à ces deux belles personnes qui devaient partir le lendemain. Anacreon et Cefonie entrèrent un moment auprès, de sorte que Berelise eut la satisfaction de voir que Clidamire ne pourrait dire adieu en particulier à Artemidore. Si bien qu’en ayant l’esprit plus gai, sa conversation en fut plus agréable. Ce qui donna sujet de la rendre telle, c’est que Clidamire ayant fait un songe qui l’inquiétait et ayant la faiblesse de croire que les songes étaient toujours de bon ou de mauvais présage, se plaignit à Cefonie. « Si vous saviez quel est le songe que j’ai fait, vous ne vous en étonneriez pas,
— Quoi ? s’écria Amilcar, Clidamire peut avoir une mauvaise nuit pour un mauvais songe ?
— Quoi ? reprit-elle assez étonnée, Amilcar qui a tant d’esprit et qui est si savant, ne sait point qu’il y a des songes qui sont des prédictions très affinées ?
— Je sais sur les songes, reprit-il, tout ce qu’on en peut savoir, et si je vous en faisais l’histoire, vous verriez bien que je n’y suis pas ignorant. En effet, je sais qu’Homere dit que les songes et particulièrement ceux des rois et des grands personnages sont envoyés du ciel, que beaucoup d’excellents philosophes ont cru que les dieux les distribuaient aux hommes, et que Pythagore qui en faisait un grand mystère avait appris l’art de les interpréter, principalement parmi les Égyptiens, et les Chaldéens. Je sais qu’il y a des temples bâtis exprès pour recevoir les inspirations des songes, qu’en Égypte on va dormir dans le temple de Serapis afin d’avoir des songes prophétiques et que l’on y garde soigneusement le souvenir de tous les songes que le cas fortuit a rendus véritables. Je sais même le songe que fit Mandane qui présagea la puissance de Cyrus, mais comme je suis un Africain qui ne suis pas obligé de croire ce que l’on croit en Égypte et en Perse, non plus que ce qu’a cru Pythagore, je vous déclare que je me moque de tous les songes du monde.
— Ha ! pour moi, dit Anacreon, feignant d’être du sentiment de Clidamire, je vous assure que je ne suis pas de votre opinion, car en mon particulier j’ai fait cette nuit un songe dont la suite me donnera peut-être bien de la peine.
— Eh de grâce ! reprit Clidamire, dites-moi ce que vous avez songé ?
— Il m’a semblé, reprit-il avec un visage sérieux, qu’environ minuit, l’Amour qui ne dort jamais est venu frapper à la porte de ma chambre. J’ai demandé qui frappait et il m’a répondu qu’il était un pauvre enfant tout mouillé, qui me demandait le couvert. Comme je lui trouvais la voix fort douce, il m’a fait pitié, je lui ai donc ouvert ma porte, et à la lumière d’une lampe qui était encore allumée, j’ai vu que cet aimable enfant avait deux ailes, une trousse sur l’épaule et un arc à la main. Alors je lui ai essuyé ses cheveux, je l’ai fait approcher du feu et je l’ai séché avec beaucoup de bonté. Après quoi, ce petit mutin a pris son arc disant qu’il voulait voir si la pluie ne l’avait point gâté. Mais hélas ! il ne l’a pas plutôt pris qu’il l’a courbé, et m’a tiré droit une flèche au cœur. Ensuite il s’est moqué de moi, et s’est enfui après m’avoir dit que son arc était comme il fallait. Cependant, j’ai eu tant de dépit d’avoir été trompé que me souvenant confusément que l’on crie “au voleur !” quand on a été volé, je me suis mis à crier si haut “à l’Amour ! à l’Amour !” que je m’en suis éveillé. Mais le mal est, ajouta Anacreon, qu’à la première visite que j’ai faite aujourd’hui ce songe est devenu une histoire par les attraits d’une personne infiniment aimable,
— Ce songe-là est si joli, reprit Berelise en souriant, que je vous condamne à en faire une ode,
— Si elle était faite il y a déjà longtemps, reprit Amilcar, Clidamire serait bien attrapée, car elle a écouté ce songe avec autant d’attention que si Anacreon l’avait fait. Cependant, je suis assuré qu’il n’a dit tout ce qu’il vient de dire que pour faire entendre à Clidamire qu’elle lui plaît aujourd’hui plus qu’à l’ordinaire,
— Puisque vous avez si bien expliqué mes véritables sentiments, reprit Anacreon, je veux bien avouer tout ce que vous avez dit,
— Quoi ? s’écria Clidamire toute mutinée, vous n’avez pas songé tout ce que vous venez de dire et vous croyez aussi bien qu’Amilcar qu’il ne faut pas prendre garde aux songes ?
— Je le crois sans doute, Madame, dit Anacreon.
— Pour moi, dit Artemidore, qui ne songe presque jamais, je n’ai jamais guère pensé à raisonner sur les songes,
— En mon particulier, dit Berelise, je les ai toujours trouvés si frivoles, si menteurs, si bizarres, et si chimériques, que je me rangerai aisément du parti d’Amilcar.
— Pour ce qui me regarde, dit Cefonie, j’avoue qu’il m’est arrivé de songer des choses qui me sont arrivées si justes, que je ne sais ce que je dois penser.
— Puisque le hasard, reprit Amilcar, fait quelquefois voir des figures fort régulières dans les nues, il ne faut pas s’étonner si le cas fortuit fait arriver des choses qu’on a songées. J’ai même entendu dire à une femme de Toscane, que la plus ancienne manière de divination a été par les songes. Elle m’a aussi assuré que ceux que l’on fait aussitôt après le repas, ou au second sommeil, ne signifient rien, et que ceux que l’on fait au lever de l’aurore, sont les plus certains, que les songes du printemps sont plus véritables que ceux de l’automne, et qu’il est même plus ordinaire de songer en la saison nouvelle, qu’en toutes les autres.
— Croyez-moi aimable Cefonie, dit Artemidore, les songes ne sont qu’une simple représentation des images. Ils sont gais ou tristes selon le tempérament, lorsqu’ils sont purement naturels. Ceux qui sont mêlés ont des causes étrangères qui servent de matière à l’imagination et c’est ce qui fait que l’on songe souvent des choses qu’on a vues, ou des choses où l’on a pensé, et plus encore des choses que l’on désire. En effet, c’est assurément cette dernière manière de songer qui a tant donné de crédit aux songes lorsqu’il est arrivé qu’on a vu le jour des gens qu’on avait songés la nuit. Car bien souvent sans que nous le sentions, notre cœur désire ou craint plusieurs choses, si bien qu’en dormant notre imagination qui s’émeut par nos désirs et nos craintes, sans notre consentement, nous fait plutôt songer à ce que nous craignons, et à ce que nous désirons, qu’à toute autre chose. Il ne faut donc pas s’étonner s’il arrive quelquefois par hasard que nous voyons ceux que nous avons songés, parce que nous songeons ordinairement des gens que nous pouvons rencontrer puisqu’il est certain que l’on ne désire que ce que l’on peut espérer, et que l’on n’appréhende que ce qui peut arriver.
— Je tombe d’accord, dit Amilcar, que les songes peuvent marquer nos inclinations, mais je nie qu’ils puissent prédire nos aventures, si ce n’est qu’elles soient une suite de notre tempérament. En effet, on dit que les gens cruels sont sujets à faire des songes effroyables, aussi bien que les mélancoliques. De sorte que quand il arrivera que ces gens-là auront des songes et des aventures qui auront du rapport, il ne s’en faudra point étonner, puisqu’ils auront une même cause. Je sais bien que les savants en songes, disent qu’il y en a de trois espèces qu’ils distinguent, et qu’ils divisent aussi exactement que s’ils avaient voyagé au pays des songes, comme on voyage en Asie. Mais à n’en mentir pas, ils se trompent, car si les dieux voulaient avertir les hommes de ce qu’il leur doit arriver, ils le feraient plus clairement. Et puis, ajouta-t-il, quand je vois qu’un chien de chasse endormi songe à un cerf comme je songe à ma maîtresse, et peut-être encore mieux, je conclus que mes songes viennent de mon tempérament tout seul, je m’en mets l’esprit en repos, et j’agis tout comme si je n’avais point songé.
— En effet, ajouta Berelise, je ne sache rien de plus plaisant à s’imaginer, que de penser que les dieux attendraient que nous fussions endormis à nous avertir si douteusement de ce qui nous devrait arriver, eux, dis-je, qui sont les maîtres du monde et des évènements qui peuvent changer notre volonté comme il leur plaît et qui nous inspirent tout ce que bon leur semble.
— Mais encore, dit Anacreon, quel est le songe qu’a fait la belle Clidamire ?
— Il est tel, répliqua-t-elle en rougissant, que je ne le puis dire qu’à Artemidore. »
Ce prince se trouva alors assez embarrassé, car il jugea bien que c’était un artifice de Clidamire pour lui parler bas devant qu’il partît. Mais quoiqu’il craignît fort de fâcher Berelise, il ne put se résoudre de répondre incivilement à Clidamire devant des personnes étrangères. Si bien que prenant la parole, « Je suis si peu savant à interpréter les songes, lui dit-il froidement, que je ne vois pas pourquoi vous me choisissez plutôt qu’un autre !
— Quoi qu’il en soit Seigneur, reprit-elle, il faut que je vous le dise. »
Et en effet, s’étant approchée de lui et lui parlant bas, « Ne craignez pas, lui dit-elle, que j’aille vous entretenir de mes songes, et s’il vous reste quelque équité, pensez bien je vous en conjure durant que Berelise et moi irons à Preneste, que votre cœur a été à moi, devant que le sien fût à vous, et que je ne dois pas être assez généreuse pour vous faire retourner à Leonte, avec la certitude de n’être jamais aimée de vous.
— C’est trop, Madame, c’est trop, reprit-il sans s’en pouvoir empêcher, de vouloir tout à la fois être aimée de Meleonte et d’Artemidore.
— Quoi ? Seigneur, reprit-elle, vous ne concevez pas que je n’ai voulu donner de l’amour à Meleonte qui est favori du prince, que pour être en état de faire votre paix quand je voudrais ?
— Je conçois fort bien, lui dit-il, que Clidamire veut toujours tout gagner et ne rien perdre !
— Mais à ce que je vois, Seigneur, dit alors Berelise en rougissant, vous avez songé aussi bien que Clidamire, car vous lui parlez pour le moins autant qu’elle vous parle,
— Vous avez fort bien deviné, répliqua Clidamire qui était fort aise de donner de la jalousie à Berelise, mais le songe d’Artemidore n’est assurément pas si véritable que le mien,
— Peut-être que s’il expliquait le vôtre, répliqua-t-elle brusquement, on ne tomberait pas d’accord qu’il fût plus vrai que le sien.
— Croyez-moi, dit Amilcar à Clidamire, attendez que vous soyez à Preneste à demander l’explication de vos songes, car vous trouverez là un parent du sacrificateur du temple de la fortune qui a tant d’esprit, que ce qu’il ne saura pas, personne ne le saura.
— Mais comme vous ne croyez pas, reprit Clidamire, qu’on doive prendre garde aux songes qu’on fait, vous ne croyez pas non plus qu’on puisse m’en donner l’explication.
— Je l’avoue, répliqua Amilcar, mais je suis fortement persuadé que celui dont je parle vous persuadera qu’il n’y a que les médecins qui puissent faire un bon usage des songes de leurs malades, d’où ils jugent quelquefois avec assez de certitude, qu’elle est l’humeur qui domine en eux.
— De grâce, dit Berelise, qui ne cherchait qu’à interrompre la conversation d’Artemidore avec sa rivale, faites faire connaissance à Clidamire et à moi avec celui dont vous venez de parler,
— Je le veux bien, répondit Amilcar, mais avant que de lui écrire, car j’ai fait amitié avec lui pendant mes voyages, j’ai envie de vous dire comme il est fait, afin que s’il ne vous plaisait pas, je ne perdisse pas un billet.
— Vous êtes bon ménager de vos paroles, reprit Berelise, mais je ne laisse pas de consentir à ce que vous voulez.
— J’y consens aussi, répliqua Artemidore,
— Et pour moi je vous en prie, ajouta Cefonie, car j’ai ouï-dire beaucoup de bien de lui, à une de mes parentes qui a été à Preneste.
— Pour ce qui me regarde, dit Anacreon, je serai fort aise de savoir comment est fait un honnête homme que je dois voir,
— Il n’y a donc plus que Clidamire à me prier, reprit Amilcar,
— Je ne m’oppose point au sentiment de la compagnie, dit-elle, c’est assez.
— Sachez donc, dit alors Amilcar, que Telante est de taille médiocre. Il a les cheveux noirs, le teint pâle, les yeux fort grands, la bouche bien faite, la physionomie ingénue, l’air doux et négligé. Il aime naturellement le monde et les plaisirs, mais comme il a un esprit fort prévoyant, il s’est mis par prudence au-dessus de beaucoup de choses qui l’eussent pu rendre malheureux. Il a l’esprit un peu lent mais il parle pourtant fort agréablement quoiqu’il n’ait pas l’imagination fort brillante. S’il suivait son inclination, il trouverait à dire à toutes choses mais il sait se contraindre moitié par sagesse, moitié par politique. La plupart du temps, il ne dit pas ce qu’il pense de ce qu’il voit, mais quand il le veut dire il le dit fort bien. Il est pourtant capable de préoccupation, et sans croire être préoccupé, il fait souvent injustice lors même qu’il croit être le plus équitable, mais ce défaut-là ne lui est pas particulier, et la plupart des hommes en usent ainsi. Il est vrai que je lui ai vu avoir une préoccupation étrange en une certaine occasion, parce qu’il n’aimait pas un vieux sacrificateur du temple de la fortune, il ne trouvait pas qu’il parlât bien lorsqu’il parlait en public. Cependant, il est certain que ce vénérable vieillard charme tous ceux qui l’entendent. Il parle avec force et élégance, son discours n’a rien de rude ni d’affecté, il sait joindre les grâces de l’éloquence à la solidité de la morale, et s’il n’est pas toujours assuré de persuader tous ceux qui l’entendent, il l’est toujours d’être écouté avec plaisir de ceux mêmes qui sont incapables de profiter de ses enseignements. Cependant Telante, par préoccupation, ne trouve pas qu’il soit éloquent.
— Croyez-moi, reprit Berelise, il n’est pas seul préoccupé, et il est plus difficile qu’on ne croit de ne l’être point du tout,
— Quand on ne l’est qu’un peu, reprit Amilcar, ce n’est pas un grand défaut, mais quand on l’est jusqu’à trouver mal ce qui est bien, et laid ce qui est beau, c’est une grande imperfection dans un esprit élevé, car il y a bien de la distinction à faire entre une erreur d’ignorance et une erreur de préoccupation. Mais enfin pour retourner à Telante, je crois qu’il avait dans le cœur de quoi être fort amoureux et fort ambitieux, et je suis persuadé qu’il a donné plusieurs combats pour vaincre ces deux sentiments là.
— Il a sans doute bien fait, reprit Berelise, car ces deux sentiments-là ne donnent bien souvent que de l’inquiétude.
— Ils en donnent assurément, reprit Amilcar, mais ils donnent aussi mille plaisirs.
— Croyez-moi, dit Clidamire, on ne connaît pas tous les ambitieux non plus que les préoccupés, et l’on voit quelquefois des gens qui font semblant de ne l’être point, qui affectent le mépris de l’ambition, pour satisfaire plutôt celle qu’ils ont dans le cœur,
— Quoi qu’il en soit, dit Amilcar, je pense qu’on ne se trompe guère lorsqu’on croit qu’on peut toujours être trompé, et que le plus sûr est de ne juger de rien affirmativement sur des apparences. Mais enfin pour en revenir à Telante, il a de la complaisance et de la civilité, il aime la société et particulièrement celle des dames, et je vous puis assurer que s’il veut il vous écrira des billets doux, tout sacrificateur qu’il est, car je crois que cela ne s’oublie point quand on l’a su. J’ai encore à vous dire que Telante croit aussi bien que moi qu’il y a assez de peine à trouver une grande satisfaction sans le secours de la fortune. Voilà charmante Berelise, quel est l’illustre Telante, c’est après cela à vous à me dire si vous voulez que je lui écrive.
— Vous me ferez un fort grand plaisir, lui dit-elle.
— Pour moi, dit Clidamire, je serai fort aise de le voir, mais de l’air dont vous en parlez, je vois bien que je ne lui parlerai pas de mes songes. »
Après cela Artemidore s’en alla, mais quoique Berelise connût bien qu’il n’avait pas voulu donner une nouvelle occasion à Clidamire de l’entretenir, elle ne fut pas tout à fait contente de lui, parce qu’elle voulait qu’il trouvât lieu de lui rendre compte de ce que Clidamire lui avait dit lorsqu’elle lui avait parlé bas. De sorte qu’elle lui parut un peu froide lorsqu’il sortit, mais encore qu’il ne sentît rien dans son cœur qu’elle pût lui reprocher, il ne laissa pas d’en avoir de l’inquiétude, aussi lui écrivit-il le lendemain au matin. Mais celui qui portait son billet s’étant arrêté en chemin, Berelise était partie pour aller à Preneste avec Clidamire et Anacreon, Artemidore n’étant pas encore en état de faire ce petit voyage. Il est vrai que pour réparer la faute de celui qu’il avait envoyé, il fit partir à l’heure même un esclave fort adroit, qu’il envoya à Preneste porter à Berelise son premier billet, accompagné d’un autre. Cependant, Amilcar continuait de chercher les voies de servir Aronce, aussi bien qu’Herminius, et tous les honnêtes gens de Rome, à la réserve d’Horace, qui quelque généreux qu’il fût ne pouvait pas s’affliger du malheur de son rival. Pour Zenocrate, sa secrète jalousie faisait qu’il évitait autant qu’il pouvait de parler d’Aronce, de peur qu’on ne remarquât qu’il était moins son ami qu’autrefois. Mais quoiqu’Amilcar ne pût tout à fait renoncer à son enjouement, il y avait des heures où s’il n’était triste, il était, du moins, rêveur. Car outre la passion d’Aronce et la peine où était Plotine ayant reçu un ordre par cet Africain qui était venu, de s’en retourner à Carthage, il avait l’esprit fort embarrassé. Il aimait Plotine autant qu’il pouvait aimer, il avait des amis à Rome qui lui étaient fort chers, et il avait un ami particulier en son pays qui avait alors un fort grand besoin de lui. Ainsi, le devoir pour son maître, l’amitié qu’il avait pour son ami, l’intérêt d’Aronce, et l’amour qu’il avait pour Plotine, partageaient alors assez son cœur pour faire que ceux qui le connaissaient bien remarquassent quelque petit changement en son humeur. Aussi Plotine s’en aperçut-elle bientôt. D’abord elle crut que la douleur qu’il avait du danger où était Aronce était la seule chose qui faisait son inquiétude, et qu’aimant fort Clélie, il s’intéressait sensiblement à sa douleur, comme en effet Amilcar était fort touché des malheurs d’Aronce et de ceux de Clélie. Mais comme l’amour fait faire un discernement fort juste des sentiments de la personne qu’on aime, Plotine connut à la fin qu’Amilcar avait lui-même quelque sujet d’inquiétude. De sorte qu’en étant en peine, « D’où vient Amilcar, lui dit-elle, que je vois sur votre visage, je ne sais quoi qui me dit que vous avez de la tristesse ?
— Hélas, aimable Plotine, lui dit-il, je vois bien que je ne vous puis rien cacher, car j’avais eu dessein de vous dissimuler un chagrin que j’ai dans le cœur. Cependant, puisque vous l’avez découvert, il faut que je vous apprenne que l’amour ne me tourmente pas seulement en Italie, il me persécute encore en Afrique, en la personne d’un illustre ami qu’il a rendu malheureux. J’ai sans doute su tous les commencements de son amour, et j’y ai eu même assez de part, mais depuis que je suis parti d’Afrique, il lui est arrivé des choses qui me font pitié et qui m’affligent d’autant plus, que je crois que ma présence est tout à fait nécessaire pour adoucir la fortune de mon ami. Cependant, l’amour que j’ai pour vous est si forte, que je ne sais si le commandement d’un maître et les malheurs d’un ami suffiront à m’obliger à faire un voyage en Afrique. Je dis un voyage, Madame, ajouta-t-il, puisque présentement Rome est mon pays, car enfin un amant n’a point d’autre patrie que celle de sa maîtresse.
— Ce que vous dites est fort obligeant, reprit Plotine, mais comme je suis équitable et généreuse je ne veux pas vous faire manquer ni à votre prince, ni à votre ami. Mais tout ce que je vous demande est de ne partir point que nous ne soyons toutes retournées à Rome et qu’Aronce ne soit justifié. Nous espérons que cela pourra être bientôt, car la Reine d’Étrurie, la Princesse des Leontins, la généreuse Melinthe, et la charmante Hersilie, ont mandé ce matin à ma sœur et à moi, qu’elles allaient faire aujourd’hui un dernier effort auprès de Porsenna.
— Je vous promets plus que vous ne voulez, Madame, lui dit-il, car je m’engage à ne partir point du tout si vous ne me le commandez. »
Comme il parlait ainsi, Valerie entra qui leur dit que Lucilius venait encore de leur mander que tous les amis d’Aronce allaient parler si fortement à Porsenna, qu’ils en attendaient un heureux succès. Si bien que cette nouvelle mettant quelque calme dans l’esprit de ces deux aimables filles, Plotine, après avoir dit à Valerie ce qu’Amilcar lui avait dit, le pria de vouloir leur dire quel était le malheur de celui dont il venait de lui parler. « Comme les malheurs d’autrui soulagent quelquefois un peu les nôtres, je veux bien, ajouta-t-il, contenter votre curiosité, et vous tomberez sans doute d’accord que mon ami est à plaindre, que l’amour est le même en tous lieux, et qu’il n’y a point de malheur si grand, qui ne puisse trouver son semblable. »
Après cela, Valerie et Plotine sachant que Clélie était avec Hermilie, donnèrent ordre qu’on ne les pût interrompre, ensuite de quoi, Amilcar commença de parler en ces termes :
Informations complémentaires
| Poids | 310 g |
|---|---|
| Dimensions | 13 × 138 × 204 mm |
| Disponible | Oui |
| Genre | Récit historique, Roman |
| Version papier ou numérique ? | Version numérique (Epub), Version papier |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.

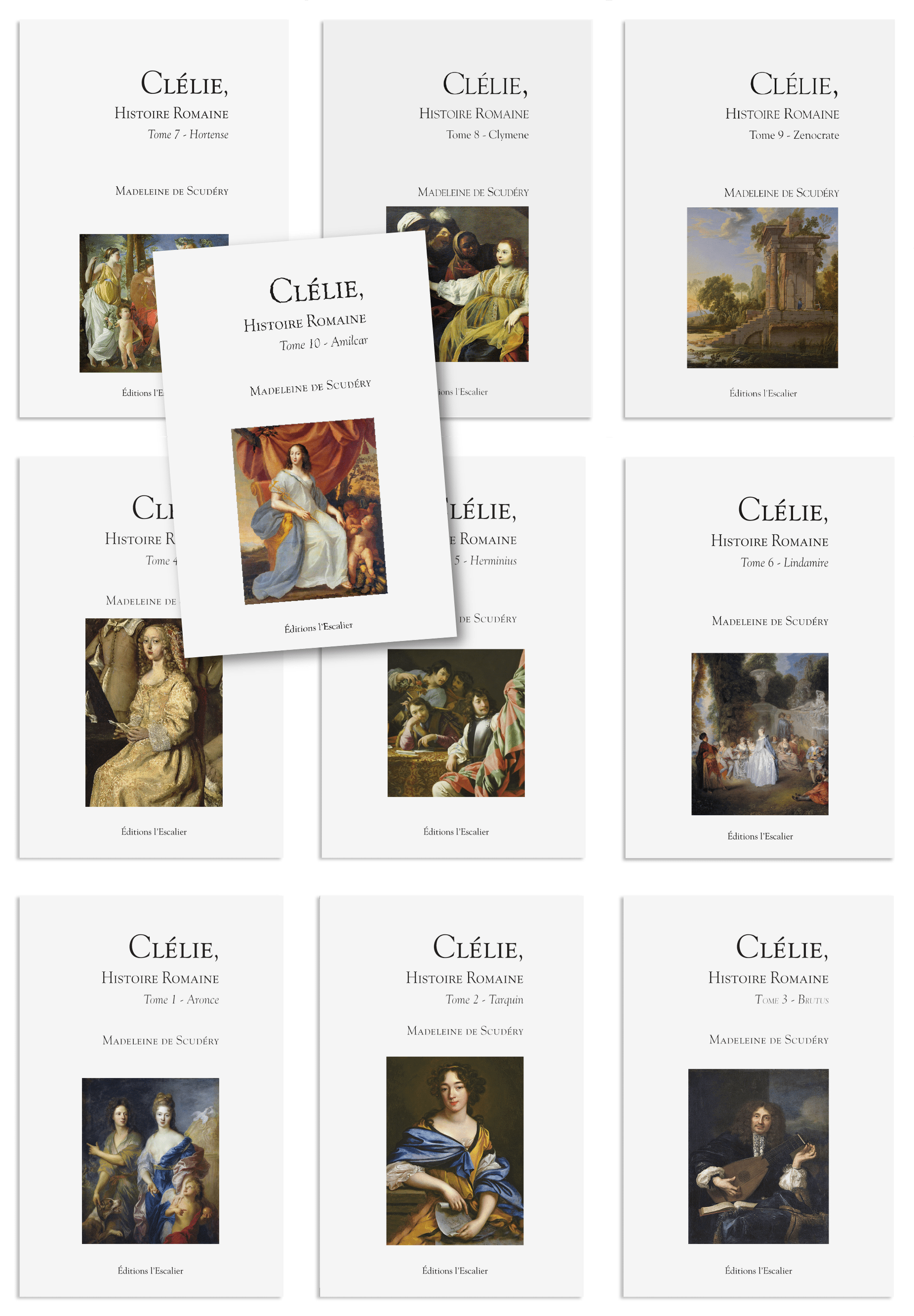
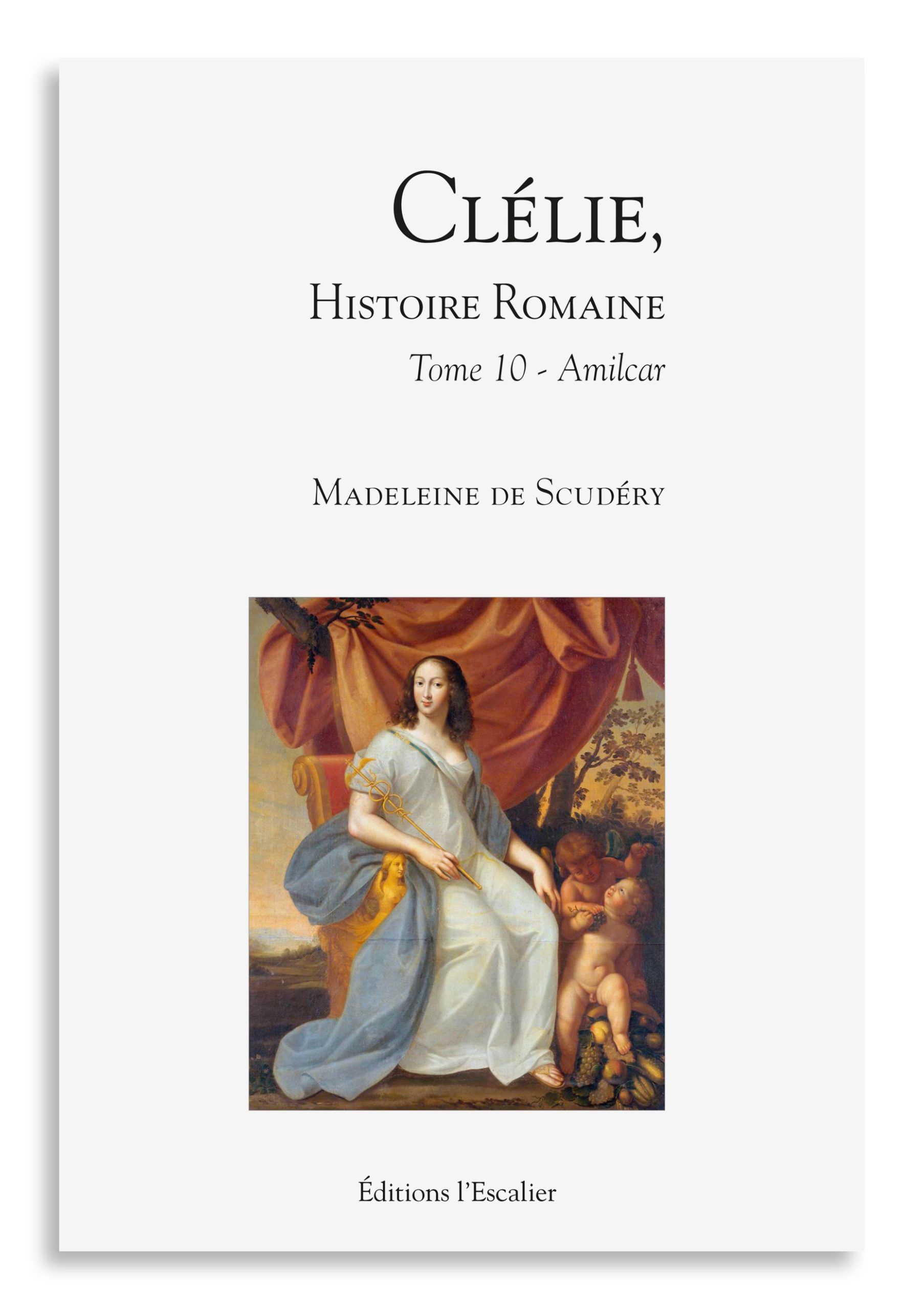
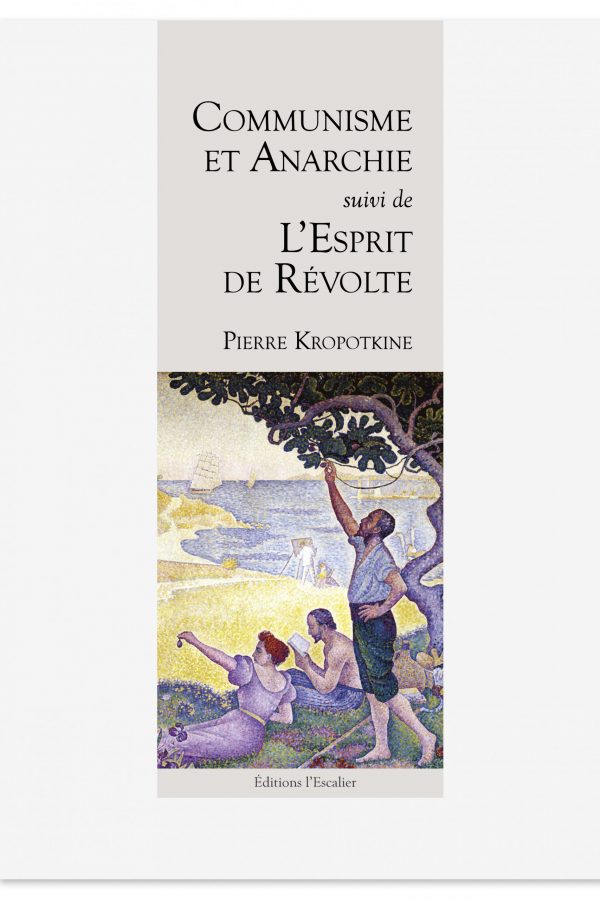

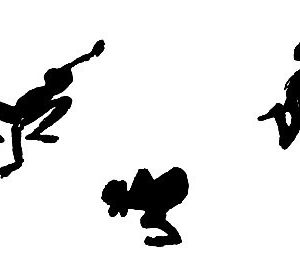
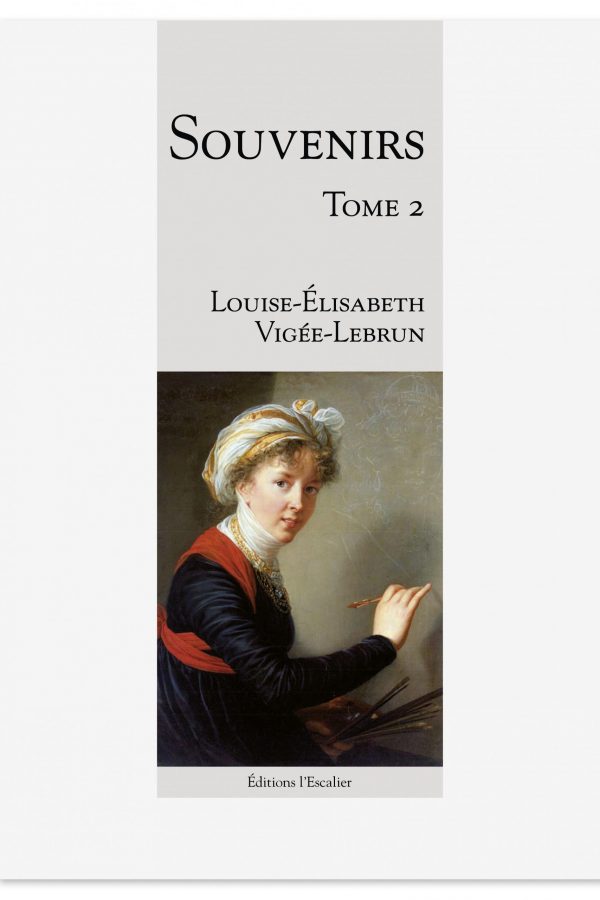

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.