Testament politique de Louis Mandrin – Ange Goudar
10,00 €
Testament politique de Louis Mandrin
Ange Goudar
138 x 204 mm – 36 pages – Texte – Noir et blanc – Reliure 2 points métal
Description
Je travaillais à ramasser les pièces qui devaient servir à dresser mon Testament Politique, lorsque je fus arrêté.
Sans cet événement auquel je ne m’attendais pas si tôt, cet ouvrage eût formé probablement à ma mort plusieurs volumes, qui, peut- être, eussent été plus utiles à la France que ceux qui ont paru sous le titre de Testament Politique de Richelieu, Colbert et Louvois. Les livres de ces hommes d’administration sont toujours à pure perte pour l’état ; car, en parlant du remède, ils ne pénètrent jamais jusques à la source du mal.
Les actions des particuliers, celle des chefs de parti, des vagabonds et autres, à qui la société donne des noms odieux, sont plus décisives parce qu’elles montrent pour l’ordinaire aux souverains, des endroits faibles du gouvernement.
Cartouche découvrit un vice dans l’administration française, qui, en débordant d’un autre côté, eut peut-être renversé la monarchie. La misère qui forçait alors une infinité de gens de tout état en France à devenir cartouchiens, avertit le ministère qu’il était temps de prévenir les dangereux effets de cette indigence.
Comme j’avais été arrêté sur les terres du duc de Savoie et qu’il fallait une espèce de négociation à mon sujet pour justifier cette démarche de la France auprès de ce prince, j’aurais eu assez de loisirs pour donner un peu plus d’étendue à cet ouvrage ; mais la curiosité du peuple à me voir dans ma prison et la manière d’une infinité de gens à m’entretenir, firent que je n’eus que le temps de faire un abrégé. Toutes les lettres qui y sont rapportées sont d’après les originaux que je n’avais point sur moi lorsqu’on m’arrêta, mais qui m’étaient très présentes à l’esprit.
Il ne tiendrait qu’à moi de m’ériger en héros.
Le public est déjà lui-même en avance des premiers frais de cette réputation en ma faveur. On se prévient toujours pour un parti- culier, qui, franchissant les bornes d’un rang obscur, fait beaucoup de bruit dans le monde. De cette prévention à l’héroïsme, il n’y a point d’intervalle.
Je pourrais donc impunément me comparer à Alexandre, à César et à tous les autres perturbateurs de l’univers. Dans le fond, si la cause des troubles qu’ils excitèrent fut différente, du moins les effets furent les mêmes. D’eux à moi toute la différence est dans l’importance de l’objet.
Je puis dire même que j’ai des endroits supérieurs à ces Mandrin de l’Asie. Ceux-ci en troublant le monde se virent toujours les premiers. Leur ambition rapporta tout à eux-mêmes : au lieu que dans les révolutions que j’ai excitées, je n’ai envisagé que le bien du public.
J’ai empêché que les richesses de plusieurs provinces ne s’écoulassent avec cette précipitation qui jusque là avait fait tout leur malheur. J’ai retenu, par le bas prix des matières nécessaires, une plus grande partie de l’argent dans plusieurs pays où la privation, jusqu’à ce moment, avait causé la ruine. J’ai déchargé le peuple d’une partie des impôts dont le poids l’accablait, etc.
Mais c’est en vain que je voudrais prendre le titre pompeux de
« protecteur du peuple ». Il y a une certaine équité naturelle qui prévaut toujours sur l’emphase des grands mots. Toute vertu cesse là où la subordination finit. Il n’appartient point à un particulier sous quelque prétexte que ce soit de jouer le rôle de réformateur. La première vertu d’un sujet est celle de l’obéissance. J’ai manqué au plus grand, au plus magnanime, au meilleur de tous les rois, je me déclare coupable de lèse-majesté, je mérite la mort, je l’attends avec résignation.
Cependant, ma prise et ma prison forment une époque remarquable pour la France. J’ai entendu les sanglots de ceux mêmes de qui on disait avant ce moment que j’étais la terreur. J’ai vu partout couler des pleurs.
Qu’est-ce que c’est que ce criminel dont toute la France parle, qu’un chacun plaint, que tout le monde regrette, à qui une infinité de gens voudraient racheter la vie de leur propre sang ? C’est un mystère que la politique de Versailles peut aisément développer. Je meurs content si cet événement peut servir à faire ouvrir les yeux au ministère. Le moment est décisif, le royaume vient d’essuyer une grande crise : il n’a manqué que des circonstances pour que la plus belle de toutes les monarchies fût renversée. Si une guerre étrangère était survenue, la France était perdue ; j’avais deux cent mille hommes sous mes ordres.
Le second état de presque toutes les provinces du midi, ce qu’on appelle les honnêtes-gens (car je ne parle pas des hommes de la dernière classe), n’attendait qu’une occasion favorable de se déclarer ; l’exemple des uns eût animé les autres, et la révolution alors devenait générale.
Quand le peuple commence une fois d’aller, il ne sait jamais lui- même où il ira. Le plus grand malheur d’un état est qu’il ait une fois levé le masque, car son crime alors est lui-même l’aliment de son audace. Les plus fameuses révolutions qui ont mis tout à feu et à sang, dans les plus puissants empires du monde, ont toujours commencé par des étincelles.
On dira que nous ne sommes plus dans ces siècles orageux où les gouvernements avaient tout à craindre de la part d’une populace effrénée ; mais l’Europe, depuis peu, a eu un exemple qui prouve que tous les âges du monde sont les mêmes. On vit, il y a quelques années, une poignée de citoyens d’une seule ville d’Italie sans secours, sans vivres, sans munitions, faire tête à une puissance militaire formidable, qui, quelques temps auparavant, avait fait trembler les plus grands états de l’Europe.
Mais moi-même ne sais-je pas, à une époque mémorable, combien la force des plus grands monarques est impuissante contre les plus petites émeutes des peuples.
La France a actuellement plus de cent cinquante mille hommes sur pied ; elle peut dans une bataille rangée accabler la plus formidable puissance. N’a-t-elle pu jamais me réduire ? J’ai toujours eu l’avantage sur elle, tant dans mes combats généraux que particuliers. Si j’ai été pris, ce n’a pas été de bonne guerre. Je l’ai ré- duite à la honte d’user avec moi de stratagème ; sans une trahison, je serais encore à la tête de mon armée, toujours la terreur de cinq ou six provinces.
Il ne faut point avoir recours à la vertu des talismans pour expliquer ceci. Ces phénomènes de politique irréguliers prennent leurs sources dans des causes naturelles.
Règle générale : les troupes réglées ont toujours une sorte de répugnance de se battre contre ce qu’ils appellent des bandits. Elles remplissent mieux leur devoir avec l’ennemi militaire de l’état. Il y a des lois plus douces dans les batailles réglées ; en y cédant à la force, on n’est fait de part et d’autre que prisonniers de guerre, au lieu que, dans les combats des sujets révoltés, les actions y sont plus terribles, car ceux-ci savent que s’ils ne périssent point dans le combat, et qu’ils sont pris, ils vont terminer leur vie sur un échafaud, alternative qui en les rendant furieux leur donne toujours l’avantage sur les troupes réglées.
Mais c’est encore là une autre époque remarquable. Le Français est patriote, il aime son roi et l’état ; si toutes les nations lui donnent le titre de léger, et d’inconstant, personne ne lui refuse celui de bon et de sincère : en général le peuple en France n’est point sanguinaire, il voit avec horreur l’effroi et le carnage. Cependant on s’est égorgé avec une fureur qui tenait de la guerre de religion. Ce paradoxe de la nature n’est pas non plus difficile à expliquer ; c’est qu’il s’est glissé un vice dans le gouvernement français qui a irrité l’esprit de ce peuple et l’a fait sortir de son caractère. Le vice est le système des fermes.
Les rois ne sont responsables qu’à Dieu seul de l’administration de leurs revenus. Cependant, comme c’est de cette partie du gouvernement que dépendent la richesse du peuple, la puissance de la monarchie, la sûreté du prince et le repos des sujets, il ne faudrait prendre trop de précautions pour qu’elle s’accorde avec le génie de la nation qui, en général, se trouve moulé sur la constitution première du gouvernement.
Je puis dire que j’ai le secret de l’État dans cette partie ; tous ceux qui se déchaînent contre les fermes royales n’allèguent contre elles que des préjugés généraux. Pour moi j’ai des faits à citer.
Une foule de sujets de tous les ordres de l’état se sont adressés à moi en différents termes, en différents lieux, soit par des lettres circulaires, ou des députations, pour combiner ensemble les moyens de secouer le joug de ce qu’ils appelaient la tyrannie des fermiers.
Ceux qui m’ont connu savent que j’ai exercé mon emploi de généralissime plus en politique qu’en vil partisan : j’ai cherché la cause de cette grande affluence de peuple qui venait chaque jour s’enrôler sous mes drapeaux, et, en remontant à sa première source j’ai découvert qu’elle prenait elle-même son origine dans le système des fermes.
J’ai trouvé que c’est à celui-ci, qui a renversé en France le premier ordre du gouvernement économique, politique et civil qu’il fallait l’attribuer.
Depuis soixante ans une espèce de maladie a attaqué le ministère français.
La fureur des baux a prévalu sur tous les autres systèmes de l’administration. Tout est ferme aujourd’hui en France, tout est contrat ; bientôt, il ne sera permis au peuple de respirer que par entreprise.
Quelques politiques se sont mis bien avant dans l’esprit que les fermes royales avaient augmenté les richesses de la couronne. Du temps de Louis XIII, disent-ils, les revenus du roi dans la partie relative aux fermes actuelles, n’étaient que de vingt millions, aujourd’hui les fermiers l’ont fait monter à cent.
Je suppose qu’il n’y a personne qui n’entende ce langage. Il signifie que les traitants ont forcé les rois qui ont succédé à Louis XIII de créer des impôts* sur le peuple qui n’étaient pas établis du temps du gouvernement de ce prince. Or un souverain n’a pas besoin de ces gens-là pour créer des impôts. Il serait même à souhaiter pour les sujets qu’il ne s’en servît jamais ; par là le peuple serait toujours soulagé d’un tiers de la taxe, car si un contrat particulier des fermes royales, par exemple, est de quarante millions, il est certain que, par le système des traitants, l’impôt est toujours de soixante effectifs sur le peuple. Il faut nécessairement, à la fin, que cette manière d’administration bouleverse l’état parce qu’elle jette toutes les richesses d’un côté.
Supposons une monarchie naissante sur la Terre composée de vingt millions d’habitants et qui eût neuf cents millions d’espèces (ce qui est, à peu près, la population et les richesses immeubles de la France) et que les revenus du roi fussent de trois cents millions. Qu’on établisse dans cet état naissant les fermes royales. Voici le mouvement que le contrat donnera aux finances : il retirera l’argent du peuple et l’enverra au prince qui à son tour le renverra au peuple. Mais comme, outre cette opération générale, les fermiers en feront une particulière qui sera de détourner une partie des richesses à leur profit, et que celles-ci ne rentreront plus dans la masse commune, il arrivera insensiblement que les traitants, à la fin, auront tout l’argent du royaume, et que le roi et le peuple n’en auront point.
Pour reconnaître le vide de tous les raisonnements que les parti- sans de ce système débitent, il suffit d’établir un seul point fondamental. Toute la gestion du fermier est fondée sur la richesse générale de l’état. Il peut bien donner un mouvement plus ou
moins rapide aux finances ; mais il ne saurait les augmenter. Car il n’est point en son pouvoir de mettre dans l’état une richesse qui n’y existe point, et qu’il n’a point lui-même.
À quelque prix que soit le bail des fermes, cela est indifférent aux fermiers. Ce n’est point lui, mais les sujets qui en font les fonds au roi. Le contractant n’a d’autre caisse que celle des deniers du peuple, il n’a d’autre moyen pour payer le roi que celui de ses propres finances.
Les revenus de l’État pourraient être perçus d’une manière plus simple. Pourquoi faire un métier de ce qui n’en doit pas être un ? Plus de quatre cent mille sujets pourraient être employés d’une manière plus avantageuse à l’état. II est certain d’ailleurs qu’il y aurait plus de probité en France, si on abolissait une profession qui fait que tant d’honnêtes gens deviennent des fripons.
Voilà en gros l’inconvénient des fermes. Je n’en connais point les avantages ; ceux de la régie sont sans nombre.
« La régie, dit un célèbre politique français*, est l’administration d’un bon père de famille qui lève ses revenus.
« Par la régie, le prince est le maître de lever ou de retarder la levée des tributs, ou suivant ses besoins, ou suivant ceux du peuple. Par la régie, il épargne à l’état les profits immenses des fermiers qui l’appauvrissent d’une infinité de manières. Par la régie, il épargne au peuple le spectacle des fortunes subites qui l’affligent. « Par la régie, l’argent levé passe par peu de mains. Il va directement au prince, et, par conséquent, revient plus promptement au peuple. Par la régie, le prince épargne une infinité de lois qu’exige toujours de lui l’avarice des fermiers, qui montrent un avantage présent pour des règlements funestes pour l’avenir… »
Ce célèbre auteur aurait pu ajouter que les fermes donnent de l’autorité à certaines gens qui, vu la nature du gouvernement monarchique de la France, ne devraient point en avoir. Il s’établit des tribunaux contraires à sa constitution. La justice est exercée par des gens qui sont eux-mêmes juges et parties. Par les fermes, la majesté du trône est avilie, il n’y a plus de proportion de la puissance du souverain à celle des sujets. Il faut nécessairement à la fin que les maltôtiers deviennent les maîtres de l’état ; car de la pos- session générale des richesses à l’autorité entière, il n’y a point d’intervalle.
Cela n’a pas été un spectacle bien surprenant, dans le cours des dernières guerres, de voir Louis XV, ce grand prince que les puissances les plus formidables de l’Europe liguées ensemble n’avaient pu faire fléchir un instant, être forcé d’avoir recours à ces financiers et les prier, pour ainsi dire, de lui fournir les moyens de s’opposer aux desseins de ses ennemis et, d’un autre côté, ces hommes durs et intraitables voulant traiter avec ce prince d’égal à égal et choisissant ces temps de calamité pour exiger des lois onéreuses à ses peuples.
Par les fermes, la manière de percevoir les revenus de l’État devient une profession particulière. Il n’y a qu’une classe d’hommes qui ait la clef de la levée des droits du prince. Les maltôtiers aujourd’ hui en France se succèdent les uns aux autres. Le métier de financier est devenu un art de famille.
Par les fermes, le roi et ses ministres sont déroutés ; ils n’ont plus à la fin aucune idée des revenus de la couronne. Alors, on a beau découvrir que les fermiers sont des malhonnêtes gens, on est obligé de fermer les yeux sur leurs malversations, parce qu’on n’en a pas le remède. C’est le cas où se trouve aujourd’hui la France. Entrons à présent dans les branches particulières de ce désordre. Les fermes royales, sur le pied de leur régie actuelle par la compagnie, occupent au-delà de trois cent mille commis, gardes, employés, buralistes, etc. Ces nouvelles professions ont été prises sur la classe des laboureurs ce qui a formé un vide immense dans l’agriculture. La moitié du royaume en est demeuré en friche. La plupart des terres, qui, du temps de Charles IX, d’Henri III, produisaient une valeur à l’état, n’en donnent à présent aucune, une grande partie étant retournée en communes.
Ce royaume fournissait autrefois la subsistance à ses voisins. Aujourd’hui il tire d’eux une partie de la sienne.
C’est au contrat des fermes qu’il faut attribuer la véritable époque de la décadence de la France. Sans cette manière d’administration, ce serait aujourd’hui le royaume le plus florissant de l’Europe. Les véritables richesses d’une nation ne peuvent venir que de la terre, toutes les autres sont chimériques ou précaires.
L’agriculture produit seule dans l’état une valeur qui n’existait pas. Si le système des fermes avait été établi en Angleterre, cette monarchie ne serait jamais parvenue à l’état de grandeur où elle se trouve aujourd’hui. C’est à la régie qu’elle doit toute sa puissance. Cette nation eût perdu par-là un capital en fonds de terre de plusieurs milliards, dont son agriculture lui paye tous les ans le revenu. Elle n’aurait assurément point ces riches maisons, si, par des fermes royales, le nombre de ses employés eût augmenté dans la proportion de ceux de la France. La recette des droits dans cette monarchie occupe peu de sujets. Les revenus de l’État ne sont pas devenus l’affaire particulière d’une compagnie. On n’a point fait un système de la levée des revenus publics. Le contrat n’a point diminué le nombre des professions de premier besoin. L’agriculture, le commerce, et les arts ne s’en sont point ressentis. L’industrie de chaque particulier se rapporte au bien de l’état. Toute la somme du travail des sujets est relative à la république.
La direction générale de l’emploi des sujets est le chef-d’œuvre de la politique du ministère : c’est de cette combinaison bien ou mal entendue, que dépende toujours la puissance ou la faiblesse des états.
Cette direction peut seule expliquer comment des monarchies avec la moitié moins d’habitants et de peuples deviennent aussi riches et aussi opulentes que d’autres qui ont le double de tout cela.
On entend dire tous les jours par les partisans du contrat que les fermes donnent à vivre à trois cent mille sujets qui sans cette ressource seraient embarrassés de subsister.
C’est précisément cette ressource qui ruine la France en diminuant continuellement ses richesses naturelles. Il est clair que d’un laboureur à un employé, c’est à dire d’un sujet qui crée tous les ans dans l’état une valeur de 300 livres avec celui qui la consume; d’un homme qui entretient à un autre qui est entretenu, il y a une différence entre ces deux sujets d’une valeur de six cents livres au désavantage de l’état, ce qui, multiplié par trois cent mille, fait une perte réelle de dix-huit cents millions tous les ans pour la monarchie.
Depuis la création du contrat, la France a perdu une valeur immense que lui aurait produit son agriculture, outre un capital de richesses en fonds de terres défrichées de dix-huit milliards qui lui porterait annuellement au-delà de neuf cents millions, valeur d’autant plus réelle qu’échangée contre l’industrie et l’or des autres nations, aurait donné à l’état une richesse effective au lieu que la somme du produit des fermes, étant prise dans les richesses de la nation n’en augmente point la masse.
La plupart des hommes en France ont perdu la trace de leurs premières professions ; toutes les classes se sont remplies insensiblement les unes sur les autres. Celle des laboureurs fut toute à diminuer dans la proportion que les emplois des fermes ont augmenté. Les branches des sujets qui ont quitté les professions de premier besoin pour embrasser celles qui ne produisaient rien à l’état se sont accrues. Cependant ces nouvelles classes ont dû subsister sur la somme du travail de ceux qui sont restés à la campagne et, celle-ci ne suffisant pas, il a fallu avoir recours à l’agriculture des autres états, ce qui a dépouillé la France de ses richesses ; ainsi on peut dire que la population de cette monarchie a été elle-même un des plus grands inconvénients de son opulence. Le ministère est surpris de cette foule de contrebandiers dont la France est remplie ; il s’en demande la raison. Mais ne voit-on pas que ce sont les fermes elles-mêmes qui en sont la cause. La partie des sujets qui a été retirée de la campagne pour servir dans les emplois subalternes des fermes a formé une grande branche de
gens oisifs, car un petit commis de douane qui a eu dix enfants n’a pas pu les faire tous commis comme lui. Qu’a donc du devenir cette foule de gens sans profession ? Elle a formé ces troupes considérables de contrebandiers.
J’ai observé que le plus grand nombre de ceux qui prenaient parti dans mes troupes étaient des descendants de laboureurs dont les emplois des fermes avaient retiré les ancêtres de la campagne et qui se trouvaient sans aucun talent, car c’est une observation que chacun peut aisément faire que le fils ou le petit-fils des employés en général sont peu propres aux professions pénibles de la société. Des gens dont les aïeuls ont endossé l’épée, et qui ont passé leur vie à se promener autour d’une ville, ou d’une porte, contractent un dégoût naturel pour le travail, dont pour l’ordinaire les enfants héritent.
Je donnerai ici la copie de plusieurs lettres, qui me furent adressées lors de la création de mes troupes. La manière dont elles sont écrites pourrait être une énigme pour la plupart des lecteurs, si je n’avertissais que ma coutume ordinaire était de ne recevoir aucun de mes soldats, sans être informé préalablement des raisons qui les portaient à prendre ce parti.
Le style est un peu différent de celui d’un testament politique : mais je les rapporte comme elles m’ont été adressées. Je cache seulement les noms, les lieux et les dattes…
Informations complémentaires
| Poids | 50 g |
|---|---|
| Dimensions | 3 × 138 × 204 mm |
| Disponible | Oui |
| Genre | Écrits politiques, Témoignage |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
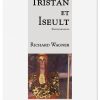

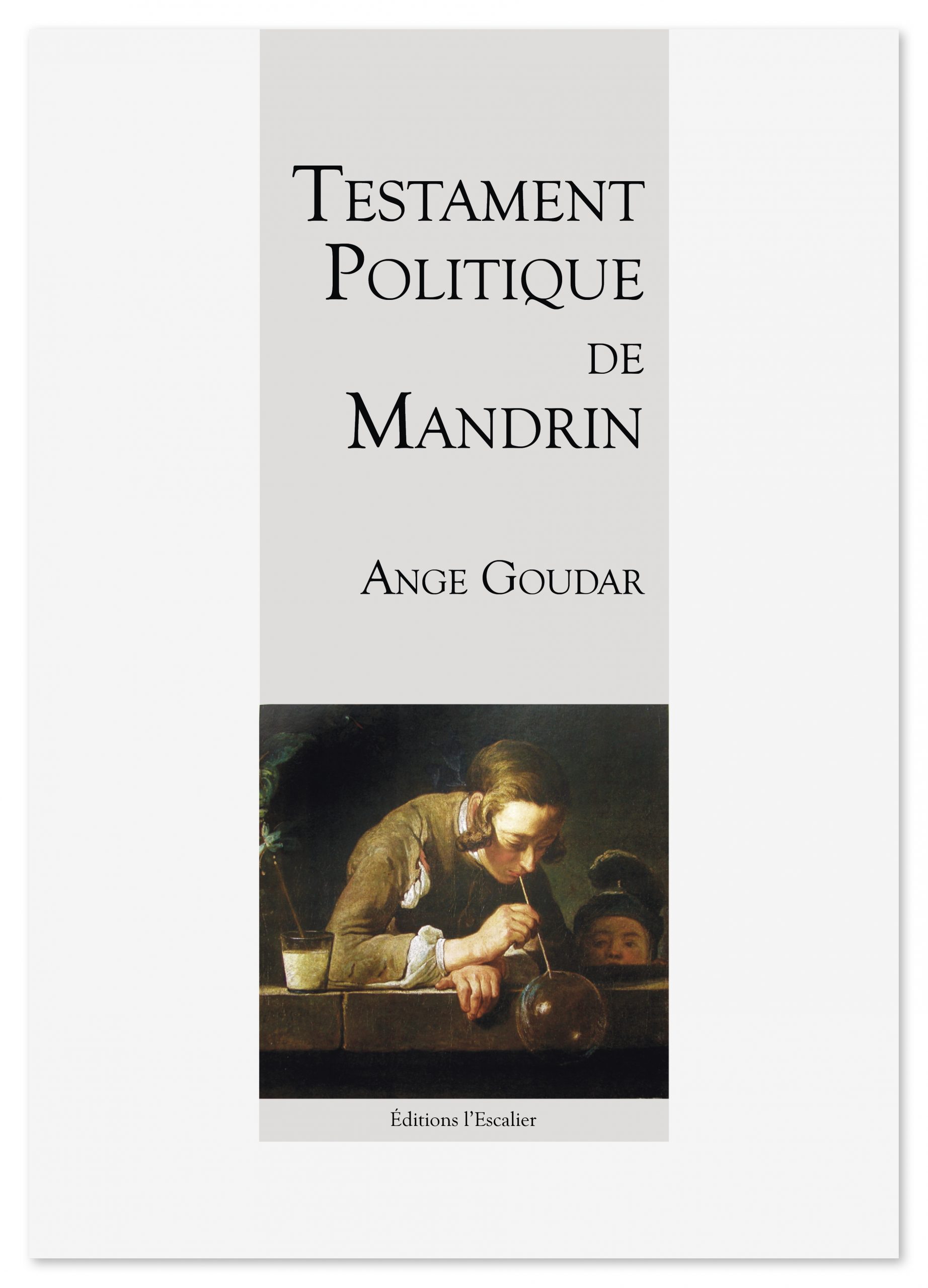

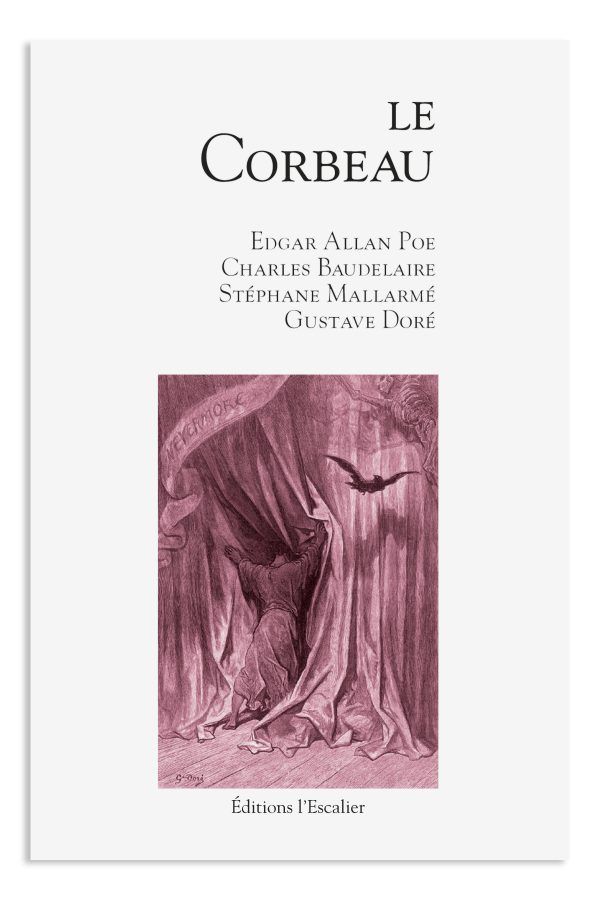
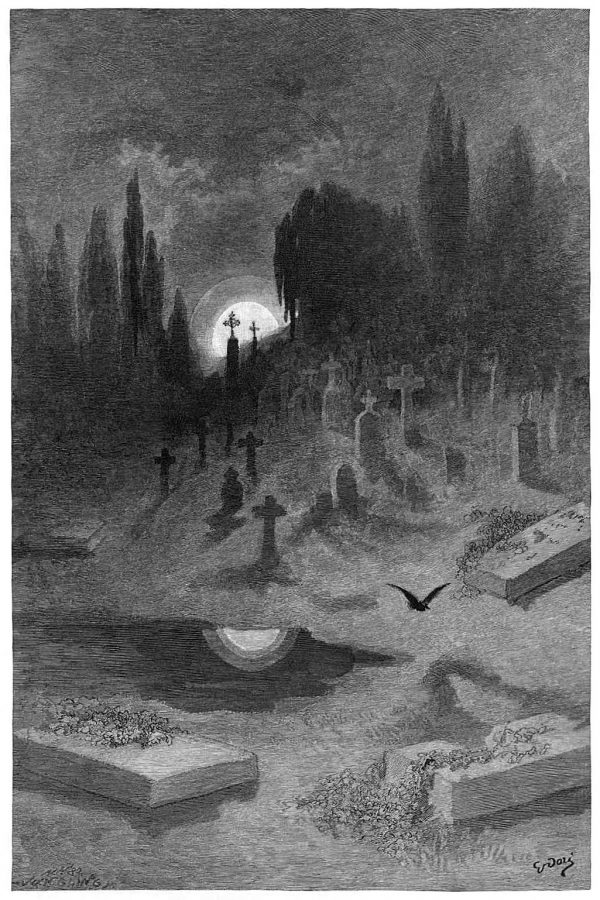


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.